Le 18 octobre 2021, l’auteur espagnol José Manuel Fajardo présentait son dernier roman, Haine, traduit par Claude Bleton et paru aux éditions Métailié en 2021, dans le cadre du projet « 1 bouquin 1 vin » à la Quincave (Paris).
Entretien avec Gianna Schmitter et Priscilla Coutinho.
Tu commences chaque partie de Haine (celle se déroulant au XIXe et celle du XXIe siècle) par une description du lieu de vie des personnages. Penses-tu que l’environnement est déterminant pour des phénomènes comme la haine ? Dans quelle mesure s’applique une sorte de déterminisme ?
Même si je peux être un mec sympa pour certaines choses, j’ai aussi mon mauvais caractère, et surtout du point de vue idéologique : il y a vraiment des choses qui me fâchent. Une des choses qui m’énerve le plus dans la vie, c’est cette sorte de narcissisme égocentrique dans laquelle nous vivons aujourd’hui et selon laquelle chacun de nous est le souverain absolu de l’univers : nous sommes propriétaires de notre destin ; la vie, elle est à notre service ; Moi et Je, ce sont les deux personnages principaux de notre vie. Comme si rien de ce qui est autour de nous n’avait un rôle à jouer, mis à part celui de devenir un décor de la scène qui est en train de se dérouler pour que nous puissions faire notre petit théâtre. Alors, dans ce roman, j’ai placé les personnages dans un endroit précis, et cet endroit n’est bien sûr pas un hasard, parce que ces personnages, comme nous tous, ne sortent pas de nulle part : ils sortent de circonstances, de familles, d’espaces, de quartiers, d’univers sociaux, qui ne sont peut-être pas déterminants à la façon marxiste-léniniste, mais qui ont un rôle très, très fort sur la formation des caractères et sur l’évolution de la pensée des êtres humains. Avec ce roman, je voulais faire le portrait de deux monstres, de comment on construit un monstre à partir de ces ingrédients, des éléments très banals. Je pensais que je devais donner une importance aux choses, aux univers dans lesquels ces aspirants à devenir des monstres évoluent.
Les deux personnages principaux sont des hommes, les femmes sont très périphériques dans ce roman. Dans les deux cas, les protagonistes se servent d’une femme qui, dans son rôle de victime, permet aux personnages masculins d’accomplir leur rite de passage, et d’assumer un nouveau comportement face à la société. L’empowerment passe par le meurtre ou le viol d’une femme. On peut mentionner ici l’animalisation de la femme dans ce rôle de victime : dans le cas de la prostituée assassinée, elle est égorgée comme une bête à l’abattoir par cet homme qui avait été vétérinaire avant de devenir commerçant de cannes ; pareil avec Nadine, la mannequin qui ressurgit à la fin du roman comme une proie enfermée et attachée dans une chambre où elle sanglote, et qui va finalement se faire violer par Harcha. Pourquoi les femmes occupent-elles cette place dans le récit ? La haine et le genre sont-ils en relation ? La haine serait-elle plus forte envers les femmes ?
Oui, mais je nuancerais un peu ton propos car je pense que les femmes ont un rôle central dans le roman, même si elles ne sont pas les personnages principaux. Leur rôle est absolument central parce que c’est autour de la place que les hommes du roman donnent à la femme que se développe toute la machine de la haine. La haine dont j’ai essayé de faire le portrait – parce qu’il y a plusieurs manifestations de la haine, c’est une créature à plusieurs têtes –, c’est la haine de l’autre, c’est-à-dire la haine projetée contre les êtres humains qu’on envie, ou qu’on déteste parce qu’ils sont différents par la classe sociale, la race ou le sexe. Et je crois que la première manifestation, les premiers « autres » qu’on trouve toujours dans l’existence, c’est l’autre sexe. Les hommes pour les femmes ; et les femmes pour les hommes.
J’ai écrit d’autres textes autour du sujet de la violence – des essais et des textes journalistiques –, j’ai fait des recherches sur ce sujet et j’ai utilisé beaucoup de statistiques. Il y a une chose sur laquelle tout le monde est d’accord concernant la violence – sauf, bien sûr, certains personnages d’extrême droite – : 90% des meurtres sont commis par des êtres humains de sexe masculin. C’est-à-dire que la violence a un sexe, et c’est le sexe de l’homme. En parlant de façon sociale, cela ne veut pas dire que la femme ne peut pas être violente : dans l’histoire criminelle, il y en a eu plusieurs, la femme n’est pas non plus un ange. Mais ce que l’on peut constater historiquement, c’est que la violence est exercée de façon permanente et majoritairement par les hommes. Dans le livre, cette haine de l’autre se manifeste de plusieurs façons : il y a la haine contre la bourgeoise d’un côté et les classes populaires de l’autre, qui est au final une haine très classique de la classe moyenne, avec ses aspirations et frustrations, et qui est à la base de la constitution historique de la pensée fasciste au XXe siècle. Pour moi, le personnage de Jack Wildwood est une sorte de fasciste avant la lettre parce qu’il ressent cette sorte de haine. En revanche, la haine de Harcha est une haine réflexe, c’est lui qui prend le rôle de la victime, pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Il utilise cette victimisation comme justification de ses propres frustrations et de la projection violente de ses frustrations, surtout des frustrations sociales. Mais ce qu’il y a en commun et au départ pour les deux protagonistes, c’est bien le rôle des femmes. Jack Wildwood déteste les femmes. C’est une haine qu’il a reçue en héritage de sa propre famille, où il y avait déjà ce discours de la haine. Dans le cas de Harcha, c’est la même chose de part son père qui est un homme très conservateur : il ne laisse presque pas sortir les femmes de la maison ; il se fâche avec sa fille aînée parce qu’elle a refusé d’épouser l’homme qu’il avait choisi pour elle, il l’expulse de la famille, il la traite de pute.
Le symbole du roman est une canne qui cache une épée à l’intérieur. Il ne faut pas avoir fait des études de psychanalyste pour trouver la symbologie phallique de cet objet qui est la colonne vertébrale du roman : c’est l’objet qui passe d’une époque à une autre et qui symbolise d’une certaine façon cette haine qu’on a reçue en héritage et qu’on transmet à la génération suivante, n’importe où. Je n’ai pas voulu construire un personnage principal de femme parce que dans les mondes de ces messieurs-là, les femmes ne sont personne, elles font seulement partie du décor de leurs vies. Du point de vue des deux personnages masculins du roman, cela n’avait pas de sens de leur donner un rôle principal. Toute cette réflexion était dans ma tête quand j’écrivais Haine, mais ce n’est pas dans le texte. Le livre n’est pas un traité sur la violence. Ce sont des portraits de personnages. Ce que l’on trouve dans le roman, c’est leurs pensées, si l’on peut appeler cela « pensées », et leurs caractères, la façon dont ils vont évoluer et plonger dans l’abîme. C’est un peu le regard que ces personnages ont sur la vie. La logique de ces personnages n’aurait pas marché s’il y avait eu un personnage principal féminin.
Tu n’as pas publié de roman pendant presque dix ans, comme tu l’expliques à la fin du livre. Ce roman est très différent des précédents. Comment cela se fait-il ?
J’étais pas mal perdu après avoir publié Mon nom est Jamaica, qui a été, passez-moi l’ironie, un formidable échec, une catastrophe du point de vue des ventes en Espagne. Et en même temps, c’est la catastrophe qui a refermé toute une série de romans qui étaient comme un monde, dans lesquels j’avais travaillé sur certaines idées que j’abordais d’une façon ou d’une autre, avec une histoire ou une autre, dans une période historique ou une autre. Mais les sujets, les cœurs de ces romans, étaient presque toujours les mêmes. Et quand je finissais un livre dans cette veine, je me disais, « bon, qu’est-ce que j’ai fait ? » Parce que j’avais dit tout ce que je voulais dire sur ce sujet, je l’avais dit de plusieurs façons, et je me suis alors retrouvé dans une voie sans issue. Je ne savais pas où aller, ni comment faire. Et je suis resté bloqué. Si le livre avait eu un bon accueil, s’il avait eu des lecteurs dans ma langue, si la vie de Mon nom et Jamaica avait été autre, peut-être que la propre logique de la vie littéraire m’aurait poussé à écrire de nouvelles choses. Mais comme ça n’a pas été le cas, je me trouvais d’un côté frustré, et d’un autre sans idée très claire de quel pourrait être le chemin pour continuer. J’ai passé quelques années sans écrire. Je n’ai pratiqué que des écritures par procuration, c’est-à-dire des traductions, et cela m’a beaucoup aidé. Parce que traduire, c’est comme aller faire de la gymnastique. Cela t’oblige. Finalement, la traduction, c’est une manière d’écrire, un exercice de style. Pour moi, cela a été fondamental d’avoir traduit en espagnol cinq romans de Patrick Deville. Ensuite, j’ai reçu commande d’une traduction de la Trilogie allemande de Louis-Ferdinand Céline. Cela a été une expérience extraordinaire, d’un côté ; et de l’autre une horreur totale. Une véritable souffrance : traduire Céline, c’est terrible, traduire son écriture c’est très dur car il cache des pensées en dessous, il n’explique que de petits morceaux de phrases… Et toi, tu dois suivre ces textes non-dits pour réussir à traduire ce qui est dit. Mais en même temps, il y a pire encore : on rentre dans un monde, un univers absolument plein de rancœur, de haine, de frustrations, d’auto-commisération. Je n’ai jamais lu quelqu’un se plaindre autant de ses malheurs comme lui. C’était très inquiétant. Et au feu de la haine de ce monsieur, le roman Haine a commencé à pousser – même s’il est très loin, bien évidemment, de la hauteur littéraire de Céline, qui est un des grands écrivains de notre époque. Mais sa haine, dans une certaine mesure, a un peu contaminé ce que j’ai écrit. J’ai récupéré des textes que j’avais écrits avant. Un de ces textes était l’histoire de Jack Wildwood et cela faisait longtemps que je pensais que je devrais peut-être la transformer en roman. Après, je me suis dit : mais pourquoi faire un roman de plus sur Jack l’Eventreur quand il y a mille romans sur cette période ? Finalement, j’ai trouvé une voie, les jeux de miroir qui donnent une autre perspective. J’adore emprunter les idées des autres auteurs et je l’e reconnais toujours. Je me rappelais de la structure qu’avait donnée William Faulkner aux Palmiers sauvages : il s’agit de deux histoires qui n’ont rien à voir entre elles et qui *alternent de page en page. Je n’étais pas aussi radical que lui et j’ai choisi de ne pas alterner les pages mais les chapitres, car il ne fallait pas non plus rendre encore plus difficile le roman, j’avais envie d’en vendre au moins deux exemplaires… Grâce à ce schéma, j’avais l’impression d’avoir trouvé un mécanisme qui fonctionnait pour écrire cette histoire et pour inaugurer une autre façon d’écrire, différente de celle que j’avais utilisée jusque-là. Haine est donc la première petite expérience dans cette nouvelle étape de mon écriture. Je ne sais pas ce que cela va donner, mais je suis déjà en train d’écrire un autre roman, donc cela veut dire que j’ai trouvé une voie – en tout cas, je l’espère. Je suis très curieux de savoir où cela peut m’amener.
Les personnages du roman semblent occuper une place intermédiaire dans la société ou plutôt une non place, puisqu’ils ne se trouvent vraiment nulle part. Cela me fait penser à ce personnage type qui traverse la littérature brésilienne, celui du métis qui est le fruit direct de cette génération qui a eu pour héritage le passé esclavagiste et qui de ce fait constitue une population hybride qui ne sera jamais totalement intégrée à la société brésilienne. Ainsi, comme dans le passé de l’histoire brésilienne, les personnages de ton livre sont, eux aussi, entre deux mondes, comme si les contextes historiques propres à chaque période n’avaient pas été capables d’insérer socialement ces individus. Ton livre nous montre d’ailleurs que ce phénomène se répète et qu’il n’est donc pas nouveau. D’où vient-elle cette fissure, cette faille dans le système qui engendre une autre catégorie d’exclus ?
Si j’avais la réponse à cela ! Je crois que sur l’échelle sociale, la classe sociale moyenne vit toujours entre l’aspiration d’arriver à une position de vraie intégration dans le pouvoir de la société et la terreur de tomber dans l’abîme du prolétariat ou de la population qui a des conditions socio-culturelles plus difficiles. Et cela explique parfois pourquoi, dans les moments de crise, il y a une partie de la classe moyenne qui bascule du côté de l’extrême droite, ou qui peut tomber du côté des positions plus progressistes selon la situation économique du pays. Pourquoi ? Parce qu’il y a des inégalités dans la société, parce qu’il y a des crises économiques… Or, ce qui a été plus intéressant pour moi, ce n’était pas tant d’expliquer le pourquoi, que de décrire ce processus, cette double situation dans laquelle se trouvent les personnages. Harcha est le fils d’un roi des pneus de la banlieue, c’est-à-dire de quelqu’un qui a de l’argent en comparaison avec tout le reste du quartier, mais si tu le ramènes à Paris parmi les « vrais » riches, c’est un pauvre diable. Pourtant, dans son quartier, il est quelqu’un. Il a une position ; et son fils, est conscient de tout ce qu’il y a autour de lui, des problèmes, mais aussi de comment il est méprisé par ces autres mondes auxquels il ne peut pas aspirer.
Jack Wildwood, lui, est dans une situation semblable, il est un petit commerçant. Il a sa boutique, qui a beaucoup prospéré ; il a une bonne position, mais il est toujours en situation de subordination vis-à-vis de tous ces gens qu’il côtoie dans le pub et en même temps, il est horrifié par toute cette pauvreté qui est autour de lui dans Soho. L’un comme l’autre sont des personnages qui n’ont pas d’estime de soi. Au fond, ce sont des personnes qui se détestent elles-mêmes, qui n’aiment pas ce qu’elles sont, qui ne se sentent pas capables de devenir autre chose. En plus, comme je le disais avant, il s’agit d’une haine qui est un héritage de famille – et ça, c’était important pour moi parce que j’ai vécu au Pays basque au moment où l’ETA y assassinait toutes les semaines. Je vivais à Getxo, dans les environs de Bilbao. Ils ont tué mon voisin, qui était juge, et ils ont envoyé une lettre piégée à un ami qui était journaliste. Ils ont tué un autre journaliste, un collègue du journal dans lequel j’ai travaillé. Quand j’ai connu les gens qui faisaient partie du monde de l’ETA, une chose m’a beaucoup frappé : je me rendais compte qu’une bonne partie de cette haine avait été reçue en héritage familial. Presque à la façon des mafieux. Cela se transmettait de père en fils : on transmettait les récits de toutes les choses qu’on avait faites contre la famille, contre le village, etc. Ces histoires pouvaient avoir soixante ans, elles pouvaient même renvoyer à l’époque des guerres carlistes, c’est-à-dire au 19ème siècle. Tout ça, c’était vivant parce que c’était récupéré par le récit familial qu’on répétait sans cesse et ça travaillait vraiment la tête des gens. Mes personnages sont le réceptacle d’une misogynie féroce transmise qui installe une rancœur et un mépris envers l’autre qui va trouver ensuite différentes manifestations.
Avec la charge que les deux personnages de Haine portent, ils ne peuvent que finir très mal, et il ne peut en être autrement parce qu’ils n’ont rien à quoi se rattacher. Rentrer dans la tête de deux personnages aussi antipathiques, a été une expérience particulièrement désagréable. C’est pour cela que le roman est très court : pour pouvoir reprendre mon souffle.
Propos recueillis par Gianna Schmitter et Priscilla Coutinho
Littératures
José Manuel Fajardo est né à Grenade en 1957. Étudiant militant au moment de la transition politique du franquisme à la democratie, il a abandonné ses études de droit pour se consacrer au journalisme. Journaliste et historien de formation, il travaille également comme traducteur et a vécu au Pays basque, en France et au Portugal. Il a cosigné plusieurs contributions dans la presse avec Luis Sepúlveda qui a d’ailleurs préfacé son premier succès littéraire, Lettre du bout du monde, publié en 1998. Son style sera récompensé en 2002 avec Les Démons à ma porte pour lequel il a reçu le Prix Charles Brisset, et en 2011 avec Mon nom est Jamaica pour lequel il a reçu le Prix Alberto-Benveniste. Il est l’auteur, entre autres, des Imposteurs, et de L’Eau à la bouche, ainsi que d’essais historiques.



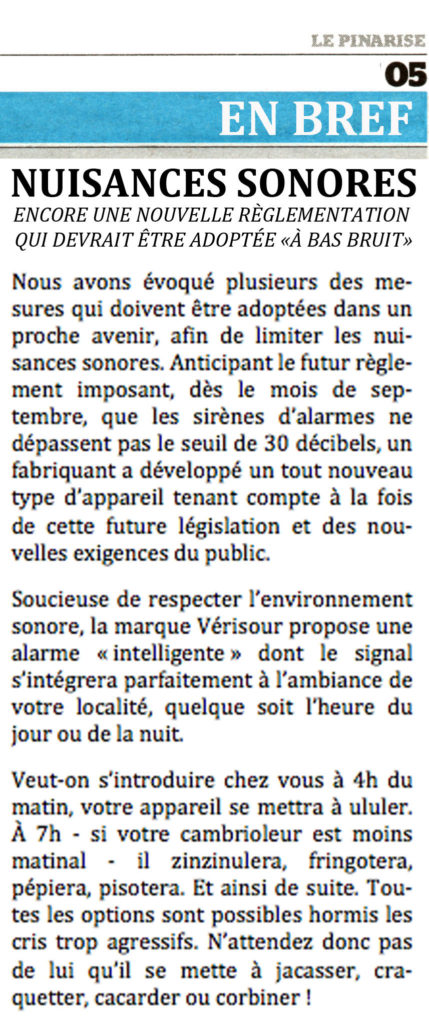





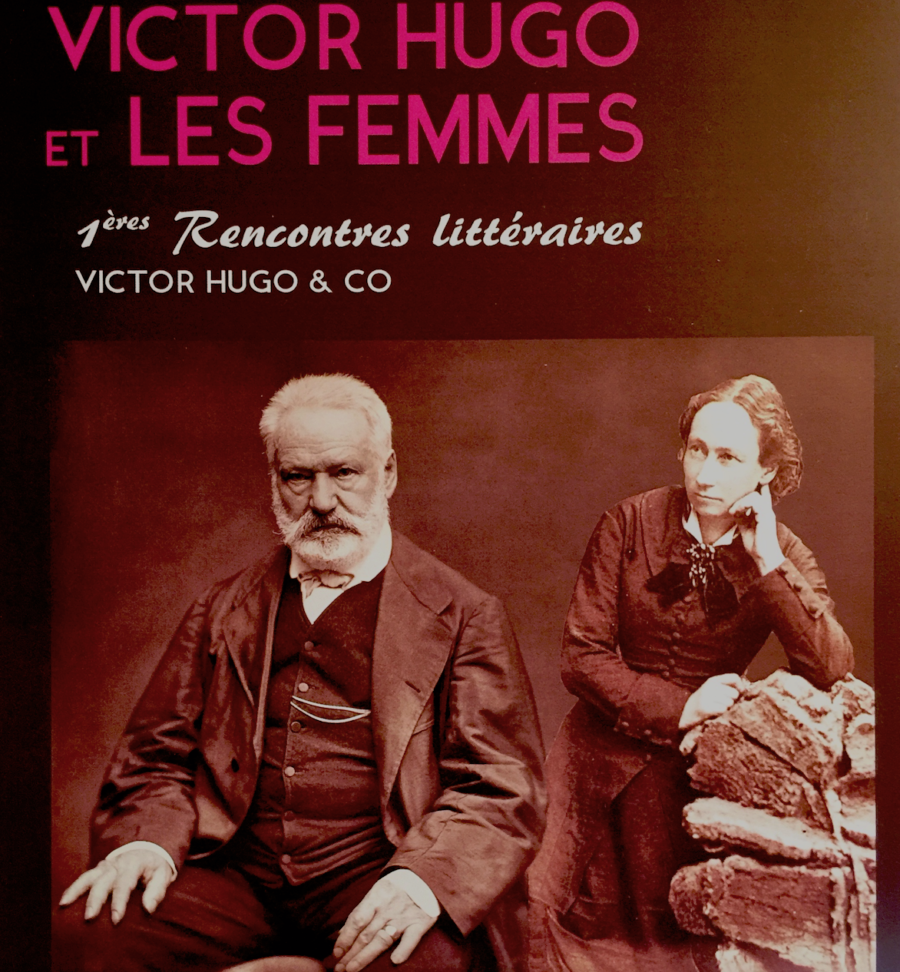
0 commentaires