Est-ce l’arrogance politique décomplexée, le réflexe garçon “Je-fais-du-bruit” au sein de la gente policière, la cote d’alerte anti-terroriste à son maximum, ou encore la démultiplication des présidents étrangers en visite, toujours est-il que les convois sirène hurlante qui traversent certains quartiers de la capitale ne m’ont jamais paru aussi nombreux. Va-t-on vers une “new-yorkisation” de Paris ?
Au Quartier Latin, depuis trois mois, les policiers et les militaires sont sur les dents autour de la Sorbonne et des grands lycées assaillis d’alertes terroristes. Le nombre de fourgonnettes, camionnettes, estafettes, est effarant. Tandis que les profs s’essayent au “Die-in”, s’allongeant, parfois péniblement, près de la fontaine devant la chapelle de l’université, les convois d’une dizaine de véhicules ziguent et zaguent autour de la place, empruntent le boulevard Saint-Michel en tout sens, se frayent un chemin au milieu de la circulation à grands coups de sirène, stationnent près de Louis-Le-Grand, Saint-Louis, Henri IV ou Fénelon, tout ce que le quartier compte d’établissements de prestige. Tout cela paraît beaucoup, comme un déploiement de bruit uniquement fait pour rassurer le quidam face aux menaces qui pèsent sur Paris. La ville vit dans un état de tension proche de la paranoïa et les départs de peur ou de panique continuent, plusieurs fois par semaine. Je ne suis pas absolument certain que toutes ces sirènes soient le meilleur moyen de faire tomber l’atmosphère obsidionale de citadelle assiégée dans lequel se trouve placée, qu’elle le veuille ou non, la capitale parisienne depuis le 13 novembre.
Quand le piéton de Paris vire plus au nord et traverse la Seine près du Palais de Justice, là, il doit laisser place au convoi étroitement surveillé des détenus de haut vol qu’on amène au tribunal. Un matin, il y a quelques jours : deux motos cent mètres devant, un fourgon blindé encadré de deux voitures policières avec hommes en armes, mitraillette au poing à chaque portière, circulant à toute vitesse dans un hurlement strident. Depuis la fenêtre d’une des voitures du convoi, un haut-parleur crache ses ordres : “Rangez-vous“, “Ne passez pas”, “Ne traversez pas”, “Restez où vous êtes”. Ni s’il vous plaît ni merci : chacun est sidéré, médusé par sa propre acceptation passive de tant de martialité. La sirène dit un État qui se rêve de plus en plus ouvertement policier.
Voulez-vous vous remettre de cette promenade en bord de Seine qu’à la Concorde votre marche est entravée par les voitures de ministre en pleine navette entre rive gauche matignonesque et rive droite élyséenne. L’agitation obligée des politiques fait surchauffer la sonnette : toutes ces affaires d’État sont-elles si urgentes qu’elles nécessitent que la vie se fige et s’arrête devant ce tintamarre ? Et soudain, près du quai d’Orsay, c’est un convoi d’une vingtaine de voitures, dont certaines ornées d’un drapeau inconnu — une moderne république bananière, le chefaillon en tête, puis les gardes du corps, puis les sous-chefs, puis la cour, puis les femmes, puis l’intendance — qui passe toutes affaires cessantes pour honorer de sa visite notre premier diplomate. Le trafic est interrompu dix bonnes minutes, certes, mais pourquoi traverser ce désert les sirènes à fond ?
Tout cela donne l’impression que la légitimité se gagne d’abord au degré de nuisance sonore que vous saurez déclencher. Quand je rentre chez moi, enfin au calme mais les oreilles encore rouges d’avoir trop entendu l’affolement de ces gens importants, j’effleure une voiture et l’alarme qui monte soudain dans la nuit tombante me plonge dans un abîme de désarroi. Notre vie est si pleine de bruits inutiles.
Antoine de Baecque
[print_link]

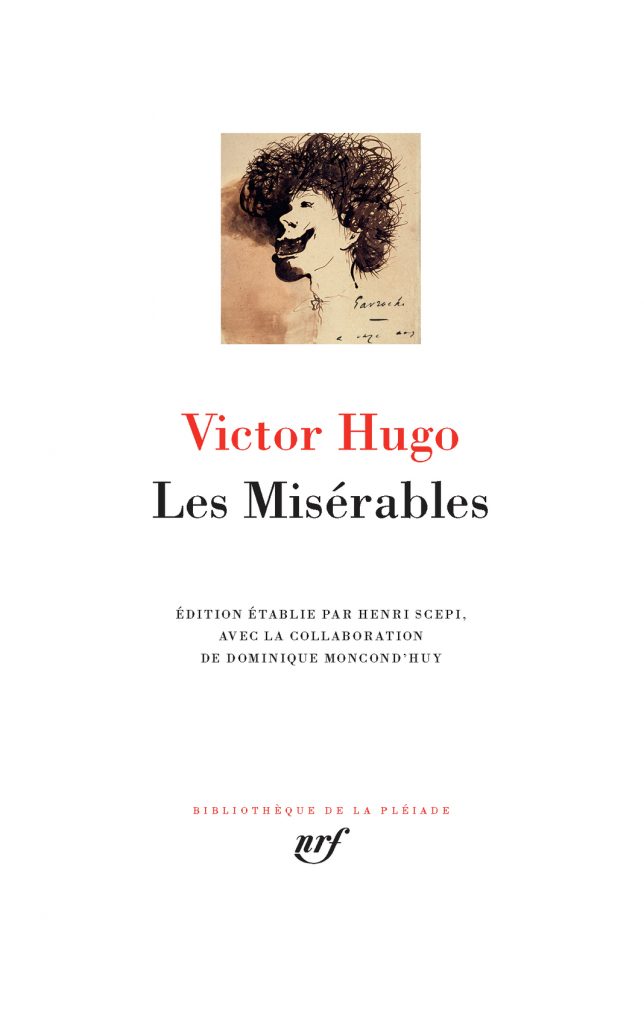







0 commentaires