La salle de la Fabrica n’a pas fait le plein, ce 4 juillet, pour le spectacle d’ouverture du festival d’Avignon. Les quatre heures vingt en polonais surtitré ont sans doute effrayé. Peut-être faudrait-il prévenir que la longueur d’un spectacle de Krystian Lupa n’a guère à voir avec l’expérience habituelle du temps. Même quand les silences s’y prolongent, l’intensité des sentiments et des situations y est telle que les aiguilles qui tournent, la suite de la journée, le monde extérieur, n’existent plus. Du théâtre de Krystian Lupa, quand il est réussi, on voudrait ne plus jamais ressortir parce qu’il touche à l’éternité et qu’il est infiniment supérieur à la vie. Jeune homme de plus de 70 ans, le metteur en scène polonais retrouve avec Wycinka Holzfällen, inspiré des Arbres à abattre de Thomas Bernhard, une ferveur et une rigueur dignes de ses spectacles les plus mémorables, dans la lignée des Somnambules, l’adaptation du roman de Herman Broch découverte par les spectateurs français en 1998 à l’Odéon.
Pour aborder le roman de Thomas Bernhard, règlement de comptes avec le milieu artistique viennois paru en 1984, Lupa dit s’être “enfoncé dans le récit jusqu’à ressentir les exigences des hommes et des causes”. Et c’est bien dans une exploration qu’il entraîne les spectateurs, s’enfonçant dans le roman comme en une forêt profonde, attentif à tout et surtout à ce qu’on ne voit pas du premier coup d’œil. Le livre de l’écrivain autrichien est le récit d’un “dîner artistique” chez les Auesberger, un couple d’artistes – lui musicien, elle chanteuse lyrique – autrefois amis du narrateur qui ne les pas revus depuis trente ans. Le prétexte de ces retrouvailles est l’enterrement de Joana, une actrice, leur amie commune, qui s’est suicidée. Chez les Auesberger, le narrateur retrouve le “fauteuil à oreilles”, “exactement ce même fauteuil à oreilles dans lequel j’étais assis presque chaque jour au début des années 50, et je pensais que ç’avait été une erreur magistrale d’accepter l’invitation des Auerbesberger”. Champion du monologue intérieur, héros bernhardien par excellence, il ressasse sa détestation envers ses hôtes, les autres invités et le monde en général, tandis que l’on attend pour passer à table un convive vedette, acteur au Burgtheater, qui doit venir au sortir d’une représentation du Canard sauvage d’Ibsen.
Ce narrateur, Krystian Lupa choisit de le confondre entièrement avec l’auteur – les autres personnages l’appellent soit “Thomas”, soit “Monsieur Bernhard” –, un parti pris qui se défend aisément. La dimension autobiographique des Arbres à abattre ne fait pas doute, Thomas Bernhard ne s’en est jamais caché, et au moment de la parution, le musicien Gerhard Lampersberger obtint même l’interdiction du roman, alléguant qu’il s’était reconnu dans le personnage d’Auersberger. Mais ce n’est pas cette dimension autobiographique et historique qui intéresse Lupa. Dans son adaptation en polonais, le Burgtheater de Vienne devient le “Théâtre national” et la soirée pourrait aussi bien se dérouler à Varsovie de nos jours. Le narrateur, d’autre part, au lieu d’occuper le devant de la scène, est le plus souvent relégué sur le côté et s’exprime peu. La phrase de Thomas Bernhard, obessionnelle, répétitive jusqu’au comique, est toujours là, mais plutôt comme le rappel d’un motif musical, au même titre que les autres mélodies qui rythment le spectacle.
C’est l’au-delà des mots qui intéresse Lupa. Et ce qu’il trouve en “s’enfonçant dans le récit”, c’est une fable politique d’une puissance inouïe sur le désarroi d’aujourd’hui. Dont le personnage central n’est pas l’écrivain atrabilaire, mais Joana, la suicidée, son geste révélant l’échec, l’amertume et l’impuissance de tous les autres.
Joana, les spectateurs la découvrent d’abord, sans savoir qu’il s’agit d’elle, dans un film projeté tandis qu’ils prennent place dans la salle. Une jeune-femme, actrice ou metteur en scène, répond à une interview, et il est question de son exigence – voire de son intransigeance – artistique, et des obstacles qu’elle rencontre pour travailler avec les acteurs du Théâtre national. Joana, on la retrouve dans d’autres images projetées durant la représentation, sur l’écran juste au-dessus de la scène, spectateurs et acteurs regardant alors, face à face, les mêmes images. Elle est la porteuse d’idéal, celle que le narrateur, quand il était jeune poète, appelait sa “princesse nue”, et qui a dégringolé dans l’alcool et la solitude, jusqu’à la pendaison, au petit matin. Celle aussi qui ne s’est ni reniée, ni vendue. Les autres invités du dîner artistique ne peuvent en dire autant, artistes officiels, ratés mondains, vieillis, vidés, pantins de ce qu’ils ont été, à l’image du compositeur Auesberger, pochtron ricanant qui finit par s’écrouler ivre mort. Les deux jeunes auteurs, renommés par Lupa Joyce et James, ne valent guère mieux, persifleurs obsédés par la réussite. Ce bal des grandes espérances perdues, ce dîner chez des Verdurin viennois de la fin du XXe siècle, Lupa l’orchestre, comme Thomas Bernhard, sur le mode de la colère, pas de la nostalgie. Le salon et la salle à manger des Auesberger tiennent dans un cube de verre, qui tourne à l’occasion, ramenant au premier plan des souvenirs et des lieux du passé. Et cette machinerie circulaire, dont le metteur en scène n’abuse pas, est comme le cercle infernal de l’impuissance toujours recommencée. Sans prise sur le monde, traîtres à eux mêmes, affalés sur les chaises ou le canapé, ils sont tous, d’une certaine façon, “sauvés” par la mort de Joana et par l’immense et stérile compassion qu’elle leur inspire. Mais aussi, de façon plus surprenante, par l’arrivée du comédien qui interprète Ekdal dans Le Canard sauvage, et que l’on a attendu jusqu’à minuit passé pour servir enfin à table le sandre du lac Balaton. Vieux cabot ridicule quand il commence à parler, il acquiert, à mesure que le désastre de la soirée se confirme, une hauteur de vue inattendue, le seul encore porteur d’une foi artistique, qui s’exclame, seul contre tous que “le monde est beau et bon”, transfiguré, écrit Bernhard, de “figure repoussante” en “homme philosophique”.
Rage, douleur et compassion, c’est en somme ce que le spectacle de Lupa prend en charge, et l’on peut en cela le rapprocher de l’Espagnole Angélica Liddell, trouver chez l’un et l’autre des résonnances catholiques. Avec chez Liddell le vertige du mysticisme, et chez Lupa, un constat plus désabusé : la vieille servante qui sert le dîner d’une main tremblante et renverse les plats dans la cuisine s’appelle Marie-Madeleine, et ne peut rien pour eux. Rage, douleur et compassion, c’est aussi ce que jouent merveilleusement les acteurs de Krystian Lupa, avec en prime, tout au fond du désespoir, la politesse de l’humour, noir mais pas cynique.
René Solis
Wycinka Holzfällen de Krystian Lupa, spectacle en polonais surtitré en français, au festival d’Avignon, La Fabrica, du 4 au 8 juillet à 15h.
Des arbres à abattre, de Thomas Bernhard, est publié chez Gallimard, coll. Folio, dans la traduction de Bernard Kreiss.
[print_link]








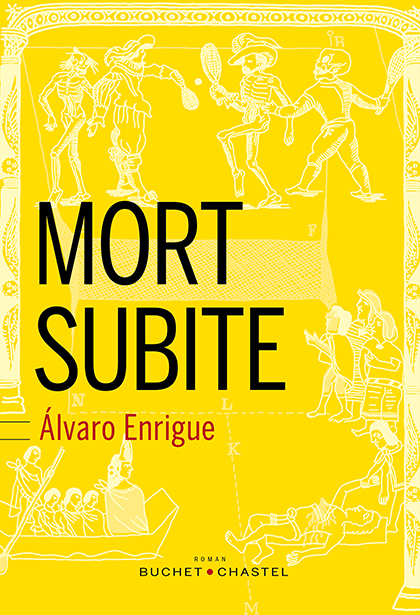

0 commentaires