À Pantin, la galerie Thaddeus Ropac présente “Space Age”, une exposition née du diagnostic d’un “intérêt renouvelé pour l’aventure spatiale”, dit le livret d’exposition.
“Space Age” s’ouvre un triptyque de l’artiste américain Jack Pierson, constitué par deux photographies suivies d’un assemblage de lettres en métal. La première photographie montre une mer sombre et un ciel encore pâle strictement distingués par la ligne que l’horizon tend entre eux. Cette ligne disparaît sur la seconde photographie : n’y demeure un ciel orangé occupé de nuages, l’élévation commence, les repères topographiques s’absentent. C’est alors que les lettres assemblées proclament : “Beyond the Pale”. Autrement dit, hors des limites, au-delà du territoire connu. Ce que l’on pourrait traduire, en langage NASA, par all engines running, lift off ! La Terre s’éloigne, l’exploration commence.
Certains artistes se passionnent pour l’espace en tant que tel, l’approchant au travers des images rendues disponibles par l’imagerie spatiale – citons, par exemple, le travail récent de Caroline Corbasson ou de Edouard Wolton. Cratères, explosions solaires, nuages d’étoiles : ils poétisent le matériau scientifique, exploitent ses ressources plastiques. Les artistes présentés dans “Space Age” s’intéressent à l’étape qui précède la production de ces images, leur thème est celui de la conquête spatiale et, plutôt que de regarder vers l’espace, ils se passionnent pour les technologies et les gestes mythiques qui permirent de le conquérir.
L’aventure spatiale commence en 1957, avec le lancement du premier satellite artificiel Spoutnik 1. Elle se poursuit jusqu’à aujourd’hui, mais on pourrait dire que sa première phase s’achève avec la fin de la guerre froide, lorsque la conquête spatiale se retrouve orpheline du contexte stratégique et économique qui légitimait son intensité.
Sur la trentaine d’œuvres exposées, deux seulement sont contemporaines de cette première conquête spatiale : Rocket de Richard Artschwager (1971) et le Monument for V. Tatlin de Dan Flavin (1967). Si d’autres artistes contemporains de ce moment présentent des œuvres, celles-ci sont souvent de facture récente : les toiles de James Rosenquist datent ainsi de 2013 et 2015 ; les fusains de Robert Longo, de 2015. D’ailleurs, la moitié des œuvres exposées date de 2015 et nombre d’entre elles sont signées par de (relativement) jeunes artistes tels Cory Arcangel, Jules de Balincourt, Tom Sachs ou Lee Bul.
On pourrait donc s’attendre à ce que l’“intérêt renouvelé pour l’aventure spatiale” diagnostiqué par “Space Age” fasse la part belle aux évolutions récentes de l’aventure spatiale. Il n’en est rien : récentes, ces œuvres sont pour la plupart rétrospectives.
Rien au sujet de Mars et rien sur Pluton, dont la surface vient pourtant d’être survolée par une sonde au nom révélateur de New Horizons. Les artistes de “Space Age” dédaignent les nouveaux horizons promis par les gesticulations actuelles de la NASA, et font plutôt retour sur des pas déjà anciens, ainsi cette lune en métal inoxydable (Moon, 2013) réalisée par l’artiste suisse Not Vital. Cet intérêt, qui se tourne vers un passé plutôt que de s’emparer d’un présent, atteste en creux le changement de statut de la conquête spatiale : fait de société à la fin des années 1960, fait-divers aujourd’hui. Au fil de l’exposition, l’âge spatial apparaît comme un temps révolu mais vers lequel on ne cesse de se retourner – et ce que l’on soit né en 1933 (James Rosenquist) ou en 1978 (Cory Arcangel) –, le temps des navettes, des vols habités et des objectifs Lune. L’effet rétro est parfois suraccentué, comme lorsque Stephan Balkenhol sculpte sur bois la fusée rouge et blanche imaginée par Hergé en 1953 (avant donc les premiers vols habités).
Dans “Space Age”, les artistes ne s’intéressent pas tant aux autres planètes et à ce qu’il s’y passe qu’aux moyens pour y parvenir. Le “Space Age”, c’est avant tout une figure – l’astronaute (magnifié dans les portraits au fusain de Robert Longo) – et un outil – le vaisseau.
Méticuleusement reproduit (la maquette en carton mousse de Tom Sachs) ou épuré (Sylvie Fleury, qui ôte à la fusée ses détails comme pour souligner ce que sa forme a de phallique), minuscule (la petite sculpture de Stephan Balkenhol) ou imposant (le Das Grab in den Lüften (The Grave in the Air), élevé par Anselm Kiefer), sculpté (cf. tous les exemples précédents) ou sérigraphié sur miroir (à l’instar du profil de Discovery qui se découpe sur le Roads (Shiner) de Robert Rauschenberg) : dans “Space Age”, le vaisseau est aussi présent qu’il est polymorphe.

Robert Rauschenberg, Roads (Shiner), 1992 © Robert Rauschenberg Foundation / VAGA, New York / ADAGP, Paris. Photo: Philippe Servent
L’écueil de la nostalgie enfantine pour les grosses machines et les costumes brillants était immense. L’exposition fonctionne parce qu’elle n’y sombre pas. Ce n’est pas un monde enchanté qui est ici présenté et le regard porté vers lui est rarement naïf ou apologétique (à l’exception peut-être des fusains de Robert Longo, au lissé ébloui d’images pieuses).
Deux œuvres rappellent ainsi la proximité entre industrie spatiale et industrie militaire, les conquêtes de l’une aidant celles de l’autre – aux États-Unis et en URSS, les premiers astronautes furent d’ailleurs recrutés parmi les pilotes de chasse de l’armée, car rien de tel qu’un militaire pour conduire un vaisseau. Cory Arcangel fait ainsi surgir l’image de l’avion de guerre soviétique MIG-29 qui, dans son installation, fend le ciel bleu et innocent d’un jeu vidéo. Avec Eye/Machine, Harun Farocki explore quant à lui les techniques de vision artificielles, outils nécessaires de l’exploration, mais qui peuvent aussi bien – lorsque l’œil de la machine se retourne vers l’homme – servir à la surveillance, à la traque ou à l’élimination.
Si l’on passe du temps dans “Space Age”, on comprend que l’exposition est pensée comme un dispositif à brouiller l’imagerie. Dans chacune des salles, l’enthousiasme explorateur est ombré par la présence de détournements possibles ou de catastrophes silencieuses – au premier rang desquelles, bien sûr, la chute.
Celle-ci est d’abord référée à un mythe, celui d’Icare, de son envol réussi, de son imprudence, de ses ailes de cire fondant à la chaleur du soleil. Patrick Neu accroche au mur deux ailes de cire, intactes, comme avant qu’Icare ne les chausse (chausse-t-on ou enfile-t-on des ailes ?, aucun dictionnaire ne donne de réponse), mais qui promettent la chute, comme si l’homme n’inventait des stratagèmes et des machines que pour mieux persister dans l’erreur qui le pousse à se rêver volant. Car seuls les anges volent sans risquent de tomber. Encore que… le Fallen Angel d’Ilya et Emilia Kabakov (uniques artistes russes de l’exposition), sorte d’ange trop humain, est écrasé au sol de la galerie (juste en face du MIG-29), une aile brisée, son corps recouvert d’un tissu comme d’un linceul dont sortent deux pieds enfantins et énormes.
Comme les Icares, comme les anges, les vaisseaux tombent aussi : l’ultime salle ménage un face-à-face époustouflant entre deux visions de la catastrophe spatiale. À droite, le tombeau aérien (Das Grab in den Lüften) d’Anselm Kiefer. Un vaisseau gris comme la pierre, dont la masse ne dissimule pas la fragilité, qui s’élève et qui penche au dessus d’un pavement de débris, tandis qu’à l’arrière plan est dressé un mur de cadres vides, brisés et maculés – ainsi que des icônes disparues. Délimitée par une mise à distance, l’installation est inaccessible, on ne la voit qu’à distance. À gauche, Aubade IV de l’artiste coréenne Lee Bul, éclatement de verre, de métal et de lumière, explosion suspendue dans les airs, entre les fragments de laquelle on peut circuler. Régulièrement, un mécanisme diffuse de la vapeur d’eau, et cette fumée qui est le signe de la catastrophe, accentue l’évanescence et la légèreté de la sculpture.
La pièce est prise dans l’équation que posent Das Grab in den Lüften d’un côté, et Aubade IV de l’autre. Pétrification ou explosion ; opacité ou transparence ; pesanteur ou légèreté ; clôture ou porosité… On pourrait poursuivre à l’envi ce jeu de contrastes et l’accumulation des différences ne ferait que souligner combien, par l’antithèse, ces deux installations parlent d’une même chose et se situent toutes deux à ce moment où le rêve spatial tourne au cauchemar. La tombe ou l’éclat signent, chacune à leur manière, dans le silence ou dans le bruit, la clôture de l’âge spatial.
Nina Leger
À voir jusqu’au 23 décembre 2015 : Space Age à la galerie Thaddeus Ropac, 69 avenue du Général Leclerc, 93500, Pantin. Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h.
[print_link]







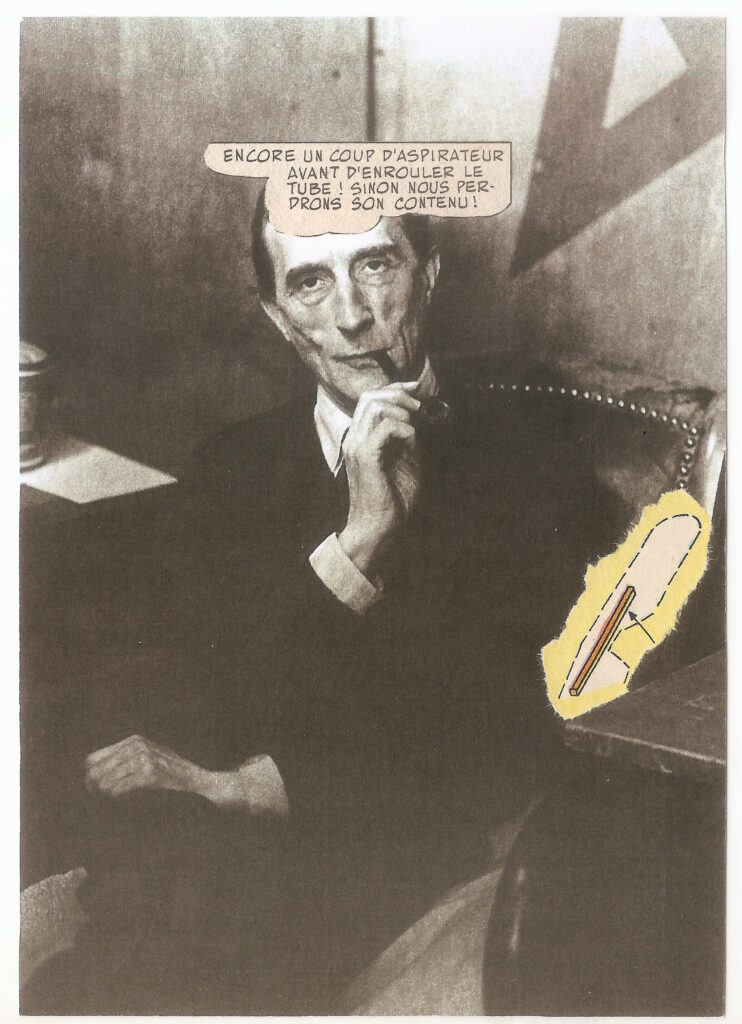



0 commentaires