“Le Nombre imaginaire” ou les mathématiques comme terrain de jeu où l’imagination seule fixe les limites.
La philosophie et les maths – en premier lieu la logique, mais pas seulement – entretiennent depuis l’antiquité des rapports passionnels aigres-doux, forgés d’amour vache, d’attentes mutuelles souvent excessives et donc insatisfaites, et de communication plus ou moins efficiente.
Le temps où le nombre, seule essence réellement immuable et divine, s’érigeait en système du monde est révolu ; la logique n’est plus le moteur du raisonnement que voulait Aristote et la philosophie naturelle est devenue science, avec son propre cheminement et ses propres buts.
Un divorce donc ? Peut-être, mais il faut bien garder les enfants, dont il existe pléthore. Les deux parents entretiennent donc une relation trouble, faite de rapprochements tactiques ou plus profonds, d’orbites excentriques, un « je te fuis tu me suis » permanent.
La science en général, et les maths en particulier, ne peuvent pas se passer d’une approche philosophique, en l’occurrence métaphysique. Nulle théorie mathématique ne peut rendre compte du vrai ; elle ne peut que rendre compte, et encore bien imparfaitement, de ses qualités internes de consistance (ne pas accepter de contradiction) et de complétude (savoir décider de la validité d’un énoncé). Le mathématicien a besoin, comme tout un chacun, d’outils différents pour décider ce qu’il croit – la théorie ne lui dira que ce qu’il sait, dont elle est le cadre arbitraire. On peut introduire des nombres infiniment petits ou grands dans l’arithmétique ; il est possible d’en donner une théorie cohérente, qui simplifie certains raisonnements. Ces nombres existent-ils pour autant « pour de vrai » ? On peut adopter ou rejeter l’axiome du tiers exclus en logique (et donc le raisonnement par l’absurde, comme on l’a vu) : y a-t’il une réalité objective que l’une ou l’autre théorie alternative représenterait au mieux ? Ou bien les maths créent-elles le monde sous leurs pas, et un nouvel univers pour chaque variante de l’arithmétique ou de la logique ? Ce ne sont pas les maths qui répondront à cela.
De même, le philosophe, fût-il normalien en lettres, tend souvent à rechercher, consciemment ou non, la symétrie, la concision, l’élégance formelle de la mathématique, quitte à en faire de merveilleux, poétiques et éclairants abus, volontaires ou non, sources en tout cas de rencontres improbables pour qui s’intéresse à ces deux champs de pensée. En voici deux exemples, au sein desquels ne figure pas le florilège d’interprétations philosophiques des théorèmes d’incomplétude de Gödel (vaste sujet, un peu tarte à la crème, mais qui méritera bien sa propre chronique).
L’excellent ouvrage de Francis Wolff, Pourquoi la musique ?, explore entre autres le paradoxe du fait que la musique a tous les attributs d’un langage – un lexique, une syntaxe, même une pragmatique… sans pourtant qu’on sache jamais de quoi elle parle. Wolf cite (sans totalement partager leur analyse) un certain nombre de philosophes, linguistes, musiciens ou musicologues pour lesquels, en essence, la musique est un langage qui est son propre signifié. Parmi d’autres cités, le linguiste Roman Jakobson : « Plutôt que de viser quelque objet extrinsèque, la musique se présente comme un langage qui se signifie soi-même ».
Vraie ou non, cette formule résonne avec force aux oreilles du mathématicien amateur ; car de fait, la mathématique peut se signifier elle-même ou peu s’en faut. C’est même le cœur de doctrine d’une branche appelée métamathématique, dont les objets d’intérêt sont les expressions mathématiques elles-mêmes. Le philosophe parlera de la transcendance du signifiant sur le signifié ; le mathématicien ou l’informaticien parleront de méta-langage, un langage qui manipule et décrit les constructions d’un langage de niveau inférieur. Il existe, par exemple, un langage appelé UML, utilisé par les concepteurs pour modéliser la conception des systèmes informatiques. Ce formalisme permettant de créer des modèles, on l’appelle donc un méta-modèle. Il est lui-même décrit par un méta-modèle de niveau supérieur (répondant au doux acronyme de MOF) qui a, lui, la propriété d’être son propre méta-modèle : il peut décrire ses propres concepts sans apport extérieur. Comme la musique, le MOF est son propre signifié. Quels rapprochements inédits pourraient résulter d’une exploration plus approfondie de cette analogie ?
Un autre et fort bel exemple de possible fertilisation croisée entre les maths et la philosophie m’est inspiré par le toujours indispensable livre Le Capitalisme est-il moral ? d’André Comte-Sponville. Ce dernier remet au goût du jour la notion de distinction des ordres due à Pascal. Les concepts manipulés par le raisonnement doivent être séparés en plusieurs ordres hiérarchisés, et le raisonnement sain doit éviter d’utiliser les outils conceptuels d’un ordre pour s’attaquer aux problèmes d’un autre. Pascal distingue trois ordres (celui de la chair, celui de l’esprit, celui du cœur) ; Comte-Sponville en propose quatre. Le premier ordre touche à la nature, aux faits, et s’intéresse à la vérité des énoncés ; l’auteur y place aussi la technique et l’économie. Le deuxième touche à la politique, aux lois et au gouvernement, et s’intéresse à ce qui est socialement souhaitable ou non. Le troisième touche à la morale, et s’intéresse au bien et au mal. Le dernier, ordre spirituel pour Pascal et d’amour pur pour Comte-Sponville (athée spiritualiste), touche à la transcendance et s’intéresse à la raison d’être. Ces ordres sont autonomes, obéissant chacun à sa logique interne, et Pascal appelle tyrannie le fait d’en privilégier un dans le but de gouverner les autres.
Comte-Sponville nous explique fort clairement qu’utiliser les outils d’un ordre inférieur pour résoudre les questions d’un ordre supérieur est une erreur qu’il appelle barbarie. Prétendre régenter les questions du socialement désirable à partir du fait technique ou économique (« There Is No Alternative ») est par exemple une forme de barbarie technocratique. Prétendre régenter le bien et le mal depuis la sphère politique ou légale (« c’est légal donc je suis moralement couvert »), ou décréter la spiritualité ou l’amour à partir de la morale (« il est bien de croire, donc crois ; il est bien d’aimer, donc aime ») en sont d’autres formes. De même, traiter de l’ordre inférieur avec les concepts de l’ordre supérieur est une autre erreur appelée angélisme. Il est angélique de croire que la foi ou l’amour entrainent la morale ; que la morale dicte les décisions politiques ; ou que la volonté politique peut aller à l’encontre des faits.
En dehors de l’éclaircissement intellectuel, de la saine leçon de pensée qu’apporte ce référentiel à tous, le mathématicien amateur en appréciera particulièrement l’élégance formelle. Cependant, une pensée parasite le titille ; car le mathématicien n’aime pas trop les contraintes arbitraires ni les opérations interdites. Pourquoi, se demandera-t-il, quatre ordres et pas plus ? N’y a-t‘il rien en dessous du premier, ni au-dessus du dernier ? Ne peut-il y a avoir un angélisme technique ou une barbarie spirituelle ?
Une idée qui lui vient assez naturellement est alors de refermer les ordres en cercle qui se mord la queue, et de considérer que l’ordre spirituel est lui-même soumis à l’ordre naturel (ce qui, par ailleurs, est a minima évocateur). Dans ce cas, il est possible d’exhiber un angélisme technique, par exemple en prétendant prouver ou infirmer l’existence de Dieu à partir de l’expérience ou du raisonnement ; ou une barbarie spirituelle qui prétend dicter le vrai par la foi (ce dont nous ne sommes que trop témoins). Nous voici avec un système clos, complet, dans lequel on est toujours le barbare ou le naïf de quelqu’un… et qui n’est pas sans rappeler celui de l’arithmétique Shadok, ce qui me paraît une salubre leçon d’humilité !
Yannick Cras
[print_link]




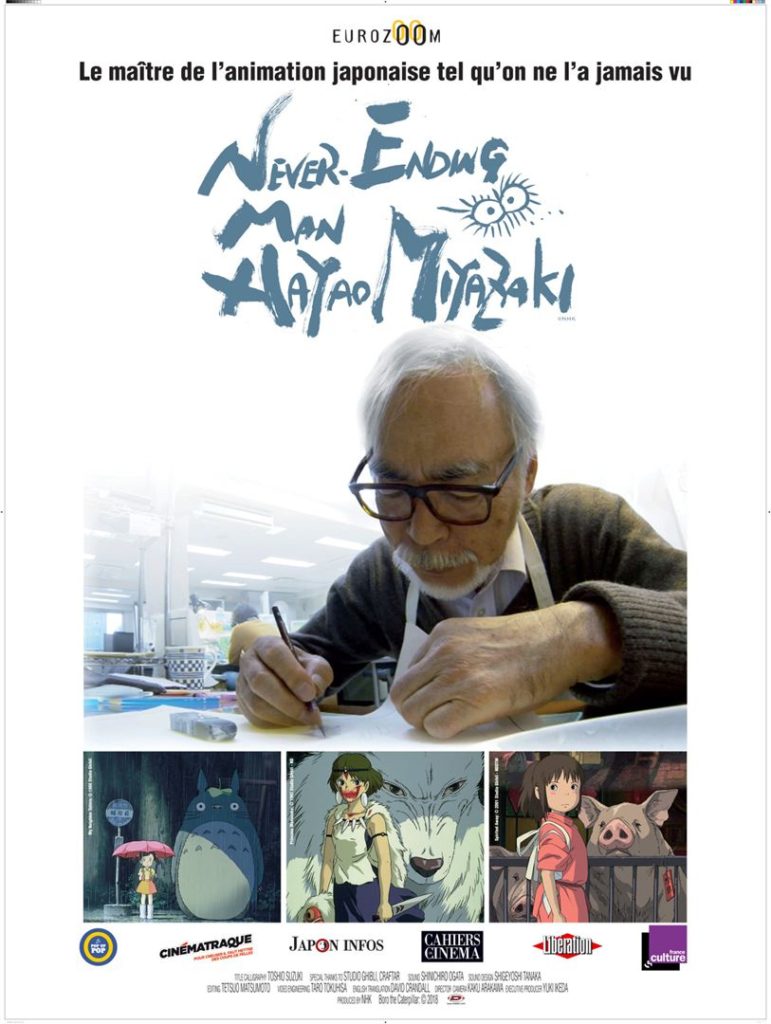



0 commentaires