« Diogène en banlieue » : Heurs et malheurs d’un prof de philo aux confins du système scolaire.
Aidé par un vent mauvais, l’incendie avait ravagé les trois quarts du lycée. Les élèves ainsi que leurs professeurs furent contraints à nouveau de prendre des vacances. Les contractuels étaient discrètement licenciés, les personnels techniques affectés dans d’autres établissements.
Une fois n’est pas coutume, le rectorat mit les bouchées doubles pour reloger les quelques mille élèves que le feu avait éparpillés dans la nature. Quatre semaines plus tard, au début du mois de mars, nous emménagions dans des containers installés en hâte à la sortie de la ville, sur un terrain vague, au milieu de nulle part. L’endroit était d’autant plus sinistre que nous étions encore en hiver, un hiver particulièrement rude et tenace cette année-là. Quand il ne neigeait pas, c’était une pluie glaciale qui détrempait la route de notre nouvelle école. Le macadam défoncé en plusieurs endroits interdisait aux cars de ramassage scolaire de venir jusqu’à nous. Les élèves, qui terminaient le chemin à pied, arrivaient crottés et gelés dans les salles de classe, d’immenses boîtes en métal où on avait en hâte découpé quelques ouvertures à coup de chalumeau.
Ce n’était pas le pire. Deux jours à peine après notre installation, le système électrique rendit l’âme. Il fallut enseigner dans le froid et à la bougie. Les professeurs se montrèrent héroïques durant presque trois semaines, travaillant les mains gantées de moufles, la tête couverte par un épais bonnet polaire, les épaules emmitouflées sous plusieurs couvertures. De leur côté, les élèves peinaient à prendre en note leurs cours tant ils avaient les doigts ankylosés par le froid sibérien. Avec cela, bien sûr, les programmes n’avançaient pas.
 Je me montrai moins courageux que mes collègues et je ne pus résister bien longtemps à ce régime militaire. Je décidai rapidement d’emmener chaque semaine mes terminales voir un film au Cinéclair, un ancien théâtre de centre-ville réaménagé en salle de cinéma. Mon élève Adélaïde afficha d’abord sa réprobation. Est-ce que c’était bien sérieux de partir au ciné quand on avait tout un programme à traiter ? Je lui répondis qu’on pouvait également s’instruire en découvrant une œuvre d’art. Je restais dans les clous. Mon argument fut jugé convaincant. Le Cinéclair passait d’ailleurs cette semaine-là Les Temps Modernes. Puis la salle était très bien chauffée : c’était le meilleur argument.
Je me montrai moins courageux que mes collègues et je ne pus résister bien longtemps à ce régime militaire. Je décidai rapidement d’emmener chaque semaine mes terminales voir un film au Cinéclair, un ancien théâtre de centre-ville réaménagé en salle de cinéma. Mon élève Adélaïde afficha d’abord sa réprobation. Est-ce que c’était bien sérieux de partir au ciné quand on avait tout un programme à traiter ? Je lui répondis qu’on pouvait également s’instruire en découvrant une œuvre d’art. Je restais dans les clous. Mon argument fut jugé convaincant. Le Cinéclair passait d’ailleurs cette semaine-là Les Temps Modernes. Puis la salle était très bien chauffée : c’était le meilleur argument.
L’hiver s’éternisait. À la fin du mois de mars, il gelait encore à pierre fendre. Mes collègues jetèrent l’éponge et vinrent peu à peu me rejoindre au Cinéclair avec leurs classes. Le directeur de la salle se frottait les mains. Il n’avait jamais connu pareille affluence en matinée. Notre proviseur tenta de nous rappeler à l’ordre. Nous avions une mission de service public, nous étions des vocations. Personne ne l’écouta. Comme son logement de fonction avait brûlé dans l’incendie du lycée, le pauvre homme ne savait où aller. Il passait son temps entre la mairie, le rectorat et le ministère d’où il se faisait régulièrement chasser. De guerre lasse, il voulut lui aussi nous rejoindre au Cinéclair, mais il fut accueilli par des huées. Il disparut et nous n’en entendîmes plus jamais parler.
La malchance nous poursuivait. Alors que le froid commençait à peine à se retirer de la région, une tempête violente et quasi tropicale balaya le pays d’ouest en est sans épargner bien sûr nos baraquements pédagogiques que le vent arracha en plein jour comme de simples fétus de paille. Dans notre malheur, une bonne étoile nous guidait cependant puisque nous avions ce jour-là, comme les précédents, emmené les élèves au cinéma, leur sauvant la vie à tous, et à nous également. Le lendemain, au milieu d’un paysage de désolation, le Maire vint en personne nous féliciter pour notre initiative. La République, nous dit-il, était fière de ses professeurs.
Nous n’avions plus de lycée, nos baraquements s’étaient envolés et le bac approchait. Les élèves eux-mêmes réclamaient des cours. Ils regrettaient l’école ! Tony, la professeure d’arts plastiques, eut alors l’idée d’utiliser le Cinéclair comme salle de cours. En occupant le cinéma du matin jusqu’en fin d’après-midi et en nous relayant sur l’estrade, nous pourrions arriver à boucler nos programmes d’examen, au moins dans leurs grandes lignes. Le directeur de la salle accueillit cette proposition avec circonspection. N’allait-il pas perdre de l’argent ? Après une longue discussion, mes collègues et moi-même tombâmes d’accord pour organiser une quête. Nous ne voulions pas spolier le directeur du cinéma. Nous ne voulions pas non plus être jetés à la rue. Les parents d’élèves furent les premiers sollicités : les plus riches payeraient pour les plus pauvres. On s’adressa ensuite à la paroisse, à la mosquée, la synagogue et au temple qui acceptèrent aussi de nous aider, bien que leur obole fût souvent plus symbolique qu’autre chose. Seul le rectorat refusa obstinément de nous donner le moindre picaillon, nous rappelant le principe de la gratuité de l’école. Puis le recteur nous fit savoir qu’il désapprouvait notre projet de cours au Cinéclair. Pourquoi pas aux Folies-Bergères ? aurait-il lancé à l’issue d’une réunion avec le sous-préfet. Sollicité, le Ministère de l’Éducation nationale refusa de nous répondre. En haut lieu, on préférait nous ignorer. Rendue furieuse par l’attitude du Ministre, la professeure de maths se risqua jusqu’au palais de l’Élysée où elle voulut faire du ramdam. Equipée d’un mégaphone emprunté à un ancien représentant de la CGT et armée d’une pancarte bricolée en hâte, elle commença à défiler sous les fenêtres du Président de la République en hurlant différents slogans. Un lycée pour nos élèves ! Des cours de maths pour tous ! République la honte ! Elle fut rapidement ceinturée par quatre gendarmes mobiles et traînée dans une prison où elle croupit encore à l’heure où j’écris ces lignes. On ne badine pas avec l’État, dit la prof de français quand elle apprit l’arrestation de notre collègue.
Gilles Pétel
Diogène en banlieue

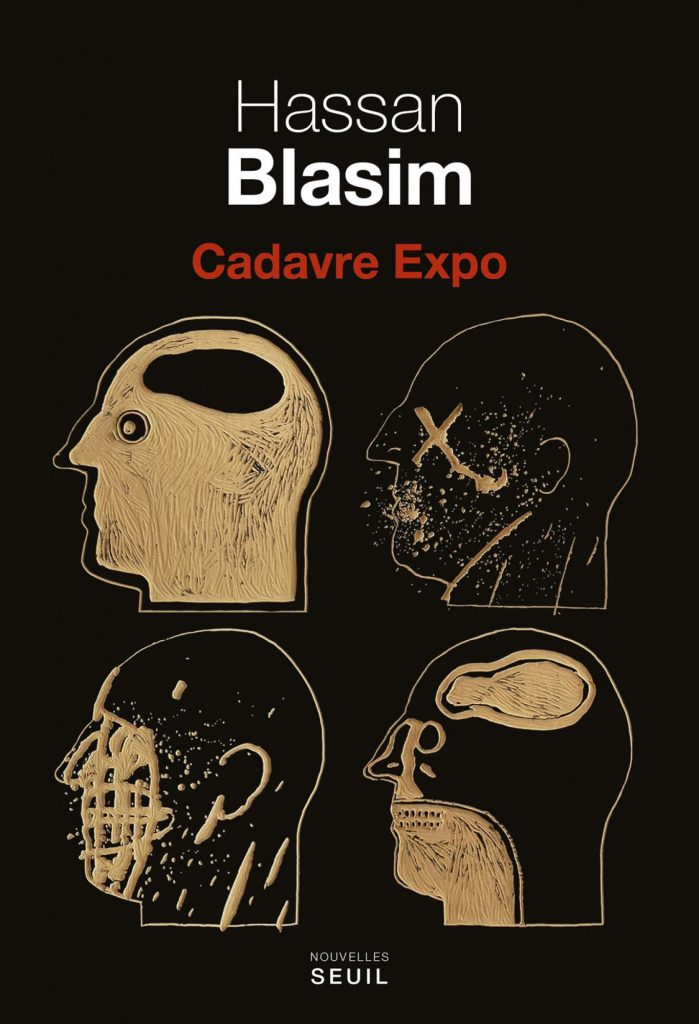






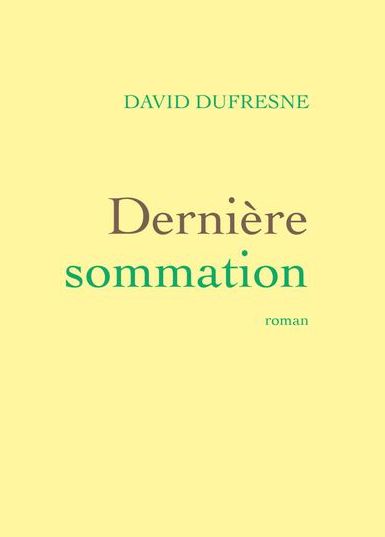
0 commentaires