Cartografía de lo invisible rend visible des zones de tension en redessinant Arequipa – ville natale du poète péruvien Robert Baca Oviedo (*1986) – depuis l’Europe et surtout la France. Cette distance géographique entre l’écrivain et l’objet de son écriture le conduit à charger l’exercice cartographique d’une mémoire à plusieurs facettes. Cette mémoire, c’est celle des femmes victimes de la campagne de stérilisation forcée entre 1996 et 2000, pendant les années Fujimori, celle des victimes de la tragédie du pont Grau à Arequipa, où trente personnes trouvèrent la mort dans la nuit du 14 au 15 août 1996 suite à un accident pyrotechnique, celle des victimes de l’accident du vol 251 de la compagnie Faucett, toujours en 1996. Les drames qui ont eu lieu ailleurs parviennent jusqu’à la ville blanche, retransmis par la télévision puis sur Internet; ils s’introduisent dans les foyers, marquent les esprits. Robert Baca Oviedo a huit ans quand Mónica Santa María, présentatrice phare du programme pour enfants Nubeluz, se suicide; il prend alors conscience de la mort et, plus tard, lui dédie un poème. Il en écrit aussi sur l’attentat du Wall Trade Center, la guerre en Irak, ou la nuit du Bataclan [voir poème au bas de l’entretien], engage une réflexion sur l’urgence écologique et climatique. Adressés à sa mère, à son grand-père José Manuel, à Mónica Santa María ou à Atahualpa, ses écrits vont et viennent entre l’intime et le collectif, pour constituer une mémoire à la fois personnelle, nationale et globale.
L’une de ses interlocutrices poétiques, présente tout au long du recueil, est là dès la couverture. Elle est tantôt Marianne (tel quel, en français), tantôt Madame, mettant par ricochet l’accent sur l’échec de la construction d’une nation péruvienne égalitaire, libertaire et fraternitaire, deux cents ans après l’indépendance du Pérou.
Plusieurs temporalités, lieux et cultures se croisent, cohabitent et se superposent. Arequipa se transforme en point de départ pour donner voix – pour cartographier – des conflits aussi bien locaux que globaux : le recueil dénoue ainsi les connexions invisibles mentionnées dans l’épigraphe de César Calvo qui ouvre le livre : « ¿No ves que no existe la casualidad? Todo, siempre, ha de esconder su relación con todo. Solo hay que merecer para poder descubrir el nexo oculto, los resortes oscuros, el hilván invisible de las cosas y de los hechos y de las personas ». [« Tu ne vois pas que le hasard n’existe pas ? Tout, toujours, cache sa relation avec tout. Il faut seulement le mériter afin de pouvoir découvrir le lien caché, les ressorts obscurs, le point de bâti invisible des choses et des faits et des personnes »]
♦
Entretien avec l’auteur
Cartografía de lo invisible est un recueil dense, qui a été pensé et (re)travaillé pendant des années. Combien de temps y as-tu passé et quelles ont été les étapes de son écriture?
Cartografía de lo invisible est un livre qui m’a coûté pratiquement huit ans d’écriture, c’était un texte très difficile à réaliser. Tout d’abord, je pensais cartographier la ville d’Arequipa (au sud du Pérou), mais quand j’habitais là-bas, c’était difficile, je manquais de distance, surtout pour la regarder de façon globale, avec ses contradictions. Quand je suis arrivé en France, le projet a continué et j’ai commencé à l’envisager d’une façon plus globale. En même temps, je commençais à me rendre compte qu’Arequipa était plutôt un point de départ pour réfléchir sur la situation au Pérou et sa relation avec le continent latino-américain. Et il y avait aussi un conflit personnel, ma relation avec le Pérou alors que je vivais ici en France. Donc tout cela a fait qu’au final, le regard de Cartografía de lo invisible est plutôt le conflit qui existe, c’est-à-dire les tensions qui existent, entre Arequipa – dans mon cas, c’est le point de vue local –, et Paris, qui, dans mon cas, est le point de vue global.
Parlons de la conception du temps dans le recueil. Le premier poème commence par : « en la noche 2 mil de la Yareta / es decir, la noche anterior » (À la deux millième nuit de la Yareta, c’est à dire la nuit dernière) et plus loin : « cuando nuestros padres eran vistos como esqueletos de maíz » (quand nos parents étaient vus comme des squelettes de maïs). En même temps, il est aussi question du World Trade Center, des attentats à Paris… et le recueil se termine sur un prélude, qui normalement ouvre une œuvre et ne la referme pas…
La conception du temps était compliquée, car il s’agissait pour moi d’une cartographie de la ville, c’est-à-dire une cartographie au sens proprement géographique. Puis, je me suis dit : ah, ce n’est pas du tout seulement géographique – il ne faut pas séparer le temps de l’espace. Donc, étant plus proche des années 90 – d’ailleurs, tous les faits historiques mentionnés se sont passés dans ces années-là –, j’ai pris comme point de départ ma date de naissance qui apparaît dans le poème sur mon grand-père, quand la comète de Halley passe – il me disait toujours : tu es né quand la comète de Halley est passée. La temporalité va donc de 1986 à 2019, avec l’incendie de Notre-Dame. À ce moment-là, il y a aussi eu les incendies en Amazonie, la crise du covid… Mais la plupart des poèmes, sans mentionner de façon explicite tel ou tel événement historique, interrogent l’histoire du Pérou depuis la colonisation, l’indépendance et la période républicaine jusqu’à nos jours. Et finalement, le poème sur Juan Santos et « Preludio » se penchent sur une Apocalypse possible, une temporalité future.
Cette même superposition de temporalités transparaît dans le travail sur la langue: des occurrences coloniales, comme « deste », « l’escarcha », des mots quechua (Wiñapu), ou encore des néologismes comme « Fujishock ». Ces interventions linguistiques sont l’occasion d’une condensation poétique, et en même temps, elles sont peut-être le miroir de la complexité de la société péruvienne ?
J’ai essayé de créer une voix poétique ancrée dans le présent, mais qui condense différentes temporalités. Ce voyage d’Arequipa à Paris m’a poussé à interroger toute ma vie, mais toujours en lien avec les événements historiques – et pas seulement ceux que j’ai vécus. Je suis le produit de différentes temporalités et d’événements qui me renvoient aussi à l’histoire de ma ville, à l’histoire de mon pays. D’où le choix de la citation de César Calvo comme épigraphe : il n’y a pas d’écrivain qui parle seulement de ses sentiments ou de son vécu. Les paroles d’un écrivain sont toujours liées à l’Histoire.
Il y a un intéressant travail sur la polyphonie: d’un côté, une intertextualité ouverte – par les références en notes de bas de page – ou cachée, qui établit un riche dialogue avec la poésie (péruvienne); d’un autre côté, d’autres voix, inscrites en italique. Qui sont ces voix ?
On a une tendance à penser que la poésie est l’expression de la représentation d’un jardin secret. C’est-à-dire que le poète parle de son expérience intime. Or j’ai cherché à éviter le moi et à établir au contraire une voix polyphonique, ce qui permet aussi de marquer une distance. Je ne voulais pas écrire un livre qui interroge la situation de mon pays, de ma ville et aussi du monde d’un point de vue individuel, mais devenir un médium de ces voix qui ne sont pas représentées.
Vocabulaire de l’écriture filmique, visualisation de la touche delete (dans le poème à Mónica Santa María), du bouton pause, présence d’images dans le texte… Dans quelle mesure la technologie ou les médias ont-ils influencé ton écriture ?
Je n’aurais pas pu faire ce livre sans la présence d’internet et de la télévision. La télévision, les années quatre-vingt-dix, la transition vers Internet… Les médias ont aussi déformé la vision que nous avons des villes. Les médias n’informent pas (toujours), ils déforment plutôt. Pour moi, il était intéressant de jouer avec cette déformation.
La religion aussi est omniprésente, qu’il s’agisse de références aux fêtes religieuses, aux saints, aux églises d’Arequipa (qui plantent le décor), ou d’un point de vue plus radical, quand la religion se confond avec la politique, quand la corruption s’en mêle… Tu proposes même une prière, la « Oración a Juan Santos Atao Wallpa o la subversión de lo invisible (Prière à Juan Santos Atao Wallpa ou la subversion de l’invisible)…
À Arequipa la religion est omniprésente. Je viens d’une famille très catholique. Il y a, à l’intérieur du recueil, trois poèmes qui fonctionnent comme des colonnes, correspondant au jeudi, au vendredi et au dimanche de la Semaine Sainte. Chaque fois que je corrigeais le texte, j’étais influencé par la religion, mais il s’agit plutôt d’une influence culturelle, pas vraiment d’une allégeance à l’institution catholique. Oui, tout est lié à la politique… et les festivités de ma ville se structurent toujours autour de la religion.
Lucía Méndez Soria, tu es en train de traduire ce recueil en français. Quelles sont les particularités de cette traduction?
Pour l’instant, je n’ai traduit que quatre poèmes, mais le projet est de traduire tout le livre. Je signalerai deux défis: les mots soi-disant intraduisibles, mais qui, en fait, ne le sont pas ; les mots qui viennent du quechua ou les mots dont on se dit, au premier abord, comment vais-je faire? car il s’agit de spécificités culturelles ou historiques du Pérou. Et puis aussi la syntaxe, les coupes, les chevauchements. Parfois, il faut changer l’ordre pour que cela ait du sens en français. J’ai aussi appris quelque chose: la langue française est bien plus souple qu’on ne le croit. Souvent, quand on traduit de l’espagnol vers le français, on pense que le français, plus rigide, n’admettra pas ça. Et finalement, ce n’est pas vraiment le cas.
Robert Baca Oviedo est né en 1986 à Arequipa. Bien qu’il ait commencé à écrire très jeune, il affirme lui-même que le poète Robert est né pendant les années d’université, pendant ses études de littérature et linguistique à l’université nationale de San Agustín. Après avoir travaillé plusieurs années à l’Alliance Française à Arequipa, il vient en France et suit d’abord des études de master en espagnol à la Sorbonne Nouvelle, puis à l’EHESS. Actuellement, il prépare une thèse de doctorat sur les relations entre littérature et arts visuels dans l’Amazonie, à la Sorbonne Nouvelle. Il a publié les recueils de poèmes Ideograma (2006), Poemaoffroad (2010). La publication de Cartografía de lo invisible a été précédé par trois artefacts poétiques : Carta para Mónica Santa María (2017), Una procesión al interior del útero de la Marianne o simples cartelazos desde la república de repúblicas (2018) et Oración a Juan Santos Atao Wallpa o la subversión de l’Invisible (2019).
L’entretien a été réalisé dans le cadre du projet 1 bouquin 1 vin.
13/11
Pour Victoria et Lucía Feldman.
Pour ma famille parisienne.
13/11. Vendredi, 2015. Les métros sont intempestivement des cocons métalliques
des bulles en laiton
explosant
dans ce sérum intraveineux qu’est Paris
21h50.
Il paraît que
des corps tombent
sur les carreaux des bars,
il paraît que
la lumière invisible de la mitraille
distribue son aveugle et juste verbe
peu importent
ces figures de fumée
que l’horreur détache
peu importent
aussi
l’origine de leurs cris
ou le fouillis bleu des derniers souhaits
qui partent comme des sillages de vapeur
vers ce paysage estompé
par les nouvelles
encore moins
importe
l’existence d’une capsule spirituelle
qui les contient
ou qui les a contenus au dernier instant
du feu,
le feu
ou cette distinction de visages
que nous nous entêtons à distinguer
dès la sortie du soleil quotidien
vers le dernier rugissement de la nuit.
Maman, je vais bien,
mais j’ai peur de sortir
de laisser que les rues voient
cet ambre lumineux
qui concentre, instable, mon désespoir
comme une énorme fleur
sur le point d’éclater entre mes seins.
Ouvrir,
alors,
la fenêtre de ces quatre murs qu’est mon angoisse
maman, j’ai de l’angoisse
juste ici
touche
et aussi
dans cette petite fenêtre que j’ouvre à côté de ma tempe
pour éviter que le réel dépasse
ses limites
et laisser que les bêtes de l’hiver rentrent
et envoient dans l’air, comme moi,
les assiettes,
les tasses de café, l’avenir
et ses lectures imprédictibles,
les feuilles que j’arrache aux libres
dans mes moments de furie,
les notes de cet agenda strié
qu’est mon corps,
une représentation involontaire de l’esprit
des gribouillages de matière obscure
que peu à peu
la lumière
trace sur nous,
Maman, j’ai peur de sortir,
les gens sont fous là, dehors,
ils nous envahissent comme les cauchemars que nous passons
l’une à l’autre depuis l’époque des Néandertaliens,
Maman,
je n’irai plus jamais à un récital
je ne mettrai plus les pieds dans les salles de concert
je ne me promènerai plus en silence, ma cannette de bière à la main
à l’intérieur des jardins, devant les façades d’une cathédrale quelconque
si confuse mais observée toujours
avec les yeux empruntés de l’harmonie et du volume,
je laisserai derrière moi les avenues industrielles
où je me promène si souvent avec Roberto,
je migrerai inoffensive avec les indices que laisseront
ces oiseaux de l’incertitude,
je m’envolerai, je flânerai défunte entre la brume,
je me dissiperai comme les cendres de cette cigarette que je ne sais pas fumer
les cendres de nos ancêtres
volant parmi d’autres cendres,
des résidus d’étoiles qui se désintègrent
comme des muscles, des os et des vêtements
au cœur des chaudrons
après les chambres à gaz
la fumée
le feu de camp,
la suie,
collée à la neige
et encore de la neige
qui tombe sur ces champs si blancs
décolorés par quelque
cheminée
83, Boulevard Ornano, 23h
Des sons bleus traversent la frontière en direction de Saint-Denis. Nous avons vu ces visages déformés par l’horreur, leurs mâchoires déboîtées par la voltige des douilles automatiques sur internet, à la radio, dans la rue et dans nos ouïes. Mais ces mêmes visages craquelés par la panique, je les ai vus avant, longtemps avant, comme s’ils étaient des tubercules déformés par leur soudaine putréfaction sur les trottoirs, je les ai vu rouler, tourner sans fin sur leurs propres axes, étirer avec désespoir leurs peaux comme s’il s’agissait d’une épluchure cuite par la chaleur
par un magma
ou par des mouvements telluriques
sous ces villes
qui s’érigent et se détruisent
simultanément
dans nos poitrines
Moi, en revanche,
je les ai vus aux périodes de crise,
les casserolades à l’ordre du jour
la lente récession faisant exploser
en mille morceaux les télévisions
et
les mères
griffant les portes des banques,
te rappelles-tu, maman, l’argent,
le voyage vers l’Orient
à travers le fleuve
pour récupérer la dignité
par une poignée de dollars,
et c’est moi qui ai porté le poids
de tout cela
la folie du naufrage
tandis que
le soleil s’enfonçait
sous les eaux
d’un drapeau bleu clair
et c’est moi qui ai dû
mordre le vide de l’atmosphère
pendant que les avenues
se remplissaient de rats
comme les marchés se remplissaient de monde,
les rats des rêves,
le rêve
rongeant
un autre rêve,
Maman, arrête,
fiche-moi la paix,
je-suis-ex-te-nuée,
lais-se-moi-vi-vre
je viens d’ouvrir le thorax de ce matelas
et je suis plongée dans un sommeil delta,
Maman,
je suis pelotonnée dans cet utérus,
cet utérus improvisé
le mien il brûle, il s’embrase
comme des boules de feu
qui incendient les navires de Brueghel
ou cet enfer
dans les obscures maisons de Bosch,
les enfers que nous avons subis
à travers une odyssée
jamais racontée par nous
et je veux seulement dormir et imaginer
qu’un endroit, n’importe quel endroit,
sauf celui-ci,
peut être une cage humaine
où l’Invisible nous laisse mourir
(de faim)
un corral
un fossé
qui nous sépare de la vie
tout sauf ici
de ce côté de l’Atlantique
tout sauf ici, à Paris
ici où les cartes à jouer de la mort
se promènent au hasard
sur toutes les terrasses,
sur tous les canaux,
sur toutes les ruelles
jusqu’à tomber finalement
sur toi
sur moi
sur nous
Nature et culture vivante
Le sol engloutit les tours des cathédrales au sud du Pérou et cette grille faite pour le sapiens-sapiens devant la mesure illimitée de son désir. 23 juin, sud du Pérou. La mastication de cette bouche souterraine avant que le soleil andin n’atterrisse pour la première fois sur la terre. Et dire que l’image d’un mur, s’écroulant à l’intérieur de nous-mêmes, on la ressentirait mille et une fois de plus au long de la fragile architecture de nos vies. Buenos Aires, décembre 2002, un an après. Et dire que la marque de la Bête rien ne l’effacerait jamais : ni les pains que nous conservons avidement pour mai ni ces billets qui s’érodent maintenant dans l’humidité d’une cuisine, ni la terreur d’être une horde face au blindage des machines qui, sans devenir des arbres, continueront à se défaire de ces fruits, des jouissances subtiles et la frustration de ne pouvoir jamais les atteindre. Et que faire de ces cris, de ces famines et de ces pommettes que nous avons vues, brûlées par la lumière du soleil des cordillères ou de la pampa, que faire de ces cassettes qui ont enregistré non seulement ce côté du monde, mais l’incendie des villes : Madrid, New York et Bagdad, ou d’autres déjà invisibles, devenues maintenant de lents ruisseaux de sang, sous les yeux et la patience des traits qui illuminent les écrans
de toute entité qui éteint
réinitie
cette grande mise en scène
nommée
Orbe
Premier Orbe
Maman,
je suis sortie dans la rue
comme si je suivais la traînée
que la pluie laisse
aux touareg
dans le désert,
je suis sortie
cherchant à
passer inaperçue
comme ces taches
imperceptibles
que laisse l’automne
sur les fenêtres,
Maman,
je suis sortie dans la rue
cherchant quelque chose
que je n’ai jamais eu,
cette couleur
qui ne s’ajuste pas
à la lumière
projetée
depuis mes yeux
vers l’ignorance trouble
des objets,
je suis sortie
chercher aussi
la forme craquelée
de tes rides
paissant lentement
dans cette géographie future
qu’est mon visage,
Maman,
je suis sortie
chercher la douleur
ou quelque chose de semblable
au moment où nous nous arrachons
les croûtes
sans attendre
qu’elles tombent par
elles-mêmes,
Maman,
je suis sortie chercher
mon autre moi dans Paris
celle qui est une croûte
des épluchures de peau
du tissu mort
palpitant
sur du tissu vivant,
des croûtes
enveloppant
d’autres croûtes
qui se pulvérisent
à mesure
que la nuit
se dilate
dans le reflet
d’infinis cristaux
éclatés
maintenant
pour toute revendication divine
des corps
qui tombent
sur ce vendredi de misère
sur les dalles,
Maman,
j’ai ouvert ma poitrine
pour que cette ville
soit aérée par la pluie
et j’ai laissé
que la palpitation thanatique
de mon utérus
ne provoque qu’une
lévitation
encore une fois
sur les esquilles
sur les immenses encadrements
des baies vitrées :
vision de Paris si limpide
au milieu de la nuit.
Et de là,
Maman,
j’ouvrirai
le paysage embryonnaire
avec cette clef
qui pourrissait
dans les poches de notre enfance.
Je pulvériserai,
alors,
chaque métal, chaque serrure
et toutes les portes
de ce côté du monde.
Et à l’arrière-plan de ce paysage,
Maman,
je regarderai courir partout
toutes les filles de tes filles
et les filles de leurs filles
je les regarderai courir
nues et fertiles
sur une prairie
dépourvue de hurlements.
Oui,
Maman,
j’ai contemplé mes filles
je les ai vues courir
futures et invisibles
et elles apparaîtront
elles devront apparaître
bâties avec des minéraux cosmiques
même si à l’intérieur de chacune ne résonnera
ni la route de la pierre de taille
refroidissant
dans sa petite forme de lave
ni le tremblement quotidien
que produisent les cordillères
même si aucun de leurs talons ne sera moulé
de ce sable qui se répandit
obscurément
sur les côtes du Pacifique
même si les plaques continentales
qui se déplacent dans mes cauchemars
se transforment en infantes de chaux
que mon souffle de mort
détruit au réveil,
Maman,
et les filles qui devront venir
même si cette ville aligne
sadiquement leurs courbes,
même si notre cœur s’épluche
depuis les fondements
ou depuis ce sismographe
qui calcule la voltige des cordillères
dans le sourire des passants,
elles devront arriver
même si dans les paupières de Paris
on ne distingue pas une lumière dorée
que la plaine de cette pampa dégage
même si la nuit tombe sur ce grand œil
même s’il attend des siècles
pour les siècles des siècles
à ce que ma main liquide
de son inexactitude
éclaire
enfin
cette ville.
Robert Baca Oviedo
traduit de l’espagnol par Lucía Méndez Soria









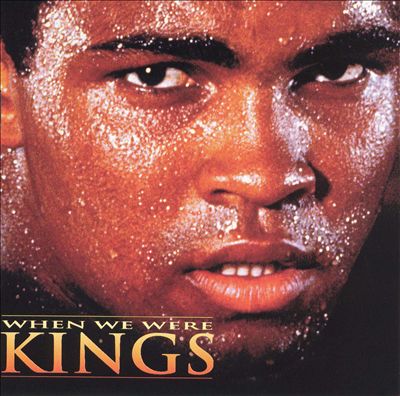




0 commentaires