 Le mercredi 6 décembre 2017, l’écrivain et traducteur Miguel Ángel Petrecca, réunissait autour de lui à la librairie Cien Fuegos, à Paris, deux autres traducteurs argentins – Ariel Dilon et Edgardo Scott – et un traducteur français – Guillaume Contré – pour parler de traduction. Le thème de leur échange : traducteur, un métier de survivants ?
Le mercredi 6 décembre 2017, l’écrivain et traducteur Miguel Ángel Petrecca, réunissait autour de lui à la librairie Cien Fuegos, à Paris, deux autres traducteurs argentins – Ariel Dilon et Edgardo Scott – et un traducteur français – Guillaume Contré – pour parler de traduction. Le thème de leur échange : traducteur, un métier de survivants ?
Ariel Dilon : Le traducteur survit à ses propres incertitudes, à la sensation de ne jamais en faire assez même s’il fait de son mieux. Tout ce qu’une langue contient ne peut être transféré à une autre. Voilà pourquoi une traduction est un autre livre, la fidélité est impossible. Mais il y a aussi du plaisir à trembler, à vibrer au rythme d’une musique que l’on sent proche.
Miguel Ángel Petrecca : Ce qui n’est pas le cas lorsque l’on traduit du chinois. Il faudrait presque utiliser un autre mot : plus qu’une traduction il s’agit d’une reconstruction, tant la syntaxe et le système référentiel sont différents. Je m’entretenais à ce sujet avec la traductrice de Ricardo Piglia en chinois : le passage de la phrase espagnole aux idéogrammes chinois est une nouvelle composition.
Guillaume Contré : Le français et l’espagnol peuvent donner l’impression de se ressembler, mais en fait non. Si je traduis de la littérature espagnole, c’est parce que j’aime la langue espagnole, d’un amour bien plus fort que celui que j’éprouve à l’égard du français. Quand je traduis, je suis amoureux du texte que je traduis, mais je dois lutter contre cet amour que j’éprouve en tant que lecteur car, si je suis amoureux du texte en langue originale, si je lui suis fidèle, je n’ai pas envie de le traduire. J’éprouve du plaisir à traduire, mais cela tient aussi de la lutte.
Ariel Dilon : Ce n’est pas faux. J’ai étudié le français et, surtout, j’ai lu des livres en français. Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, j’étais incapable de m’exprimer en français. Car le français n’est pas pour moi une langue orale, c’est une langue littéraire. J’ai appris le français en le lisant. C’est la lecture qui m’a conduit au désir de traduire. Je suis tombé amoureux de la langue française. Et j’ai essayé de la conquérir. Je la courtise. Mais ce processus a pris du temps et, pendant longtemps, j’ai lu des livres en français et en anglais dans leurs traductions espagnoles. Et j’éprouve du plaisir à lire des traductions. Certaines traductions sont pour moi mémorables, j’en suis reconnaissant aux traducteurs, voilà pourquoi je veux leur ressembler. L’Argentine est un pays de traduction. Nombre de nos grands écrivains ont été ou sont des traducteurs. Et cela modèle aussi la langue. La langue argentine est une langue d’hybridation, de métissage. J’aime ce déracinement, cette extraterritorialité. Quand je traduis, je fais en sorte que mon amour du français ne m’assourdisse pas, ne m’empêche pas de parvenir à une version argentine, fluide, heureuse, naturelle, mais il y a toujours une sensation d’étrangeté que je cultive : l’étrangeté est bienvenue, je ne veux pas qu’une traduction donne l’impression que le livre original a été écrit en Argentine.
La crise a conduit les traducteurs argentins à tenter de s’exporter en Espagne ou au Mexique, pour trouver de nouveaux marchés. La conséquence est la recherche d’une langue soi-disant plus neutre. On n’est pas totalement libre quand on exerce ce métier. Il m’est arrivé de traduire de façon à ce que mes traductions soient lisibles en Espagne. Mais après tout, cela n’est pas si éloigné de ma propre perception de la langue, de ce léger déracinement : je peux parler comme un Argentin de Buenos Aires mais, comme tous les gosses argentins, j’ai grandi en regardant à la télé des feuilletons doublés en Espagne ou au Mexique. Quand on jouait, on parlait « neutre ». Pour dire « Arrête », je ne disais pas « Pará », comme un Argentin, mais « Detente », comme un Espagnol.
Edgardo Scott : Je viens d’une famille irlandaise. L’émigration irlandaise en Argentine date de la deuxième moitié du XIXe siècle. Dans ma famille, la langue anglaise a perduré jusqu’à ma grand-mère mais mon père, déjà, prononçait Clark Ga-blé. C’est donc une langue que j’ai dû apprendre. Rodolfo Walsh, qui est également issu d’une famille irlandaise, a écrit une nouvelle sur la traduction intitulée « Note de bas de page », dans laquelle le traducteur finit par se suicider. Il ne survit pas. 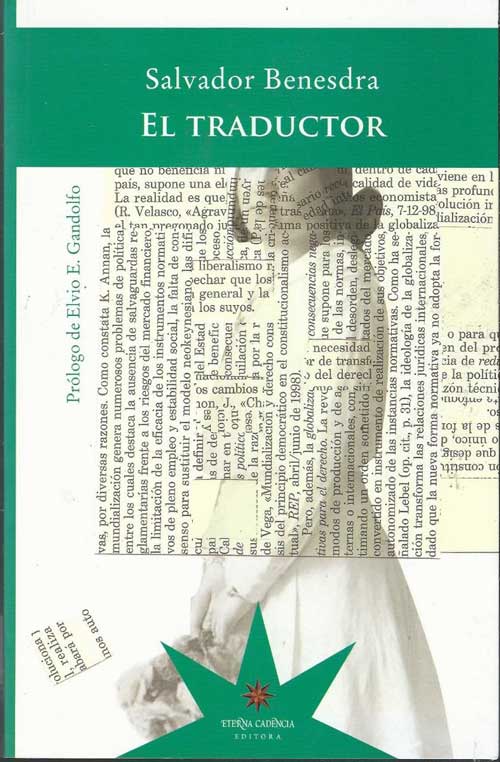 Traducteur est un métier en voie d’extinction. Le style et la traduction sont deux éléments essentiels quand il s’agit de parler de « forme » et d’esthétique en littérature, histoire d’échapper à l’acharnement politique et au présent – au discours – qui n’en finit pas de traquer la création littéraire, qui use, qui oblige à la résistance permanente. Et de la résistance à la survie – et à l’extinction –, il n’y a qu’un pas. Quand les poètes et les traducteurs auront disparu, la civilisation aussi disparaîtra. Cela me fait penser à un autre auteur, qui s’est suicidé : Salvador Benesdra, dont l’unique roman, en partie autobiographique, s’intitule Le Traducteur. Mais le manuscrit avait été refusé, à l’époque, par plusieurs maisons d’édition ; il avait été finaliste du prix Planeta, en 1995, mais ne l’avait pas remporté et, peu de temps après, Benesdra s’est tué. Il y a de ça chez le traducteur : il est à la fois suicidaire et un survivant.
Traducteur est un métier en voie d’extinction. Le style et la traduction sont deux éléments essentiels quand il s’agit de parler de « forme » et d’esthétique en littérature, histoire d’échapper à l’acharnement politique et au présent – au discours – qui n’en finit pas de traquer la création littéraire, qui use, qui oblige à la résistance permanente. Et de la résistance à la survie – et à l’extinction –, il n’y a qu’un pas. Quand les poètes et les traducteurs auront disparu, la civilisation aussi disparaîtra. Cela me fait penser à un autre auteur, qui s’est suicidé : Salvador Benesdra, dont l’unique roman, en partie autobiographique, s’intitule Le Traducteur. Mais le manuscrit avait été refusé, à l’époque, par plusieurs maisons d’édition ; il avait été finaliste du prix Planeta, en 1995, mais ne l’avait pas remporté et, peu de temps après, Benesdra s’est tué. Il y a de ça chez le traducteur : il est à la fois suicidaire et un survivant.
Ariel Dilon : Oui, le traducteur sacrifie beaucoup de lui-même, il sacrifie à la voix et à l’univers de l’autre. Il s’éteint, se cache, se recroqueville, se loge à l’intérieur du grand show de l’écrivain. Mais relativisons : ni Salvador Benesdra ni le traducteur de la nouvelle de Walsh ne sont des cas exemplaires de la condition du traducteur. Il y a chez le traducteur quelque chose qui est de l’ordre de l’impossible, mais aussi du plaisir, et c’est aussi un métier. Un métier dont on essaie de vivre, ce qui suppose qu’on l’aborde aussi avec sérénité… c’est la seule façon d’y travailler huit heures par jour, des années durant. Même dans la frustration on peut trouver du plaisir : le plaisir de l’approximation est un grand plaisir. Dans la vie, on ne tire pas souvent en plein dans le mille, alors autant ne pas mépriser les fois où l’on n’en est pas loin.
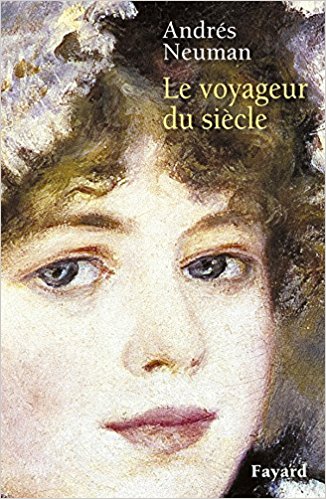 Edgardo Scott : Andrés Neuman m’a raconté un jour que quand son roman Le Voyageur du siècle [traduit par Alejandra Carrasco, Fayard, 2011, ndlr] a reçu le prix Alfaguara en 2009, tout le monde pensait que son auteur était en fait Miguel Sáenz, le grand traducteur de l’allemand vers l’espagnol, traducteur de Thomas Bernhard, de W.G. Sebald, de Günter Grass, entre autres. Bref, ils pensaient attribuer ce prix à un roman enfoui dans un tiroir de Miguel Sáenz… et Neuman disait qu’il devait donc beaucoup à ce traducteur.
Edgardo Scott : Andrés Neuman m’a raconté un jour que quand son roman Le Voyageur du siècle [traduit par Alejandra Carrasco, Fayard, 2011, ndlr] a reçu le prix Alfaguara en 2009, tout le monde pensait que son auteur était en fait Miguel Sáenz, le grand traducteur de l’allemand vers l’espagnol, traducteur de Thomas Bernhard, de W.G. Sebald, de Günter Grass, entre autres. Bref, ils pensaient attribuer ce prix à un roman enfoui dans un tiroir de Miguel Sáenz… et Neuman disait qu’il devait donc beaucoup à ce traducteur.
Ariel Dilon : J’aimerais revenir sur la question de la visibilité du traducteur. Il y a là quelque chose qui tient de la revendication corporatiste, de l’urgence. Il y a quelques années, en Norvège, une longue grève des traducteurs a conduit à une hausse de leur rémunération. Mais dans cette quête de visibilité, il y a aussi le désir de ne pas s’éteindre, s’éteindre dans l’autre, dans la peau de l’autre. Bref, le désir d’être reconnu. En cela aussi on peut parler d’un métier de survivants. Pensons aux traductions qui ont du mal à survivre aux lecteurs avisés, aux générations suivantes, aux collègues plus jeunes.
Edgardo Scott : Les traductions ont une date de péremption, contrairement aux originaux.
Miguel Ángel Petrecca : Parlons donc aussi des façons de traduire, un sujet qui pour nous, Argentins, vient de Borges. Fidélité ou infidélité à l’original ?
Ariel Dilon : Le thème des dernières Assises de la Traduction à Arles était justement les Infidélités. Mais il conviendrait de redéfinir la fidélité. Au sein des couples aussi. Et qui est fidèle à qui ?
Edgardo Scott : Lors de la dernière Foire des éditeurs de Buenos Aires, un débat fut organisé sur le thème « Fidélité ou interprétation » et certains éditeurs se sont montrés hostiles à ce que les traducteurs interviennent trop sur le texte.
Ariel Dilon : Mais il me semble impossible de ne pas intervenir. Pourtant, la littéralité peut être séduisante, lorsque l’on veut rester proche d’une musicalité, par exemple. Et l’on y renonce lorsque c’est impossible : alors l’interprète prend le relais. Comme si le traducteur était l’interprète d’une partition musicale : il l’interprète, la recrée, ce qui lui laisse une marge de manœuvre très grande. Pas besoin d’être collé à la partition, d’être littéral. Comme dans le jazz.
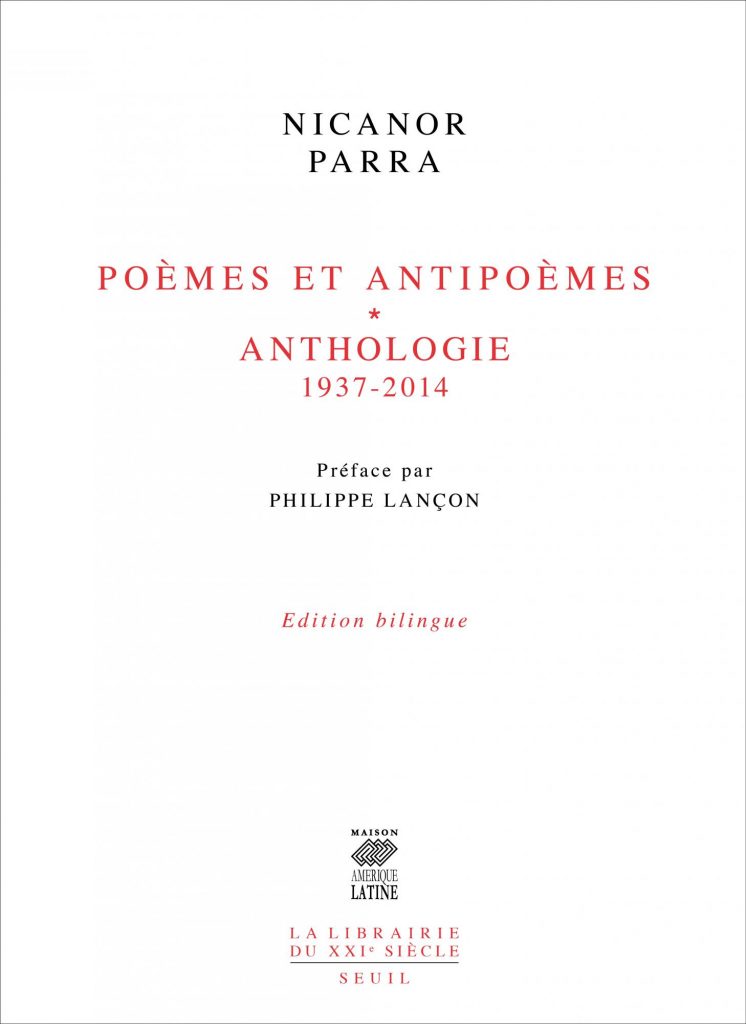 Guillaume Contré : Il existe aussi des publications bilingues, où le lecteur peut accéder à la version originale du texte et à sa traduction. Avec le risque de la lecture comparée, qui peut mettre le traducteur dans une situation délicate, mais qui permet aussi de mesurer la liberté qu’il a pu prendre. Je pense à l’anthologie bilingue des Poèmes et antipoèmes de Nicanor Parra parue au Seuil en 2017, dans la traduction de Bernard Pautrat. On peut y relever les impasses dans lesquelles le traducteur parfois s’est trouvé, mais aussi les trouvailles.
Guillaume Contré : Il existe aussi des publications bilingues, où le lecteur peut accéder à la version originale du texte et à sa traduction. Avec le risque de la lecture comparée, qui peut mettre le traducteur dans une situation délicate, mais qui permet aussi de mesurer la liberté qu’il a pu prendre. Je pense à l’anthologie bilingue des Poèmes et antipoèmes de Nicanor Parra parue au Seuil en 2017, dans la traduction de Bernard Pautrat. On peut y relever les impasses dans lesquelles le traducteur parfois s’est trouvé, mais aussi les trouvailles.
Ariel Dilon : Pour ma part, j’ai toujours apprécié les éditions bilingues. Pas forcément pour repérer les éventuelles erreurs d’un traducteur, mais pour apprendre. Je suis en train de traduire Henri Michaux. Ma deuxième lecture de Michaux fut une traduction des Meidosems par Víctor Goldstein, en édition bilingue, qui m’a beaucoup appris et que je garde près de moi pour éventuellement regarder comment Goldstein a résolu telle ou telle difficulté.
Edgardo Scott : Et dans certains cas, la traduction est meilleure que l’original. H. A. Murena écrivait : « tout ce qui existe est traduction ». Écrire, c’est traduire le réel. L’écrivain commence par traduire. Dans un article de 1926, Jorge Luis Borges parle de « deux façons de traduire ». Tout à la fin, il y évoque le début de Martín Fierro (1872) de José Hernández et en propose une traduction en espagnol, qu’il considère comme meilleure. Ce qui me ferait presque dire que le traducteur a le devoir d’améliorer le texte dont il s’empare. Voilà pourquoi il existe plusieurs traductions successives d’un même texte : on tente toujours d’améliorer ce qui a été dit, même si cela a été bien dit.
Ariel Dilon : Quand on s’attaque à cette matière, à l’écriture d’un autre, on est conscient qu’il y a eu lutte, qu’il y a eu traduction, qu’il y a eu des contradictions, différentes versions, et parfois des échecs. On ne passe pas derrière l’auteur pour le corriger, on passe juste par cette même lutte. Car l’écriture n’est pas exempte de toutes ces impossibilités que l’on attribue à la traduction. La littérature qui m’intéresse est justement celle-là : celle qui produit cette vibration, celle qui n’est pas lisse, celle qui ne trouve pas le mot juste, qui lutte et qui suscite de nouveaux signifiés qui échappent à tout calcul. Le traducteur, en fait, répète cette opération. Je crois aussi beaucoup à l’inspiration : un objet suscite chez un créateur la traduction d’un autre. Je ne parle pas d’inspiration divine, je dis juste que la traduction produit un objet inspiré par un autre. Cela peut être le cas d’une bonne critique littéraire, inspirée par un livre qu’on a aimé ou pas : le résultat est un objet inspiré par un autre objet. Il en va de même avec la traduction et l’écriture.
Edgardo Scott : Cela me fait penser à la traduction des Palmiers sauvages de Faulkner par Borges. Ricardo Piglia disait que « Faulkner traduit par Borges, c’est Onetti ». Le premier livre de Faulkner que j’ai lu, c’est Sanctuaire, dans une traduction espagnole qui ne m’a pas permis d’y entrer. Ensuite, j’ai lu Les Palmiers sauvages dans la traduction de Borges, et c’est ce livre qui m’a permis d’en lire d’autres, traduits par différents traducteurs. Mais je me demande : Borges l’a-t-il bien traduit ou pas ? Et doit-on parler de traduction ou de nouvelle version du texte ? C’est comme pour les sonnets de Shakespeare. Tenter de faire rimer les vers de Shakespeare en espagnol peut donner un résultat exécrable. Personnellement, je préfère perdre la rime et trouver une nouvelle musicalité.
Ariel Dilon : Il faut accepter le fait que cette expérience de lecture est différente, accepter le fait que lire une traduction, ce n’est pas lire l’original. Être un lecteur de traductions, en avoir conscience comme d’une richesse et ne pas se souvenir du traducteur seulement quand on relève une erreur. On ne perd pas forcément plus que ce qu’on gagne à lire une traduction.
 Propos recueillis à la Librairie Cien Fuegos, 4 rue de la Forge Royale, Paris 11e, le mercredi 6 décembre 2017, et traduits par Christilla Vasserot. Remerciements à Mariana Di Ció.
Propos recueillis à la Librairie Cien Fuegos, 4 rue de la Forge Royale, Paris 11e, le mercredi 6 décembre 2017, et traduits par Christilla Vasserot. Remerciements à Mariana Di Ció.
Miguel Ángel Petrecca est né à Buenos Aires en 1979. Il est écrivain et traducteur, spécialiste de littérature chinoise. Il est le fondateur et directeur de Cien Fuegos, librairie hispano-américaine de Paris.
Guillaume Contré est compositeur, écrivain et critique littéraire. Né à Angers en 1979, il a traduit des auteurs tels que Pablo Katchadjian et Eduardo Muslip.
Ariel Dilon, né en 1964 à Buenos Aires, a traduit plus d’une cinquantaine de titres du français et de l’anglais. Parmi ses dernières traductions, Mécanique de François Bon.
Edgardo Scott est né à Lanús en 1978. Écrivain, musicien et psychanalyste, il prépare une nouvelle traduction espagnole de Gens de Dublin de Joyce.

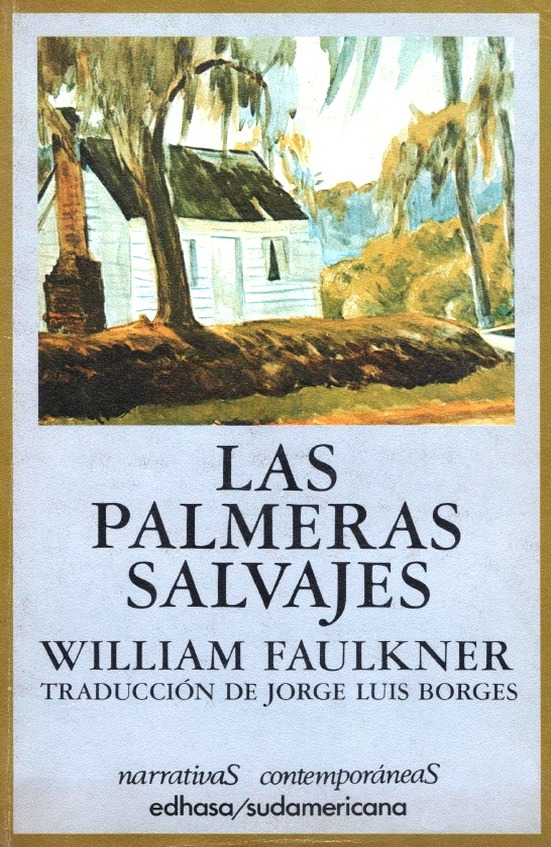
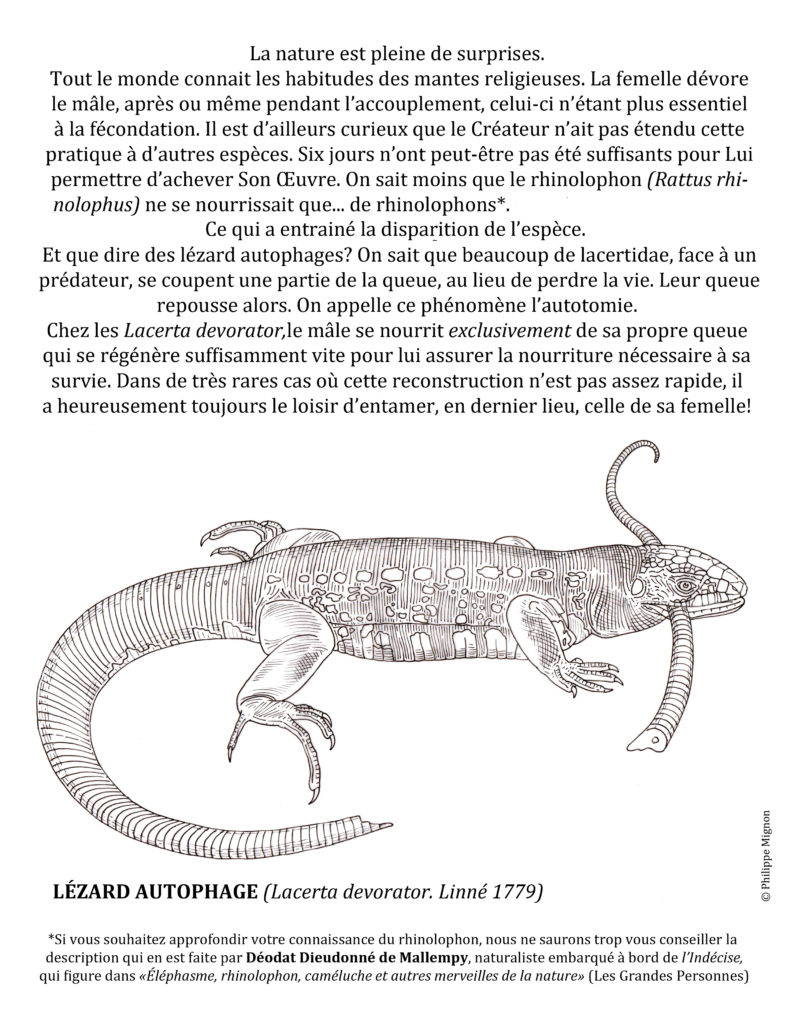






0 commentaires