Septembre 2019. Dans un mois, on fêtera l’anniversaire de leur installation dans le mobilhome. C’est une expression, on ne fêtera rien. Sortir de la rue : depuis quand utilisons-nous comme une évidence cet oxymore énonçant en creux le scandale qu’est la vie sans abri ? Sortir de la rue mais sans garantie de pérennité, sans la sérénité qui permettrait d’envisager l’avenir plus loin que quelques jours ou quelques mois, ne se célèbre pas. Pourtant, cette minuscule maison de deux pièces, sans vrai confort, posée sur un terrain calme et pas trop loin du centre, est un progrès immense pour Elle et sa famille. Une maison à eux, qui leur permet de vivre isolés des autres familles entassées dans un squat trop étroit : d’après ce qu’on m’a dit, ce squat ressemble à un bidonville à cause des cabanes construites sur le terrain derrière le bâti. Récemment, un oncle a chuté en voulant réparer le toit du hangar : il est passé au travers, est tombé sur sa fille. Il paraît que les voisins se plaignent du bruit que font ces quarante personnes dont de nombreux enfants vivant là, les unes sur les autres, sans aucune intimité, au milieu de la ferraille qui attend la revente. Placer des gens dans une situation impossible, s’en débarrasser en les collant dans des lieux inadaptés qui deviendront vite insalubres, c’est se fabriquer d’emblée des arguments pour justifier leur future expulsion.
Mais pour Elle ? Progrès fragile : que se passera-t-il quand la mairie voudra récupérer le terrain ? Où iront-ils quand cessera la tolérance ? Vivre avec cette épée de Damoclès toujours au-dessus de la tête : l’expulsion dont on ne sait jamais quand elle arrivera. Nous sommes quelques mois avant les élections municipales, ce qui, je l’espère, les protège. Remettre Elle et ses enfants à la rue, le maire en campagne n’a certainement pas envie de clapotis médiatiques de cet ordre-là. Quant aux familles du squat, leur sort dépend des décisions de la Région qui est propriétaire des lieux occupés. Mais elles devront partir : encore une fois chassées par un projet immobilier.
Depuis que le maire a fait évacuer l’avenue où les familles vivaient dans des voitures et des camionnettes, ces Roms pauvres demeurent dans le squat, à l’écart du reste de la population. Peu de manche, les poubelles inspectées le soir voire la nuit. On croise en fin d’après-midi, dans certains quartiers, des dames qui vont par trois ou quatre à la bouche d’incendie remplir d’eau leurs jerrycans, puis rentrent paisiblement dans le grand bidonville où la vie ne doit pas être paisible. De temps à autre, dans le journal municipal, un article informe les habitants de ce que la mairie fait semblant de faire pour les Roms de la ville. Les familles se satisfont de cet d’accord tacite : elles ne demandent rien contre leur invisibilité, sinon qu’on leur fiche la paix.
Autre chose m’inquiète : le mobilhome est vieux, soumis à rude épreuve avec les enfants. Le Petit a trois ans et adore sauter, La Petite apprend à marcher. Je ne sais pas s’il tiendra encore longtemps. Le sol est enfoncé par endroits. Lui a fait des travaux de consolidation du seuil, il reste une grande zone crevée au milieu de la première pièce. Fin septembre, il fait déjà froid le matin.
*
À la place du frigo, Lui a installé le poêle à bois qui les chauffera tout l’hiver. Je l’ai découvert samedi en ramenant La Grande qui a passé la journée chez moi à regarder des films. Je n’aime pas qu’elle fasse ça, mais j’étais trop enrhumée pour batailler contre sa fascination de l’écran.
Le nouveau poêle n’est pas, comme celui des années précédentes, fabriqué à partir d’un gros bidon d’huile végétale. Ce type de poêle rudimentaire chauffe très bien, mais n’est pas étanche et dégage des fumées toxiques, surtout quand le combustible est de l’agglo, des débris de meubles Ikea que l’on trouve dans la rue. Cette fois, il me montre un joli petit appareil en fonte, bleu et noir, sur pied, équipé d’une mini plaque de cuisson. Elle m’explique qu’ils feront ainsi des économies de gaz. Des voisins leur ont donné des palettes propres à brûler. Je découvre par la fenêtre le frigo posé dehors, béant.
*
Elle est fière de me montrer « son » plaz (terrain). Mercredi et jeudi, ils ont déplacé le mobilhome et l’ont installé dans la largeur, à gauche, ce qui dégage un vaste espace devant. Ils ont fait ça à force d’hommes, mais combien étaient-ils ? Lui me l’a dit plus tard : quatre. Le vieux mobilhome est mieux protégé quand il pleut fort ou par temps venteux, le terrain paraît plus spacieux et plus propre. Les enfants ont de la place pour jouer. L’idéal serait de couler une dalle de ciment, au moins sur une partie du sol pour supprimer la boue. Mais ça coûte des sous, et nous ne savons pas comment la mairie réagirait à cet aménagement.
Elle me demande de lui apporter des vitamines : elle prétend qu’elle a maigri, comme elle le fait régulièrement depuis que nous nous connaissons. Je lui en promets pour demain, mais j’ajoute, escamotant la précarité de sa situation, qu’elle n’a plus de soucis à se faire, qu’elle a une maison, un beau terrain très calme et propre pour sa famille, que les enfants vont bien : elle sourit en me disant que Lui songe à construire une terrasse en bois avec un auvent devant le mobilhome. Je me dis que ça serait parfait et assez bourgeois. Mais ils gagnent trop peu, juste assez pour faire bouillir la marmite. Il faut encore attendre les allocations familiales. Selon les textes, cela fait onze mois qu’elle devrait les toucher.
*
Un matin, je le trouve prêt à partir travailler. Un gars l’embauche régulièrement pour l’aider à des déménagements ou des débarras de cave. Lui me dit qu’il est payé quarante ou cinquante euros la journée. Assis sur la banquette dans l’attente du coup de fil de « l’Arabe », il regarde une vidéo sur son téléphone. Il me demande si je connais et tourne l’appareil. Sur une tribune en hauteur, un homme en manteau gris et toque de fourrure parle à la foule : oui, je reconnais Ceausescu.
Lui est né en 1989, l’année de la mort du dictateur roumain. J’avais vingt-deux ans et je me souviens de ces mois incroyables que nous avons passé devant nos écrans de télé : la casse du mur de Berlin, la révolution roumaine, la capture et le « procès » en direct du couple Ceausescu, leur exécution le jour de Noël. Cette fascination morbide pour ce qui se passait à deux mille kilomètres, le « procès » expéditif, mais que nous n’arrivions pas à réellement condamner, fait aux deux vieux tyrans qui ressemblaient alors à deux paysans hagards, je ne l’ai pas oubliée.
Il me dit ce que j’ai déjà entendu dans la bouche de jeunes Roms : la Roumanie se portait mieux du temps de Ceausescu, il y avait du travail, du pain sur la table et de l’ordre. Les plus âgés ont un avis beaucoup plus mitigés. Il paraît que le racisme contre les tsiganes était moindre à l’époque, qu’ils n’étaient pas discriminés, exclus des emplois comme aujourd’hui, mais je ne sais pas si c’est vrai.
*
J’ai écrit que la lutte collective pour le relogement des familles expulsées en 2016 n’avait pas été « efficace ». En utilisant ce mot, je reprends le vocabulaire du pouvoir. Il faut être efficace, productif, efficient. Ce n’est pas ça : cette lutte s’est soldée par une défaite. Mais pouvait-il en être autrement ? Le combat a-t-il été réellement mené, ou bien a-t-on joué un simulacre de bataille politique dont les acteurs se sont assez rapidement lassés dès qu’il a été évident que rien ne serait obtenu et qu’il était plus gratifiant de s’en aller ailleurs jouer un autre scénario sur une autre scène ?
Une amie qui connaît bien ces familles affirme que si nous ne nous étions mêlés de rien, elles s’en seraient mieux tirées, plus rapidement. Débarquant dans leurs difficultés comme des éléphants dans un magasin de porcelaine, ou plus exactement comme des colons de l’humanitaire sur un terrain exotique qu’ils s’approprient pour en extraire tous les bénéfices symboliques attendus, nous avons probablement aggravé leur situation. Les familles auraient trouvé plus tôt le squat dans lequel elles vivent depuis un an, ou un autre, en s’épargnant le pire : de longs mois de vie à la rue. La colère devant tant d’impuissance à imposer l’égalité et la justice me rend sévère contre ceux-là même qui s’impliquent pour exiger le respect des droits de chacun : les affects négatifs font aussi partie de la défaite.
*
Avril 2020. Le gouvernement a imposé le confinement à une part de la population dont les activités ne sont pas jugées essentielles à la lutte contre l’épidémie de coronavirus ou au fonctionnement du pays. Nous restons chez nous. Elle et Lui ne peuvent plus aller chiner dans les rues, le marché aux biffins n’aura pas lieu, il n’y a plus de récupération de ferraille ni de petits boulots possibles : l’économie domestique reposant sur le fragile équilibre entre ces modestes sources de revenus s’effondre. Pour les familles roms pauvres c’est un cataclysme économique qui s’ajoute à la peur de la maladie et de la mort.
Depuis février, je la trouvais soucieuse le matin. Elle avait des nouvelles de Roumanie, Mauvaises. Là-bas l’épidémie progressait vite tandis qu’ici nous en étions encore à douter de sa gravité. Les écoles roumaines fermaient quand notre ministre de l’Éducation nationale assurait à la télévision qu’il n’en était pas question. Il y avait des malades, des morts dans ce pays d’Europe dont nous n’entendons jamais parler. Mais nous allions encore notre bonhomme de chemin fait de mille rencontres et d’échanges sans trop d’inquiétude.
Pendant le confinement, sortir de chez soi c’est s’exposer aux dangers de l’épidémie mais aussi à l’arbitraire des amendes sanctionnant ceux et celles qui vont sans une attestation dûment remplie et un motif que les policiers estiment recevable. Dans les bidonvilles sans eau courante, traverser le quartier pour s’approvisionner à la bouche d’incendie devient doublement risqué : contamination et répression guettent au coin de la rue. Privées de leurs moyens ordinaires de subsistance, exposées plus que jamais aux brimades, inquiètes du sort des anciens restés au pays et de leur propre santé, les familles paniquées, du moins celles qui le pouvaient, ont fui le grand bidonville. Vers où ? Vers quoi ? Qui le sait ? Aussitôt des pelleteuses, venues du ciel puisque personne n’ose revendiquer leur divine intervention, ont détruit les cabanes, mettant un terme à l’existence de ce lieu de vie sur lequel des associations rémunérées effectuaient depuis plusieurs années un travail dit « d’insertion » en vue de préparer un démantèlement dont la procédure respecte les personnes et la loi. Mais qui veut « l’insertion » des familles roms ? Quand une pandémie miraculeuse se présente, l’occasion est trop belle. D’un même revers de main, on efface les familles, leurs cabanes et les travailleurs sociaux qu’on finançait à perte pour faire semblant d’agir. Et voilà un beau terrain à construire. Ici, chaque mètre carré vaut son poids de sang et d’or.




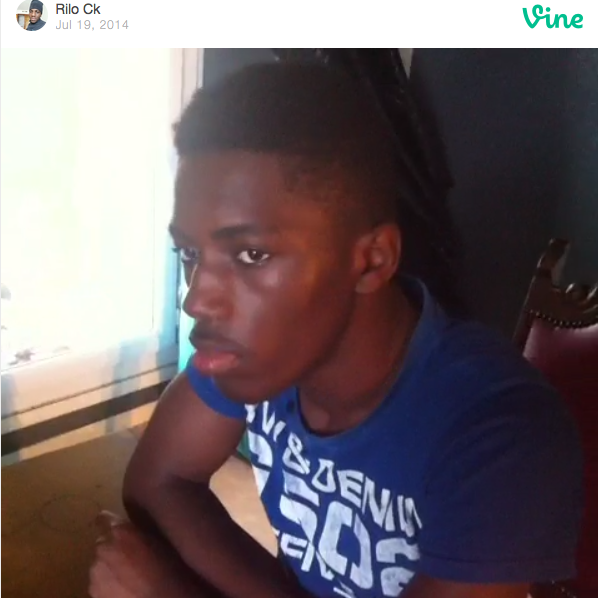



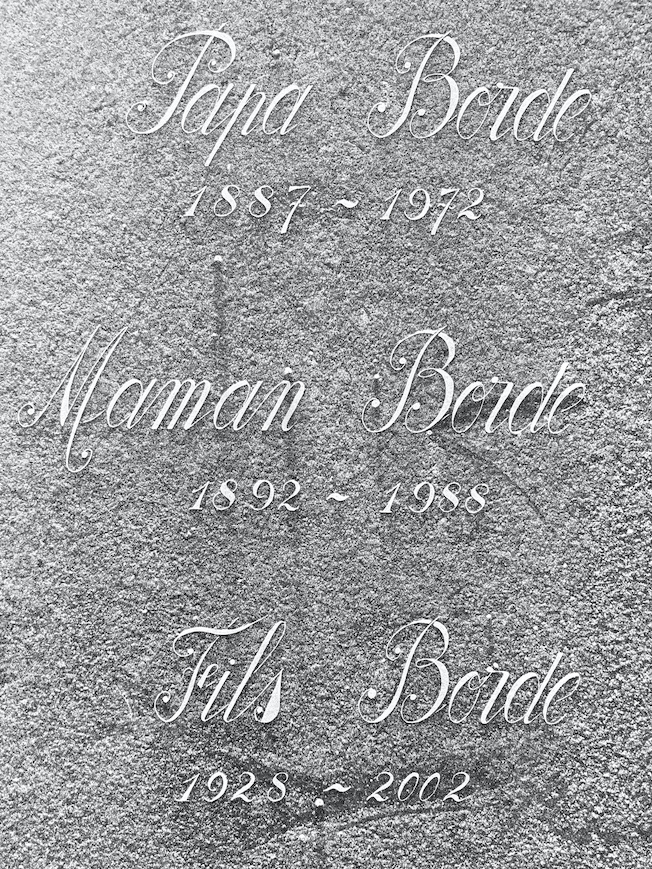

0 commentaires