La bocca sollevò dal fiero pasto
quel peccator, forbendola a’ capelli
del capo ch’elli avea di retro guasto.
Dante, Inferno, XXXIII
 « Le coin des traîtres », voici un beau titre pour un traducteur dont la fidélité allait jusqu’à l’homonymie. Sa ressemblance physique à son père était, elle aussi, frappante. Tout le monde ne sait pas – les traducteurs sont invisibles – que Dmitri Nabokov (1934-2012) fut l’un des traducteurs les plus assidus de l’œuvre de Vladimir Nabokov (1899-1977). Et cela non seulement du vivant de l’auteur : Dmitri sera un exécuteur testamentaire inspiré. Inspiré par son père lui-même qui, à ses dires, l’accompagna toujours, en lui soufflant les bonnes décisions à prendre. Mais mon but n’est pas d’aborder la question complexe de la véracité du surnaturel, ni celle psychanalytique du difficile rapport d’un fils au génie écrasant de son père. Je me limiterai à la question de la traduction ou, plus précisément, du cannibalisme en traduction.
« Le coin des traîtres », voici un beau titre pour un traducteur dont la fidélité allait jusqu’à l’homonymie. Sa ressemblance physique à son père était, elle aussi, frappante. Tout le monde ne sait pas – les traducteurs sont invisibles – que Dmitri Nabokov (1934-2012) fut l’un des traducteurs les plus assidus de l’œuvre de Vladimir Nabokov (1899-1977). Et cela non seulement du vivant de l’auteur : Dmitri sera un exécuteur testamentaire inspiré. Inspiré par son père lui-même qui, à ses dires, l’accompagna toujours, en lui soufflant les bonnes décisions à prendre. Mais mon but n’est pas d’aborder la question complexe de la véracité du surnaturel, ni celle psychanalytique du difficile rapport d’un fils au génie écrasant de son père. Je me limiterai à la question de la traduction ou, plus précisément, du cannibalisme en traduction.
Hiver 2013, New York City. Tempête de neige. Un manteau blanc et gris couvre la ville. Il fait froid, dehors, mais travailler dans les archives n’est pas un soulagement. Il faut garder une température minimale à l’intérieur de la salle somptueuse afin de bien préserver les manuscrits de tant d’écrivains : Joyce, Woolf, Faulkner… et Nabokov. Je consulte les avant-textes de ce dernier et notamment des traductions de ses ouvrages par son fils.
L’écrivain russe, qui avait changé de langue d’écriture après avoir émigré aux États-Unis, avait l’habitude de suivre de près les traductions de ses textes en anglais et en français : il les révisait, corrigeait et modifiait à sa guise. Il prétendait avoir le dernier mot. Cette mainmise n’était pas toujours appréciée par ses traducteurs et la correspondance de Vladimir Nabokov à ce sujet, témoigne d’échanges musclés. Il les prévenait, pourtant : « La chose la plus importante est d’obtenir une traduction précise et compétente, qui sera sans doute cannibalisée » leur écrivait-il.
Un beau jour, après avoir décidé qu’il ne ferait pas d’études de droit selon la tradition familiale et comme son père l’aurait souhaité, et qu’il se consacrerait à la place à la carrière pas très rémunératrice de chanteur d’opéra, Dmitri Nabokov, dont les passe-temps préférés étaient les sports dangereux et les femmes, commença à traduire Vladimir Nabokov. Aux archives, je lis des témoignages : leur collaboration fut « sans nuage » ; le fils traduisait et le père révisait, corrigeait, modifiait et finalement, tout en gardant le nom du traducteur, il ajoutait être le seul responsable de cette (nouvelle) traduction. Étrange collaboration dont le cannibalisme est de mise. Mais, Ubi maior minor cessat et Dmitri accepta de bon gré de se plier aux vouloirs de son père.
Sauf que.
Saisie par le froid, je découvre une petite note : dans une lettre manuscrite ajoutée aux documents d’archive en 1998 (si je déchiffre bien la date, pas tout à fait lisible), plus de vingt années après la publication des traductions, Dmitri prévient les lecteurs et les libraires que : premièrement « toutes les corrections ne sont pas de la main de Nabokov père », deuxièmement « les modifications sont dues surtout à la licence de l’auteur de modifier son texte ». Dimitri demande à ce que cette note soit ajoutée à toutes ses traductions en collaboration avec Nabokov senior. L’humble traducteur ne veut plus de cette transparence à laquelle l’avait involontairement confiné son père. Et Dmitri d’exhumer son propre travail.
Et de devenir cannibale à son tour. D’abord timidement, en prenant ses responsabilités en tant que traducteur des textes que l’auteur de Lolita n’avait pas pu (ou voulu) publier de son vivant ; ensuite résolument, en demandant aux traducteurs de partir de ses propres traductions en anglais (c’est le cas, notamment, de L’Enchanteur) et finalement sans retenue, en s’autotraduisant vers l’italien (The Enchanter deviendra L’Incantatore, dans la traduction de Dmitri Nabokov).
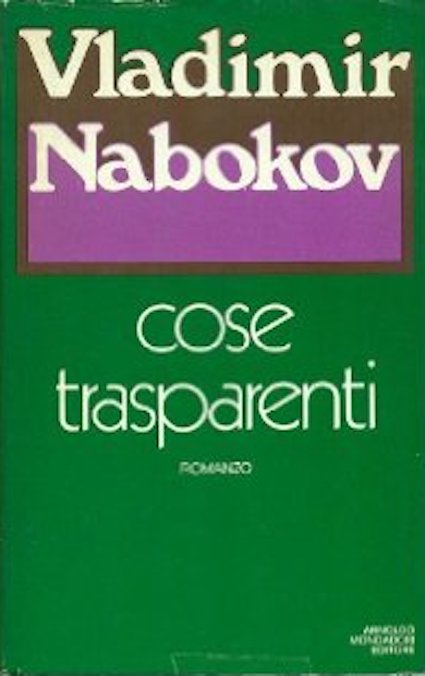 Oui, vous avez bien lu, Dmitri Nabokov, russophone et anglophone, traduit en italien. Rien de plus simple, écrit-il dans son « Translating with Nabokov » : « Ma première tâche, sans assistance, qui me fut confiée du vivant de mon père, consista en la révision de la traduction italienne de King, Queen, Knave. Encouragé par mon succès dans une langue apprise sans effort parce que j’aimais la parler et la chanter, et dont j’affrontais les subtilités littéraires sans soucis grâce à mes bases solides en latin et autres tours, je pus alors commencer ma traduction en italien, publiée par Mondadori, de Transparent things, Cose trasparenti. » (Ironie du sort, Transparent things / Cose trasparenti, est le premier texte qu’il traduit en italien, moins transparent que jamais).
Oui, vous avez bien lu, Dmitri Nabokov, russophone et anglophone, traduit en italien. Rien de plus simple, écrit-il dans son « Translating with Nabokov » : « Ma première tâche, sans assistance, qui me fut confiée du vivant de mon père, consista en la révision de la traduction italienne de King, Queen, Knave. Encouragé par mon succès dans une langue apprise sans effort parce que j’aimais la parler et la chanter, et dont j’affrontais les subtilités littéraires sans soucis grâce à mes bases solides en latin et autres tours, je pus alors commencer ma traduction en italien, publiée par Mondadori, de Transparent things, Cose trasparenti. » (Ironie du sort, Transparent things / Cose trasparenti, est le premier texte qu’il traduit en italien, moins transparent que jamais).
Maintenant, je ne tremble que d’indignation. Un sentiment presque belliqueux remplace l’empathie que j’avais d’abord éprouvée vis-à-vis de ce traducteur dévoré par le génie de son père. Comment se permet-il de traduire dans ma langue (on s’approprie toujours une langue qui pourtant appartient à des millions d’autres personnes !), avec une telle légèreté ? Jalousie (je me bats depuis des années pour écrire en un français correct, et je n’oserais pas traduire Nabokov – Nabokov ! – dans cette langue apprise à l’âge adulte) ? Incrédulité ? C’est bien lui qui traduit ? Ses traductions sont-elles à la hauteur de sa tâche ? S’agit-il de traductions à proprement parler ? Vite, il faut que je vérifie.
Je repère quelques textes corrigés, en plus des échanges avec les éditeurs italiens pour la publication. Je me sens soulagée lorsque je découvre les tapuscrits.
Eté 2017, Paris–Milan. Les tapuscrits repérés à la New York Public Library et la lecture qui s’en suit des traductions en italien publiées confirment que, comme me le diront trois traductrices qui travaillèrent avec Dmitri Nabokov : « Il parlait un italien magnifique… mais de là à traduire… ! » Une d’entre elles m’avoue : « Je corrigeais beaucoup. Et il avait confiance en moi, donc il me laissait faire. » Dmitri était très sévère, voire redoutable, vis-à-vis des traducteurs de l’œuvre de son père et il leur faisait passer de véritables examens : il fallait se rendre à Montreux et lire sa traduction à voix haute pendant qu’il écoutait dans un silence religieux. Si la traduction était à son goût, son attitude changeait, graduellement, il devenait souriant mais pouvait éclater en un fou rire aux restitutions réussies de l’ironie sulfureuse de Nabokov. Une fois les bonnes traductrices (ou traducteurs) choisies, l’œuvre du grand Nabokov serait en de bonnes mains.
Dmitri devint alors responsable de ses choix, même s’il ne s’agissait pas toujours de choix de traduction, mais de collaboratrices (ou collaborateurs) vaillants.
 Cannibalisme inversé. Dmitri Nabokov, grâce à son nom et à sa proximité – qui relève même de la promiscuité avec son père – peut désormais signer sans que le « nom du père » vienne dévorer sa signature par des considérations désobligeantes sur qui détient la responsabilité de la traduction. Mais, tout en se répétant, la portée de la collaboration est inversée. Des traducteurs transparents aident le traducteur désormais responsable. Dmitri, comme Vladimir s’arroge le dernier mot, la dernière bouchée. Au point de gagner un prestigieux prix italo-russe pour la traduction de L’Incantatore.
Cannibalisme inversé. Dmitri Nabokov, grâce à son nom et à sa proximité – qui relève même de la promiscuité avec son père – peut désormais signer sans que le « nom du père » vienne dévorer sa signature par des considérations désobligeantes sur qui détient la responsabilité de la traduction. Mais, tout en se répétant, la portée de la collaboration est inversée. Des traducteurs transparents aident le traducteur désormais responsable. Dmitri, comme Vladimir s’arroge le dernier mot, la dernière bouchée. Au point de gagner un prestigieux prix italo-russe pour la traduction de L’Incantatore.
Usurpation ? Trahison ? Ou tout simplement naïveté ? Car, même s’il signe les traductions, il est conscient que d’autres traducteurs peuvent mieux faire son travail. Et il s’y soumet volontiers. Ne s’agirait-il plutôt d’une forme de fidélité extrême à son père dont les théories et pratiques traductives furent fortement contestées ? Dmitri avait tout essayé pour ne pas se faire dévorer par le grand Vladimir Nabokov en se détachant de lui : d’abord l’opéra (que son père connaissait peu ou mal) à la place du droit (héritage du grand-père paternel), ensuite les sports dangereux, la collection des Ferrari, l’amour du luxe et, paraît-il de nombreuses femmes (Dmitri ne se mariera jamais). Et finalement, la traduction vers une langue que Vladimir ne maîtrisait pas, l’italien.
Cependant, le nom du père le rattrape : il rêve de devenir écrivain (mais son roman annoncé et jamais publié semble raté) ; il devient réellement traducteur (uniquement de Nabokov, mis à part une tentative gauche de ce dernier de lui faire traduire Lermontov) ; il défend son père de toutes les attaques (dans des préfaces aux traductions parfois très polémiques) ; il se consacre à ce que l’œuvre posthume du « grand » Nabokov soit honorablement transmise et reçue. Non, Dmitri ne trahit pas son père, mais il lui est fidèle, fidèle jusqu’à l’identification, fidèle au point de faire une seule chair avec lui : « Your thoughts, your words, your styles, your souls agree, No longer his interpreter, but he. » (Essay on Translated Verse, Earl of Roscommon, 1684). Ugolino dévoré par sa progéniture.
Chiara Montini
Le coin des traîtres
Chiara Montini, est chercheuse associée à l’Item (CNRS/ENS) et a travaillé dans différents pays où elle a enseigné la littérature comparée. Elle a signé plusieurs essais consacrés à la question des écrivains multilingues et de la traduction, elle-même étant traductrice et multilingue.



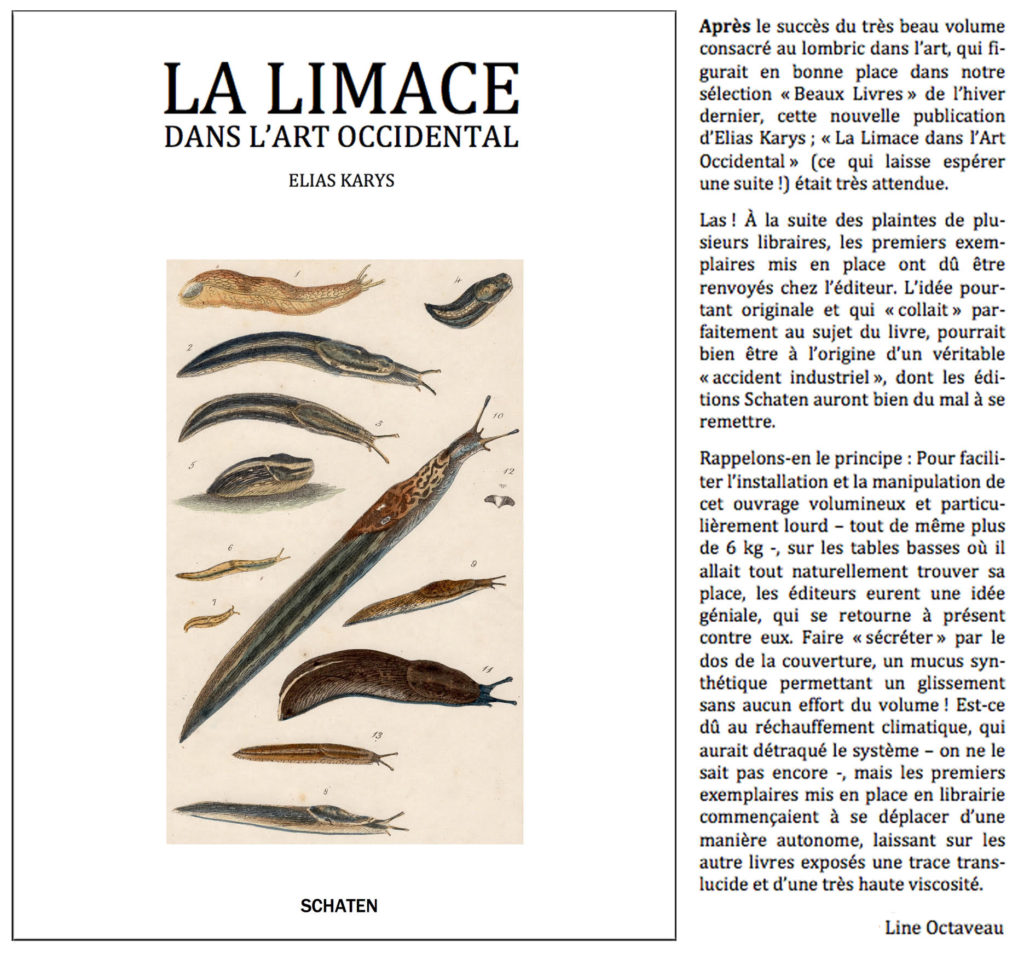






0 commentaires