Derniers tours de roue pour Frank Castorf à la Volksbühne de Berlin. L’ultime création, un Faust entièrement revu et corrigé, a eu lieu au mois de mars. Depuis, le directeur-metteur en scène a fait décrocher du toit du théâtre édifié sur la Rosa-Luxemburg-Platz, le « Ost » (« Est »), l’enseigne de néon allumée depuis vingt-cinq ans comme un pied de nez à la réunification de la ville, ou plutôt comme une épine lumineuse plantée dans l’œil de ceux qui auraient la mémoire courte. Il a aussi annoncé son intention de ne pas laisser à son successeur l’usage de la roue, autre enseigne symbole de son mandat à la tête de la Volksbühne. Ce n’est donc pas dans la sérénité que Castorf passe la main, le mois prochain, à Chris Dercon, un Flamand jusque là directeur de la Tate Modern de Londres. Mais la sérénité n’est de toute façon pas la première chose qui vient à l’esprit lorsque l’on pense à Castorf, virtuose du chaos et artisan d’un théâtre génial, mais aussi parfois fatigant.
Dans ce contexte de fin de mandat – ou de fin de règne –, difficile de ne pas guetter dans ses derniers spectacles une dimension testamentaire, voire crépusculaire. Créé en 2016, Die Kabale der Scheinheiligen. Das Leben des Herrn de Molière, laisse en tout cas une large place à l’introspection : c’est sûrement l’une des pièces les plus explicitement intimes jamais montées par le metteur en scène. Et c’est une pièce qui au delà de sa profusion, ne traite que d’un sujet : l’amour du théâtre.
Le titre du spectacle renvoie à deux textes – une pièce, une biographie – consacrés par Mikhaïl Boulgakov à Molière. Associé au Théâtre d’art de Moscou, l’écrivain russe, qui avait de plus en plus de mal à se faire publier et jouer, s’est plongé dans Molière alors que la terreur stalinienne étendait son emprise. Il s’intéresse particulièrement aux rapports entre Molière et Louis XIV. Adepte des poupées russes, Castorf ne manque pas de saisir l’occasion et de mettre en scène, aussi, la relation entre Boulgakov et Staline, entre l’artiste et le pouvoir… le pitre n’étant pas toujours celui que l’on croit. La scène est donc, simultanément, dans la France du XVIIe siècle, à Moscou en 1930, et aussi en Espagne dans la deuxième moitié du XXe où une équipe de tournage allemande se débat dans des problèmes matériels et existentiels (une histoire tirée du script de Prenez garde à la sainte putain, un film de Fassbinder de 1971). D’autres fragments nourrissent le spectacle, notamment des scènes de Phèdre de Racine. Poupées russes, disions-nous, ou coffre à jouets renversé dans une chambre d’enfant ; sauf que la prolifération est beaucoup moins désordonnée qu’il ne semble ; c’est bien la vie de Molière qui constitue le fil directeur et c’est un fil que Castorf ne lâche jamais. Les six heures de Die Kabale… se déploient donc de la naissance à la mort (on n’est pas si loin du Molière de Mnouchkine), dans un enchevêtrement permanent entre vie privée et vie publique.
Sur l’immense plateau du parc des expositions d’Avignon, tous les éléments du décor sont mobiles : roulottes, carrosses ou corbillards sont les seules maisons, abris précaires pour des comédiens obligés de parcourir des kilomètres en terrain découvert, surveillés et poursuivis par la caméra qui ne les lâche que rarement, exposés en permanence, comme si le cinéma était là pour s’assurer qu’ils ne quittent pas le champ du théâtre. Un théâtre en pleine lumière, qui court, qui crie, qui transpire, qui suscite parfois chez le spectateur une nostalgie du silence et du chuchotement mais dont la force vitale est ici non feinte. Et où les questions directement politiques – comment créer, ruser, se battre ? – renvoient toujours à l’amour des acteurs et de leurs corps.
Un jeu amoureux placé sous le signe de l’inceste, des rapports ambigus entre artistes et politiques – Molière et Louis XIV, Boulgakov et Staline, Castorf et le Sénat berlinois –, de la passion dévorante de Molière pour Armande Béjart, sœur ou fille de Madeleine, sa compagne, qui est peut-être sa fille à lui –, sans oublier les relations troubles entre le chef de troupe et ses acteurs. Avec en toile de fond d’autres questions existentielles – le vieillissement et la peur de la mort – elles aussi lisibles à fleur de peau, quand la caméra grossit les rides et les rictus.
Dans Molière, Castorf, comme Boulgakov, trouve à la fois un maître, un modèle, un frère, un repoussoir, un concurrent et un prétexte pour raconter son propre voyage des comédiens. Un périple qui mène de la farce à la tragédie, chacune donnant une coloration particulière aux deux parties du spectacle, et qui met comme jamais en lumière l’incroyable amour du metteur en scène pour ses acteurs, jusqu’à l’épuisement d’une deuxième moitié qui tire en longueur, comme si le maestro ne se résignait pas à baisser le rideau. Un amour que les acteurs lui rendent, eux aussi sans limites. Jusqu’au pur délire d’une scène où le cardinal (Lars Rudolph) et Louis XIV (Georg Friedrich) rejouent la leçon d’orthographe du Bourgeois gentilhomme, avec Louis XIV dans le rôle de Monsieur Jourdain et le cardinal dans celui du Maître de philosophie. Un duo de clowns dont la frénésie dépasse toutes les bornes, comme si Laurel finissait par se jeter sur Hardy pour l’embrasser à pleine bouche avant de le violer. Mais le grotesque n’est qu’un des registres ; versant mélancolie, Jeanne Balibar en pute vieillissante récitant Phèdre n’est pas triste non plus. Et que dire de Jean-Damien Barbin, nouveau venu dans la troupe, avec sa voix de basse, son allemand francisé et sa diction d’un autre temps ? Barbin, dont l’utilisation par Castorf tient aussi du private joke à l’intention de son collègue Christoph Marthaler, qui a fait d’un autre comédien français, Marc Bodnar, un pilier de sa troupe. Sans oublier la clé de voûte, Alexander Scheer, à lui tout seul Molière, Fassbinder et Castorf, ogre d’un spectacle qui dévore tout mais laisse heureux.
René Solis
Théâtre









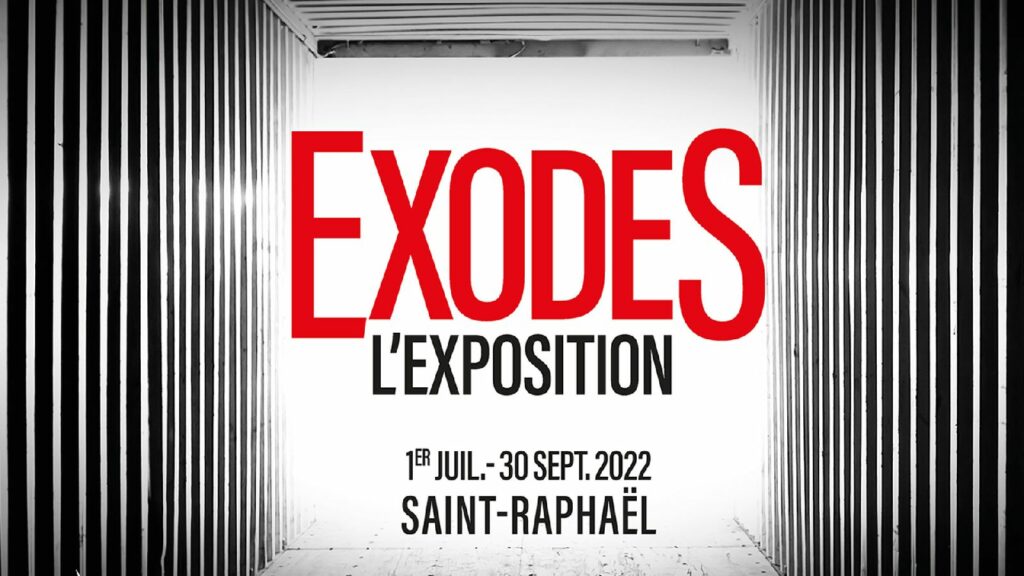


0 commentaires