Pour Ulysse
Vacances romaines, sans princesse ni Vespa. Nous débarquons de Fiumicino aeroporto par le train, puis la metropolitana nous jette sur les pavés en saillie de la place d’Espagne. Il est midi au milieu du mois d’août, lumière crue. Le soleil excite les groupes de touristes agglutinés au pied des escaliers qui grimpent à Santissima Trinità dei Monti. Nous tirons nos valises jusqu’à l’hôtel. Mon compagnon de voyage a quatorze ans, c’est son premier séjour à Rome.
Jeudi 16
Quand ils et elles te voient arriver avec ta gueule de touriste et tes buon giorno à l’accent pas d’ici, les Romains et les Romaines te parlent directement en anglais. Je déteste ça. Je leur réponds dans mon (mauvais) italien, que j’aime beaucoup mieux que mon anglais d’école. Être étrangère dans une capitale européenne aujourd’hui : soit tu es l’un des nombreux produits que le tourisme de masse envoie par charter toute l’année, alors bienvenue (welcome), machine à cracher du cash ; soit tu es migrant.e et c’est toi qu’on crache loin, loin, loin, dont on refuse d’entendre les appels à l’aide. Pour les relations humaines, l’empathie et la curiosité pour autrui, il faudra revenir dans une toute autre époque. Hier, l’orage nous a surpris dans les jardin de la villa Borghese. Réfugiés sous l’auvent d’un théâtre de marionnettes, avec des vendeurs ambulants de fleurs et de parapluies, avec des Italiennes qui se sont assises en attendant que ça passe et se sont mises à tirer les cartes du tarot : suspension momentanée du poids des rôles et des statuts, être seulement celle qui sursaute parmi les autres, quand l’éclair déchire le ciel juste au-dessus des palmiers et des grands platanes.
Vendredi 17
Fierté, curiosité ou manque ? Autour de la villa Médicis, se promènent le nez levé des familles françaises, plus nombreuses ou plus volubiles. c’est qu’il faut expliquer aux enfants que l’élégant bâtiment au-dessus duquel s’amoncellent les nuages, c’est la France. Et pour preuve, les éducateurs pointent l’index vers l’inscription Académie Nationale de France s’étalant sur le linteau de la porte. Les enfants regardent mais restent cois, redoutant peut-être qu’on leur inflige une nouvelle visite tandis qu’ils espèrent une glace. Mais il ne faut pas traîner quand les premières gouttes tombent et l’orage rassemble tout ces pèlerins en quête d’un peu de France en terre romaine, dans l’église de la Trinité-des-Monts. L’exil touristique, volontaire, éphémère et coûteux, sans autre danger qu’une arnaque ou deux mais toujours de bonne guerre, pousse irrésistiblement le touriste vers les éclats plus ou moins brillants de son pays de naissance, jetés à l’étranger. L’autre exil, le vrai, bien plus coûteux, définitif et d’urgence vitale, ne peut apaiser sa nostalgie à l’ombre des pierres d’aucune villa Médicis. L’exilé porte, profondément en lui, le regret du séjour qu’ont bâti ses aïeux, qu’il ne retrouvera jamais et moins encore quand par la force il est renvoyé d’où il vient, plus humilié et plus exposé au péril que jamais. L’exilé est lui-même cet éclat lancé ailleurs par sa terre maternelle, et qui n’attend que d’être accueilli pour briller.
Samedi 18
À l’entrée du Colisée travaille un essaim de vendeurs à la sauvette dont je n’ai connu de semblable qu’à Bobigny, autour de l’interminable file d’attente devant la porte close de la Préfecture. Vendeurs d’ombrelles et de bouteilles d’eau fraîche sous le soleil ici, mais de thé ou café chauds dans la nuit là-bas (nous étions en hiver quand j’accompagnai A. dans la pénible épreuve d’arracher à une guichetière revêche un nouveau dossier de régularisation), démarcheurs pour une visite privée avec billet coupe-file ici (prévoir un triplement du prix) ou pour faire la queue à votre place là-bas (très cher aussi et pareillement incertain.) Seuls les marchands à la peau brune s’envolent à la vue des uniformes, courant de la même foulée longue et souple que tous les pourchassés du monde, déterminés à survivre malgré la loi. L’orage nous est tombé dessus à peine avions-nous fait un pas à l’intérieur du monument. La pluie diluvienne égaye les visiteurs : il se passe quelque chose rompant la morne et épuisante routine touristique, on se réfugie en riant sous les arches, on sort les ponchos colorés achetés aux vendeurs à la sauvette, on filme le rideau de pluie s’abattant sur les vieilles pierres et les flaques où pataugent les enfants. L’averse est le grain de sable bloquant la machine à cash. Plus personne ne sort du Colisée, alors les guichets ferment et tout s’arrête, pour raison de sécurité. Les employés patientent, mollement accoudés à leur engin à rayons X. Nous écoutons dans l’audioguide la description tranquille des jeux organisés ici pour le divertissement de nos frères en cruauté des premiers siècles. Le grand spectacle de la mise à mort. Nous tendons le cou au risque d’être douchés pour repérer la porte par laquelle on évacuait les cadavres des prétendus criminels envoyés, les mains nues, sous les crocs des lions ou les griffes des ours, les corps des esclaves morts d’avoir tenté de gagner ainsi leur liberté.
Dimanche 19
Il n’y a d’abord que du bleu, lisse, dense : le voile de la Vierge tendu aux quatre coins, à se rompre. Le soleil cogne les ruines du forum et les visages grimacent sur les photos souvenirs. Puis, par derrière les dômes et le monstrueux palais à Victor-Emmanuel, se lèvent des nuages spectaculaires, d’un blanc sans taches, aux boursouflures épaisses, d’aspect changeant. Ils se répandent sans hâte apparente, impérieux. Soudain, on voit se former au milieu de cette chantilly, une ombre grise, ronde comme un œil crevé : c’est l’orage. Nous nous demandons vers où nous courrons bientôt nous abriter. Je suis à Rome avec mon fils de quatorze ans et ne sais ce qu’il retiendra de ce voyage. À l’hôtel, je lis Entre les deux il n’y a rien. Le livre de Riboulet s’ouvre sur le voyage que le narrateur fit en Pologne avec ses parents, au même âge, il décrit l’éveil de sa conscience politique et la révélation de sa sexualité. Ce que l’on vit, on le comprend toujours plus tard, quand tout a changé. Pourtant, il reste quelque chose de soi-même, un immuable que l’adolescence a dévoilé et que l’on traîne en soi, qu’on le veuille ou non, le restant de nos jours. Les années 1970, les hommes et les femmes tuées comme des chiens dans les rues allemandes, italiennes, françaises, par les forces diverses de la répression, la conscience de ces crimes politiques qui se forge peu à peu tandis que l’on bascule dans l’âge d’homme : je les ai vécues aussi. Lecture en équilibre, belle et troublante, entre mes souvenirs de ces années, lointains mais bien là (j’ai eu quatorze ans en 81, juste après l’élection de Mitterrand qui sonne la fin d’un temps) et l’impossible connaissance de ce qui s’élabore aujourd’hui dans le cœur et la tête de mon fils, de ce que cette époque fera de lui, de ce qu’il fera de ce champ de ruine intellectuel et politique, sans beauté ni espoir que nous lui offrons pour tout horizon.
Lundi 20
Rapide excursion à la plage. Je pensais que prendre le métro pour se rendre à la mer amuserait mon compagnon, mais il n’a pas envie de se baigner. Je voulais voir le lido, Ostie, avec dans la tête les lignes de Riboulet sur Pasolini, pédé comme lui, son meurtre quelque part ici, battu et abattu comme un chien. Les plages privées s’alignent, collées au bord de l’eau tiède qui clapote. Nous finissons par trouver la bande de plage libre où il nous est permis de poser nos fesses sans payer. Sable cendre, soleil de plomb et, côté grève, ces immeubles ocre jaunes (des HLM ?), tagués en bas : les paraboles et le linge qui sèche aux fenêtres nous indiquent qu’ils sont habités. Deux enfants russes creusent un énorme trou à nos pieds. Nous partons.
C’est dans l’une des toiles du Canaletto exposées dans les salles fraîches du Museo di Roma, peu fréquentées l’après-midi malgré l’orage, dans l’une de ses précises vedute, que je voudrais vivre. Être, dedans, une des taches vermillon guidant l’œil vers l’infini.
Mardi 21
Orage avorté. Les nuages, pourtant aussi prometteurs que la veille et l’avant-veille ou comme le jour d’après, quelques grondements du tonnerre, assourdis, un début d’averse. Polyphème coléreux mais prisonnier de sa grotte suffit à nous effrayer tant nous sommes prévenus. Nous abandonnons la promenade au pied du Janicule et sautons dans le premier café venu. C’est un bar sans chichi, avec des gens du quartier qui se saluent en se claquant la bise, hommes et femmes. Des habitués accoudés au bar nous regardent, l’œil rond, nous asseoir chez eux. Rome comme Paris est double, il y a la ville pour les touristes, et l’autre. Un pas de côté, poussés par la pluie, et nous sortons des rails qui nous sont impartis, nous dévions du parcours spécialement élaboré à notre intention, nous ouvrons une porte interdite : nous devenons intrusifs. Plus de vendeurs de roses, de sosie papal, de Romains déguisés comme dans Astérix, de fabricants d’image du Colisée en pochoir colorés, de water water umbrella ponchos, de mauvais repas vendus trois fois trop cher, et toute cette méchante soupe servie partout aux touristes du monde pour qu’ils filent leur thune : ils sont venus pour se faire dévaliser, c’est là leur rôle et ils acceptent de jouer le jeu avec bonne humeur pourvu qu’on les laisse prendre des photos. L’accueil est poli, pas plus. Nous sifflons nos consommations en silence. L’ondée ne dure pas et nous retrouvons vite le troupeau dans les rues du Trastevere, déambulant, ravi, parmi les marchands de pacotille. Je me suis trompée, ce n’est pas à quatorze ans mais à douze que les parents du narrateur d’Entre les deux il n’y a rien, conduisirent leur fils à travers la Pologne communiste jusqu’à Auschwitz, qui n’était pas encore une destination touristique. Est-ce qu’on y trouve aujourd’hui des sosie de Hitler, faisant la quête devant les ruines du camp d’extermination ? Mon fils demande à aller à Tchernobyl. Je lui suggère plutôt de lire Svetlana Alexievitch. Mais il n’est pas satisfait. Il veut VOIR. Qu’est-ce qu’un garçon de quatorze ans voit dans les ruines de la Rome antique ? Qu’est-ce qu’il espère voir à Tchernobyl ? Qu’est-ce qu’il verrait si nous allions à Auschwitz ? Nous errons dans la capitale d’un pays dont le ministre de l’Intérieur s’obstine à vouloir ficher les Roms, avec l’accord de la majorité de la population si l’on en croit les sondages. Ficher d’abord, et quoi ensuite ?
Mercredi 22
Je suis insensible à la beauté de Saint-Pierre de Rome. Ce faste à la dimension de Dieu me laisse de marbre. Après une heure pleine dans l’enfer chauffé à blanc de la file d’attente sur la place, après le portique de sécurité, après le passage entre deux gardiens chargés d’évaluer la correction de nos tenues, nous errons dans la basilique, la nuque cassée de tant lever le nez dans cet univers de géant. Je sens bien que la Pietà aurait quelque chose à me dire, que l’immense douleur de la mère tenant entre ses bras le corps de son fils adulte, qu’elle ne peut plus réchauffer, est à taille humaine mais il y a devant une rangée de dos, une balustrade, un verre de protection et tant de vide que la sculpture en vrai ne peut rien transmettre de plus que sa carte postale sinon son manque. On se rencontrera peut-être un jour, dans une autre vie, un autre monde où les êtres et les œuvres seront à nouveau visibles, après la révolution qui aura effacé du souvenir des humains qu’il y eut une époque où tout était marchandise, que le seul sacré que l’on respectait était celui de la marchandise, et qu’il fallait protéger de l’avidité touristique les sculptures de Michel-Ange en les enfermant dans un coffre-fort transparent. Le baldaquin du Bernin me donne envie de retourner en courant à la galerie Borghese, et me planter devant la terrible délicatesse de sa Daphné se métamorphosant en laurier pour échapper à la folle concupiscence d’Apollon. Pourquoi on vient là puisqu’on n’est pas chrétiens ?, me demande mon fils qui ne semble guère ému par ces débordements baroques et juge de mon désarroi par mon silence. Est-ce la foi qui nous manque, ou est-ce la détestation du pouvoir, ici celui de l’Église, suintant des murs et des coupoles, de toute cette gloire céleste exhibée, qui nous jette au bout d’un quart d’heure seulement hors de la basilique puis du Vatican comme on se sauve en soufflant d’un quartier mal famé ?
Jeudi 23
Au moment même où la ville change de visage, alors que l’on commence à circuler à l’aise Via del corso, Via della Ripetta, Via Giulia, du Mausoleo di Augusto au Castel sant’Angelo sans regarder la carte, que l’on prend le métro en n’ayant plus l’air de deux imbéciles qui tournent leur ticket en tous sens avant de réussir à le faire avaler par la machine à composter, que l’on sait aller au ristorante Napul’è que nous a conseillé C., que nous retournons les yeux fermés à Pizza forum recommandé aussi par C. et que le serveur nous demande en italien d’où nous venons, combien de temps nous restons et nous suggère de goûter aux pâtes, que l’employée du petit supermarché ne lève plus les yeux aux ciel car maintenant je sais comment peser mes fruits avant de passer à la caisse, au moment où j’ai enfin compris qu’il est préférable de payer en liquide pour être bien vue et que je jette un œil distrait mais intéressé sur les annonces d’appartements à louer collées sur les murs à l’angle des rues, il faut partir. Hier, nous avons circulé longuement parmi l’odeur des pins dans les allées et sur les places de l’Ostia antique, tentant d’imaginer comment on vivait, ici, il y a deux mille ans. L’économique, le religieux, l’administratif, l’artistique, tout semble tellement aller de soi, s’imbriquer l’un dans l’autre sans solution de continuité, comme si chacun avait sa place, sa maison parfaitement conçue avec cette cour intérieure si tentante, comme s’il n’y avait rien qui puisse être pensé hors de cet agencement social et politique qui englobe tout et qui est tellement civilisé. On en oublierait presque les guerres, l’esclavage et le Colisée. L’orage nous est tombé dessus en soirée. Réfugiée sous un porche de la Via del Corso et tout en refusant les propositions de ponchos que me faisaient les vendeurs trempés jusqu’aux os qui couraient sous le déluge d’un trottoir l’autre à l’assaut des passants, je regardais par une fenêtre éclairée, ouverte, un plafond en bois, poutres et plancher apparents, un pan de rideau gris bleuté bougé par le vent. Comme à Ostia, cette même question : qu’est-ce que ça signifie être romain, vivre ici ?
Juliette Keating






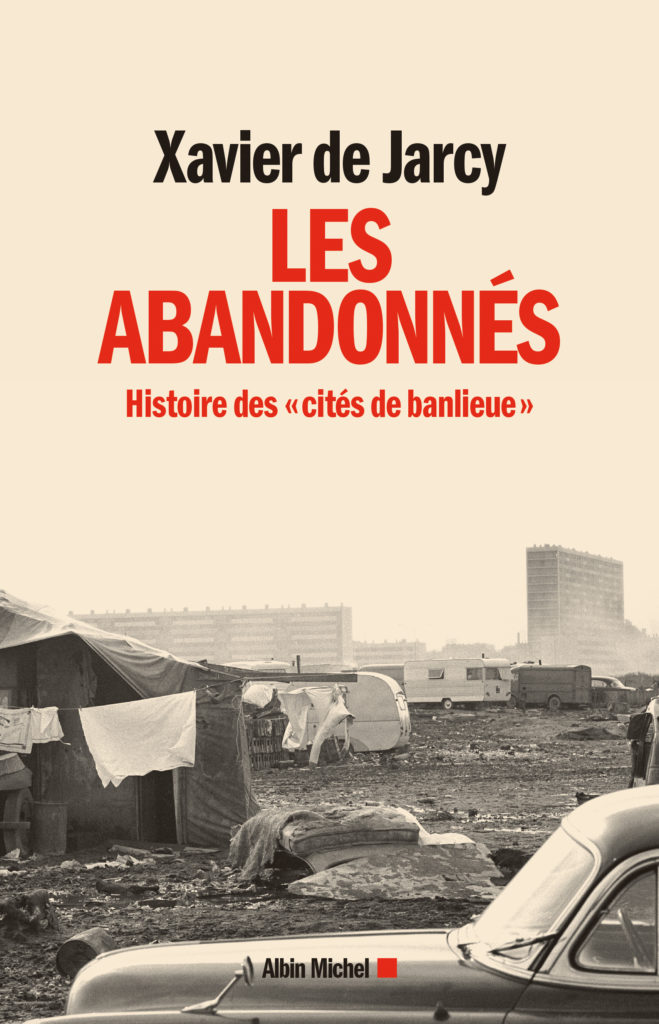



0 commentaires