 Longtemps je me suis couché de mauvaise heure, à quêter des euphories ici ou là dans la nuit parisienne. Mais quand il m’en fallait retourner à pied là où j’habite depuis 20 ans, 80 boulevard Barbès – là où la large et longue avenue, après avoir grimpé de Rochechouart à Château-Rouge, dégringole jusqu’à Marcadet, avant de se tordre pour redevenir Ornano –, je me livrais à un bien étrange rituel.
Longtemps je me suis couché de mauvaise heure, à quêter des euphories ici ou là dans la nuit parisienne. Mais quand il m’en fallait retourner à pied là où j’habite depuis 20 ans, 80 boulevard Barbès – là où la large et longue avenue, après avoir grimpé de Rochechouart à Château-Rouge, dégringole jusqu’à Marcadet, avant de se tordre pour redevenir Ornano –, je me livrais à un bien étrange rituel.
Je ne marchais alors que d’un côté du boulevard : trottoir de gauche.
Même quand je m’en revenais de l’est, voilà qu’arrivé au carrefour de Barbès-Rochechouart, je traversais une première fois, remontais tout le boulevard, et parvenu à la hauteur de mon immeuble, je traversais à nouveau. Quelque cérémonial secret ? Quelque TOC pittoresque ? Non, rien qu’un peu de peur sur le goudron de Paname : c’est que longtemps le trottoir de droite m’a paru bien plus dangereux, le territoire des toxs et des macs, là où une embrouille est si vite arrivée.
Il n’est qu’à longer le Boulevard Barbès une nuit d’été, pour voir se tracer une frontière sur la carte de la ville. Une frontière pas moins prégnante que le flot d’un fleuve entre deux contrées. À si souvent fouler ce bitume, je me le suis toujours figuré comme ces points d’eau de savane dont les documentaires animaliers font des lignes de partage entre telle ou telle espèce.
Sur le trottoir ouest, vous croiserez bien quelques figures fantômes, qui comme moi marchent d’un bon pied, regard baissé pour ne pas avoir à croiser le vôtre. Mais au-delà des six voies du boulevard, juste en face, vous frôlerez vendeurs à la sauvette et prostituées d’Afrique, drogués en manque et mâles en conversation, tout un monde qui bouge et palabre – et plus encore, se tait et piétine sous la bise du soir, parmi les papiers gras et les plastiques volants.
Nous sommes ici au seuil du pâté de maisons de la Goutte d’Or, là où se trame le réseau des rues censées effrayer le bourgeois et dégoûter la ménagère : rue Mirha, rue Poulet, square Léon, marché Dejean… Tout un XVIIIe populaire, chargé de bruits et de trafics, qui se prolonge de l’autre côté des rails, côté Marx Dormoy / La Chapelle.
Longtemps aussi, m’en revenant d’un ami cher logé rue Léon, j’ai traversé le quartier à 4 heures du matin. Désert grisâtre sous la lueur jaunasse des réverbères, où fleurissent poubelles renversées et pisses sauvages, hanté soudain d’un spectre à l’horizon. J’entendais comme résonner la voix off de Travis Buckle, le Taxi Driver dont Scorcese et De Niro ont fait un si puissant anti-héros, sa voix de misanthrope qui psalmodie au rythme des longs travellings latéraux sur le New York trash de la fin seventies. Et d’avoir traversé une telle jungle urbaine sans perte ni péril, je me sentais moi aussi vétéran, comme lui rescapé du Vietnam. On a les Enfers qu’on peut.
Maintenant que vous vous êtes offerts le frisson d’un voyage au bout de la nuit, franchissez le boulevard Barbès à nouveau, et montez côté ouest.
Vieilles briques et poutres de la Halle Saint-Pierre où se cache un joli musée d’art brut ; boiseries vernissées et bacs colorés des magasins de tissus du Marché Saint-Pierre qui juste à côté, semblent rejouer sans cesse Au Bonheur des Dames ; terrasses et escaliers de Montmartre, foules et enseignes de Pigalle, et les milles et une vies touristiques ou branchouilles qui y grouillent ; façades classiques plus au nord, vers Jules Joffrin et Lamarck Caulaincourt, ces coins pleins de traiteurs sympas, de bistrots sympas, de familles sympas – si sympas qu’on voudrait tout brûler.
Il y a comme deux arrondissements dans le XVIIIe, et la frontière du boulevard Barbès reconstitue en miniature la géopolitique de la capitale et de l’Île-de-France : les plus riches à main gauche, les vrais pauvres à main droite. Une partition héritée du XIXe siècle et de sa révolution industrielle, quand l’urbanisme et la sociologie de la métropole se sont fixés… en suivant le sens du vent, lui qui souffle d’ouest en est dans le bassin. Alors aux Misérables, les effluves des abattoirs et les fumées des usines !
Le boulevard Barbès nait lui-même sous le Second Empire, de cette mutation de la capitale, qu’Haussmann troue alors de lignes droites assez larges pour qu’y circulent les miasmes, censément chargées de maladies, et s’il faut, le canon de la troupe destiné à disperser les barricades de ces révolutionnaires de Parisiens. De 1863 à 1868, le Baron fit percer ses 835 mètres de long sur 30 de large, sur l’ancienne rue Lévisse, en prolongement de Magenta. Lui-même aurait préféré la pente moins marquée de la rue Poissonnière qui lui est parallèle, mais plus royalistes que le Roi, les riverains ne voulurent pas de ce tracé trop sinueux. Et Émile Zola d’en décrire le chantier dans une page de l’Assommoir :
« C’était à ne plus s’y reconnaître. Tout un côté de la rue des Poissonniers était par terre. Maintenant, de la rue de la Goutte d’Or, on voyait une immense éclaircie, un coup de soleil et d’air libre ; et, à la place des masures qui bouchaient la vue de ce coté, s’élevait, sur le boulevard Ornano [ici rebaptisé Barbès quelques années plus tard], un vrai monument, une maison à six étages, sculptée comme une église, dont les fenêtres claires, tendues de rideaux brodés, sentaient la richesse. »
Tant d’obsessions hygiénistes et sécuritaires, pour qu’aujourd’hui, au pied des façades « haussmanniennes » donc, et au milieu des détritus, on craigne les mauvaises rencontres aux heures indues !
Mais j’ai trop vécu par ici pour avoir toujours peur, et tous les trottoirs sont miens désormais. Et pourtant, à un autre Parisien qui me demande où j’habite, je réponds, tant à l’angoisse de jadis s’est substituée, pas moins conne, comme une drôle de fierté mal placée, comme une ironie trop facile : « J’habite boulevard Barbès, mais du mauvais côté. »
Thomas Gayrard
(No-)go zone
GuardarGuardar




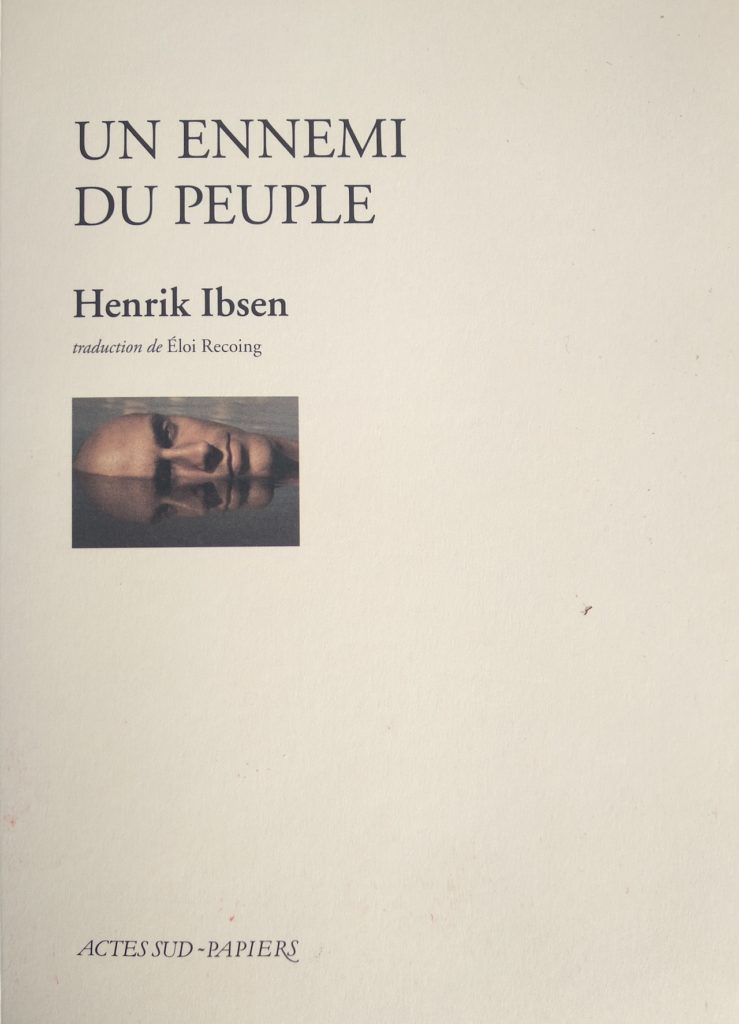






0 commentaires