Championne des spectacles longs, Marie-José Malis récidive au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers qu’elle dirige. Après le Dom Juan de Molière présenté à l’automne (près de cinq heures de représentation), elle étire sur une durée équivalente Vêtir ceux qui sont nus, de Pirandello, au risque de mettre à mal la patience des spectateurs. Sauf que cette fois, le parti pris de la lenteur fonctionne : le calvaire d’Ersilia, l’héroïne de la pièce, est restitué avec une intensité qui questionne et bouleverse.
Dans Pirandello, Marie-José Malis projette une partie de ses préoccupations artistiques – la question de la vérité, le théâtre comme moyen d’accéder à la vraie vie. « Pirandello, écrit-elle dans le programme du spectacle, est pour moi révolutionnaire. [Son théâtre] sert à construire une nouvelle conception de la réalité, qui est aussi la conception d’une hospitalité, un élargissement des frontières entre la réalité et ce qui en est d’habitude rejeté ou nié ou redouté. »
Après On ne sait comment et La Volupté de l’honneur, Vêtir ceux qui sont nus est la troisième pièce de l’auteur italien qu’elle met en scène depuis 2011. Avec, toujours, le souci de faire entendre en prenant le temps et en refusant les artifices traditionnels de la représentation : les lumières de la salle restent allumées, les changement de décors et d’accessoires se font à vue, etc. Une logique poussée encore plus loin cette fois : les spectateurs n’ont pas le sentiment d’être dans une salle mais autour d’un plateau de répétition, intégrés à un work in progress, où les comédiens se désaltèrent entre deux scènes, et où, pour aérer, on ouvre la porte donnant sur la rue (rafales de vent glacé, bruits de moteur, brouhaha urbain). À cela s’ajoute la présence, parmi les spectateurs, d’une douzaine d’élèves de L’École des Actes, structure imaginée par le théâtre à l’intention de jeunes déscolarisés, d’étrangers, de migrants, d’exclus, c’est-à-dire, très largement, de tous ceux qui ne vont d’ordinaire pas au théâtre. Leur présence étonne voire dérange (jouent-ils le rôle d’alibi ? n’y a-t-il pas une part de démagogie à les faire venir, et à les maintenir dans un entre-deux, mi-spectateurs, mi comparses ?). Mais l’on peut aussi se dire qu’ils sont, tout simplement et tout comme Ersilia, la suicidée ramenée in extremis à la vie, ceux qui ne devraient pas être là, des pièces rapportées du réel à l’intérieur de la représentation, et pour le coup des personnages parfaitement pirandelliens.
Il y a dans la pièce, une dimension mélodramatique (la triste histoire d’Ersilia, jeune gouvernante abandonnée de tous après la mort accidentelle de la petite fille dont elle avait la charge) et une part comique (via le personnage de Madame Onoria, la truculente logeuse du vieil écrivain Ludivico Nota qui a recueilli Ersilia chez elle, à la sortie de l’hôpital). La mise en scène de Marie-José Malis n’occulte pas ces deux composantes mais ne lâche jamais l’essentiel, le fil d’une tragédie intime et politique en résonance directe avec l’actualité.
Ce que la pièce de Pirandello met en lumière, c’est d’abord la violence inouïe des rapport entre les hommes et les femmes. Violence d’autant plus saisissante que Pirandello l’aborde sous l’angle des bons sentiments. Tous les hommes qui se pressent au chevet d’Ersilia prétendent faire son bien : Nota l’écrivain, « profondément touché » par l’histoire de la jeune-femme ; Cantavalle, le journaliste dont l’article qu’il lui a consacré a déclenché la compassion généralisée ; Laspiga, le fiancé qui l’avait abandonnée, obsédé par l’idée de « réparer » le mal qu’il lui a fait ; et enfin le consul Grotti, son ancien employeur, qui veut « partager » avec elle une culpabilité trop lourde. Tous désolés, attentifs, prévenants, désespérés, qui rêvent par ailleurs de coucher – ou de recoucher – avec elle, poursuivent un seul but : avoir le beau rôle, et nier à Ersilia toute existence autonome. Tous penchés sur elle en toute bonté, comme des tortionnaires qui auraient ramené leur victime à la vie pour continuer à la torturer.
Face à eux, Ersilia n’aspire qu’à une chose : le droit d’en finir, de voir respecter la radicalité de son malheur : « Je vous en prie, laissez-moi mourir en paix », c’est son leitmotiv. Et ce sont les innombrables nuances de ce combat que l’on entend tout du long de la représentation. Avec en point d’orgue la longue scène entre Ersilia et le consul, à la fin du deuxième acte, où la révélation du secret – il y en a un, et il est littéralement insupportable – importe moins que la mise à nue des rapports qui les unissent. Tout est là, les ambiguïtés du désir et du consentement, les eaux troubles et les zones grises des mécanismes de la domination masculine. Avec une acuité et une modernité qui sidèrent.
Entre la violence de ce que l’on entend et l’étirement du temps, il est inévitable que certains décrochent, voire s’exaspèrent. On parierait pourtant que même chez ceux qui sortent bien avant la fin, l’impact est là : ils n’oublieront pas ; ils reverront la robe bleue, les mains tordues et les bras ouverts de Sylvia Etcheto, qui interprète Ersilia, telle une pietà qui referait toujours le geste de porter le fardeau ; ils reverront les rideaux que l’on tire en vain et qui ne cachent rien ; et peut-être même leur reviendront les derniers mots d’Ersilia qu’ils n’auront pas entendus : « Allez-vous en, à présent, sortez. Laissez-moi mourir en silence : toute nue. Allez. J’ai bien le droit à présent, il me semble, de ne plus voir personne, de ne plus écouter personne ? »…
René Solis
Théâtre
Vêtir ceux qui sont nus, de Pirandello (la traduction n’est pas signée, Marie-José Malis s’est sans doute inspirée la version de B. Crémieux et M.-A. Comnène, publiée aux éditions Gallimard en 1951). Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, jusqu’au 28 mars.


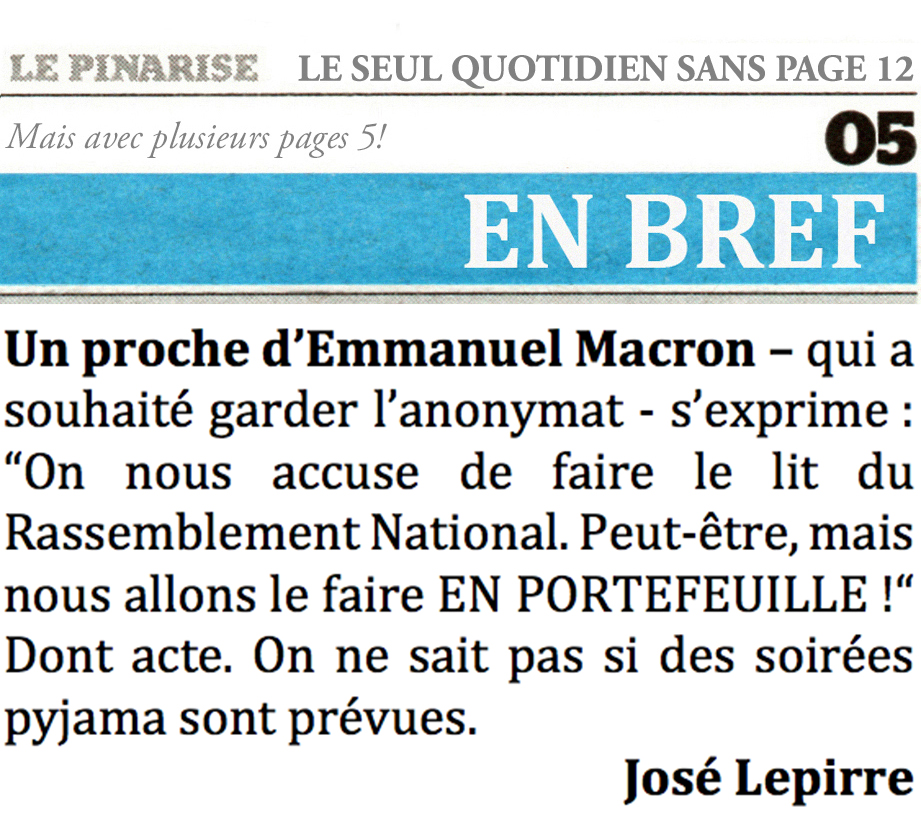






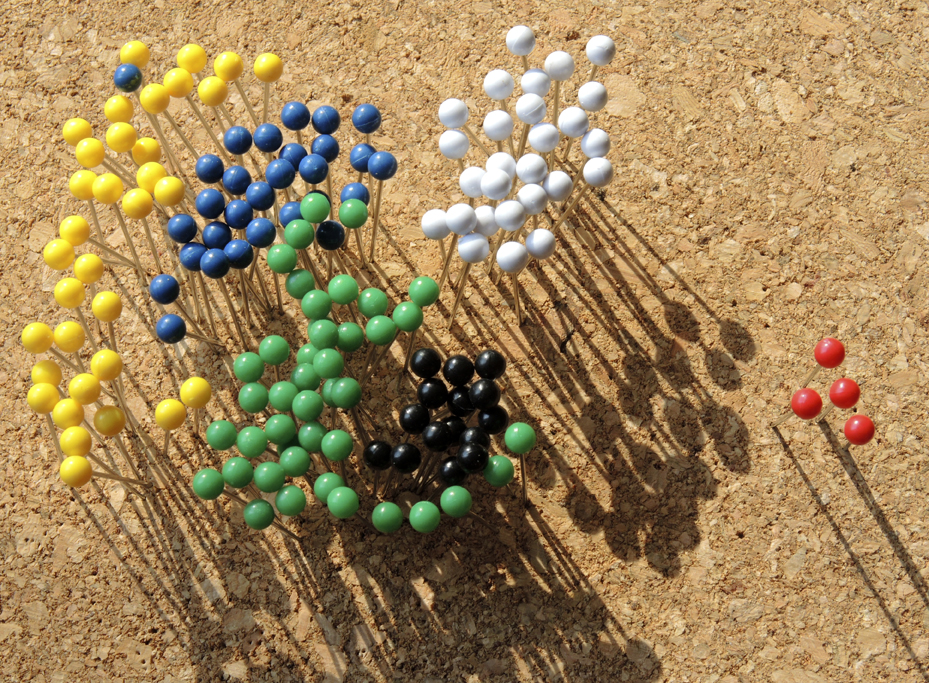
0 commentaires