Eux, bien sûr, se croyaient immortels.
Absolument convaincus que le passé, le présent et le futur étaient des éléments interchangeables dans un cycle de vingt-quatre heures. C’était la conséquence d’un certain manque de passé, d’un excessif respect involontaire et désinformé pour le présent et d’une absence de réflexion sérieuse sur le futur. Ils n’avaient pas la capacité d’imaginer le futur de façon pessimiste. Et donc même pas l’intuition qu’il existait une chose appelée l’avenir.
Ils croyaient fidèlement à la multitude de fantastiques paradis futurs qui en ce temps-là étaient à la mode, et bien entendu ils n’étaient pas concernés par la phrase diabolique de Paul Nizan qui faisait de l’adolescence et de la jeunesse un malheur irréparable ; même s’ils la citaient souvent, réécrite par la plume de Malraux.
Ils parlaient d’eux-mêmes comme s’ils étaient volatiles, éphémères, comme s’ils avaient toujours été au bord de la disparition ou de la consécration. Ils avaient l’air de héros fatigués à peine sortis de l’adolescence, disciples d’un Houdini maoïste doté du sens de l’humour, ou personnages d’un Rulfo léniniste, urbanisés par cinquante ans de magie répétitive et d’autoritarisme d’État orchestrés par le Parti révolutionnaire institutionnel.
Ils avaient l’intuition que rien n’était vraiment impossible. La faute peut-être au climat, à l’atmosphère irréelle régnant à Mexico dans les années 1960, aux pluies pernicieuses de ce mois de septembre.
C’étaient des jours où les illusions s’évanouissaient sans laisser l’amertume de la défaite, parce qu’elles avaient été rapidement remplacées par d’autres illusions nouvelles, tout aussi attirantes. Ils avaient une légère admiration pour les Pumas, parce que c’était l’équipe de l’université et qu’elle était montée en première division. Ils admiraient quelques rares sportifs, seulement les improbables et les fous, tels le Tchèque Emil Zatopek, la locomotive humaine, ou l’Éthiopien Abebe Bikila, maigre et décharné, rejeton d’une grève de la faim, mort à 41 ans, deux fois vainqueur du Marathon ; et bien sûr Sir Edmund Hillary et le sherpa Tensing, auquel le Néo-zélandais avait dit que l’argument suprême pour monter au sommet de l’Everest (8848 mètres gravis par l’impossible voie directe que plus personne n’emprunte), c’était “because it is there” (parce qu’il est là), phrase restée sans réponse car le sherpa avait gardé pour lui ce qu’il en pensait : qu’il le savait depuis longtemps.
Ils portaient des chemises blanches et bleues en coton épais et des bluejeans évasés, mais pas à pattes d’éléphant ; elles avaient des chemisiers roses et bleu pâle, avec des broderies mexicaines, et des jeans, parce que la minijupe n’était pas la compagne idéale pour passer ses après-midis et ses soirées dans les quartiers ouvriers.
Ils et elles arpentaient sans relâche, tels des Peter Pan et des fées Clochette au gouvernail du cuirassé Potemkine, une ville sale et âpre, où, si tu n’y prenais garde, on pouvait te déchirer les bas avec un rasoir, te voler tes illusions, te torturer, te jeter sur le plancher d’une voiture de police et te briser la mâchoire à coups de pied, t’arracher un œil avec une pointe métallique, te faire piétiner par des chevaux, te mettre des pinces électrifiées sur les couilles jusqu’à te faire ressembler à un arbre de Noël, te remplir les poumons de gaz et les côtes de coups de matraque, te faire aller jusqu’à l’extrême limite de la peur et des larmes.
Ils et elles se croyaient immortels et incorruptibles. Le temps, qui est une saloperie, s’est chargé de leur prouver le contraire, à une variante près : quelques-uns, quelques-uns seulement, étaient corruptibles, mais tous étaient mortels.
Paco Ignacio Taibo II
Traduit de l’espagnol (Mexique) par René Solis
© délibéré 2016
[print_link]



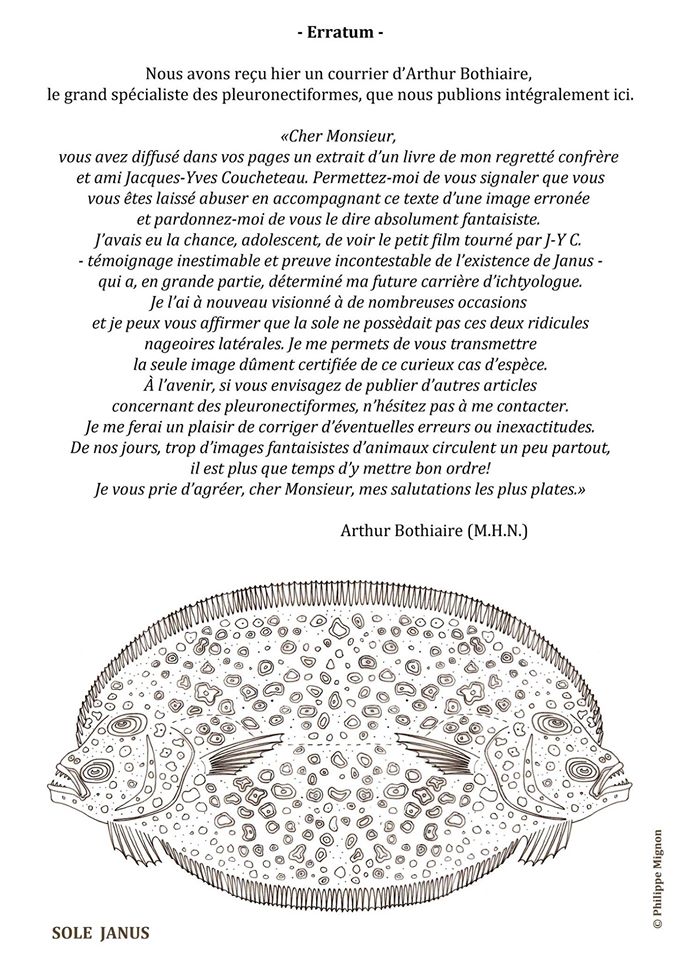


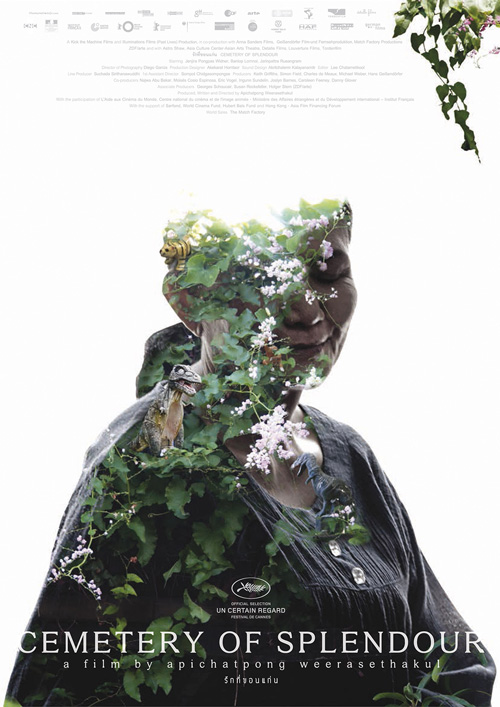


0 commentaires