Goutte d’Or–Barbès, quartier-monde, oxymore urbaine, marge au cœur de Paris. Enclave en mutation, exclusion et gentrification sur le même trottoir. Jamais aussi attractif que depuis qu’il a été déclaré “no-go zone”.
Chose promise, chose due : voici une petite histoire criminelle du 32, rue Polonceau, des origines jusqu’à l’époque où Patrick Modiano imagine Dora Bruder y loger, afin de mettre en évidence une fois encore, si besoin était, cet esprit des lieux qui, à la Goutte d’Or, survit aux changements de propriétaires comme aux démolitions [1].
On l’a dit, l’hôtel existait déjà à l’époque de la guerre de 1870, le propriétaire Jaffran offrant six lits aux blessés de guerre (on retrouve la trace d’un François Gagnon et d’un Prosper Alfred Bonneau, tous deux âgés de 23 ans et appartenant à la Garde nationale mobile du Loiret, qui y furent transportés et y décédèrent en janvier 1871). Auparavant, sur ce terrain où se dressait jadis le moulin des Couronnes (disparu avant 1850 selon l’étude d’Émile Eudes), on trouve trace d’une institution Brémant, dont les élèves obtinrent six médailles et une mention de la Société Élémentaire en 1865, remises en Sorbonne par un baron Ladoucette. En 1870, signe de l’évolution du quartier, l’institution Brémant avait déménagé à Bercy, avant la rue Daumesnil (« une belle avenue dans un quartier très sain », proclame la brochure de cette école de commerce et d’industrie, sans rien avouer de son passé rue Polonceau) et enfin Fontenay-sous-Bois (Émile Henry, l’anarchiste, y fut élève en qualité de demi-boursier, avant d’entrer à Jean-Baptiste-Say et d’échouer au concours de l’École Polytechnique).
De bien beaux débuts, avant que l’hôtel ne fasse son entrée en grande pompe dans la rubrique des faits divers en 1884. Cette année-là, en septembre, des serveuses sont molestées dans un café du boulevard de la Chapelle par deux garçons bouchers allemands (« ivres comme des Allemands », précise Le Matin). Elles se réfugient chez un marchand de vin voisin, où une bagarre éclate entre les habitués et les garçons bouchers (l’un deux, un dénommé Baumen, « cassa trois têtes »). Le lendemain à 6 heures, la police fait une descente au 32, rue Polonceau où les garçons bouchers logeaient (un meublé de 35 chambres, propriété d’un certain M. Hatton) et embarque le reste de la bande de la Chapelle : Pépin, dit la Boule ; Chatelin (ou Chatelain) dit la Guiche ; d’Oges dit le Bistrot ; et une fille Maheu (mais le chef de la bande, Cellier dit le Manchot, « sous le coup de dix-huit accusations différentes » selon Le Petit Parisien, s’est échappé). Les jours précédents, la bande avait volé 225 francs à l’ouvrier Schlœber boulevard de la Chapelle, son portefeuille au rentier Hébert, et cambriolé plusieurs appartements rue de la Chapelle (La Petite République). D’après Le Matin, deux mille personnes se sont massées devant l’hôtel pour porter main forte aux « six agents en bourgeois ». Précision importante : l’hôtel a « deux issues : toutes les précautions sont bonnes » (est-ce de cette façon que Cellier, « prévenu à temps », s’est échappé ?). Ainsi, dès l’origine, le lien est-il établi entre le bâtiment et le crime !
Dix ans plus tard, en mai 1894, une autre bande est démantelée, celle des Étrangleurs : Alfred Lafont, dit Albert le Cocher (26 ans) ; Adolphe Claudel ; Alfred Bragard, dit Colibri (20 ans) ; et Paul Berteaux, dit Paulot de la Villette (26 ans), étaient des spécialistes du coup du père François. Le dernier nommé logeait au 32. Le chef de la Sûreté Goron retrouva des montres et des bijoux dans sa chambre (Le Petit Parisien). À ceux qui ne connaissent pas le coup du père François, Jean Cousin (19 ans), souteneur condamné sept fois, se charge l’année suivante d’en rappeler les subtilités : rue Saint-Luc, il attrape nuitamment Jean Guillancey (ou Delancey) par derrière pour l’étrangler, avant de l’assommer à coups de nerf de bœuf au visage pour lui dérober les 60 francs de sa semaine. Le maçon venait de jouer avec son agresseur plusieurs parties de cartes dans un débit de boisson de la même rue, chez la veuve Angla, et rentrait à son hôtel de la rue Polonceau passablement gris. Il fut retrouvé à demi-mort, sous la neige (La Presse).
En janvier 1900, d’autres voleurs moins redoutables sont pris la main dans le sac, dans un dépôt de charbon des Mines du Nord : Jean Boucher (20 ans), Julien Rabot (21 ans), Gustave Dupré (20 ans), Alphonse Mauroy (19 ans) et Henri Fister (21 ans), un Allemand (encore un !) domicilié au 32, s’enfuient à l’arrivée des agents mais des cochers alertés par les coups de feu leur barrent la route. À l’époque, la police peut décidément compter sur l’aide des braves gens… (Le Petit Parisien). Deux ans plus tôt, en février 1898, un gang de voleurs de voitures était démantelé après une filature. Quatre d’entre eux habitaient l’hôtel (La Presse). Digne héritier de ces pieds nickelés, le jeune Maurice Roussel (18 ans), que les agents surprennent en flagrant délit de vol de bicyclette, au faubourg Saint-Martin, en janvier 1912. Dans sa chambre du 32, ils trouvent la cantine volée à un officier du génie, et, dans les chambres voisines, cueillent ses deux complices, Georges Lajoie (21 ans) et Pierre Overath (25 ans) (Le Journal).
C’est que l’époque des apaches est révolue. Trois mois après le pauvre Maurice, Jules Bonnot est abattu. Les bandes laissent petit à petit la place à la criminalité ordinaire, fruit de la misère et de l’alcoolisme. Certes, l’hôtel n’a pas attendu le tournant du siècle pour abriter ses premiers drames familiaux, d’autant qu’un débit de boissons occupe le rez-de-chaussée et qu’on s’y enivre. Ainsi, en août 1890, c’est un père et son fils qui en viennent aux mains dans le bar de M. Picail (selon La Lanterne) ou Piévul (selon La Justice) : Bienvenu Gardier (51 ans) est marchand d’oiseaux, lui et son fils Pierre (24 ans) demeurent au 42, ils sont venus en voisins. Après une dispute aux causes floues, le père frappe le fils de quatre coups de couteau au visage et au cou, sans le tuer. Trois ans plus tard, en juin 1893, c’est un drame conjugal, cette fois, dont le coupable est (décidément !) encore un Allemand (« mais comme beaucoup de ses compatriotes vivant à Paris, il ne se vantait pas d’avoir vu le jour dans le pays des casques à pointe et se disait Luxembourgeois») : Pierre Glodt (36 ans) vivait rue Cavé avec sa femme et leur deux enfants, Suzanne (8 ans) et Léon (6 ans), mais il battait Mme Glodt, laquelle quitta le domicile conjugal avec Suzanne pour s’installer au 32, rue Polonceau. L’Allemand l’atteignit de cinq coups de révolver et « n’a manifesté aucun repentir de son crime » (La Lanterne).
À l’image du pauvre maçon Guillancey et de Mme Glodt, des victimes logent 32, rue Polonceau aussi bien que des criminels. En mars 1906, le plombier Ernest Delavaux, domicilié à l’hôtel, se fit fracturer le crâne à coups de canne plombée boulevard Rochechouart (La Lanterne). En août 1909, Adèle Doucet (33 ans), elle aussi pensionnaire du 32, reçut trois coups de couteau boulevard de la Chapelle (Le Radical). Elle survécut mais refusa de parler aux agents : les temps changent… Un mois plus tôt, une couturière nommée Jeanne Guérin (27 ans) s’était jetée par une fenêtre du troisième étage [2] après une dispute avec son amant Ernest Martin, jaloux (Le Radical). En plongeant vers les pavés de la cour, elle s’inscrivait sans le savoir dans la liste des suicidés de l’hôtel : Arthur Bernard, garçon coiffeur sans travail, qui s’était tué de deux coups de revolver au cœur dans sa chambre en octobre 1893 (Le Figaro) ; et Mme Rosalie Diessin (58 ans) qui s’était jetée dans la Seine en septembre 1896, quai de Gesvres, par crainte « de voir revenir une maladie qui venait de la quitter », mais fut sauvée par un gardien de la paix (Le Rappel). En septembre 1921, un autre des pensionnaires de l’hôtel, un électricien dénommé Eugène Durozoi, est frappé d’un coup de couteau à l’aine gauche au cours d’une dispute avec trois inconnus, boulevard de la Chapelle (L’Homme libre, La Lanterne, Le Radical, Le Journal et Le Populaire rapportent l’affaire : on se demande ce que M. Durozoi avait de si spécial). Quant à Carmen Basta, « femme galante », elle n’échappa que par miracle à Marcel Dupuis (22 ans), dit Manolo, dit le Singe, son amant, venu la tuer parce qu’elle voulait le quitter, et qui vida son chargeur sur les agents avant de disparaître. C’était en juillet 1913 (La Petite République).
Peut-on considérer comme une victime ce Giuseppe Legagni (Joseph Lignani selon Le Journal), peintre en bâtiment et hôte du 32, qui s’attaque avec deux complices à Mme Allemand (rien à voir avec les Allemands, cette fois) rue Rochechouart, en juillet 1914 ? Un peu trop sûr de son fait, il reste sur les lieux du crime avec « un petit air naïf » (selon Le Matin) et un coup-de-poing américain (selon Le Journal) assez longtemps pour que le mari de la corsetière l’assomme d’un seul et unique « maître coup de poing ». Autre cas difficile à trancher, celui de Marie Vassal, dite Berthier, en juin 1903. S’étant enivrée par désespoir après que son mari l’a abandonnée, cette pensionnaire du 32 croit reconnaître l’indélicat boulevard Diderot. En l’implorant de la reprendre, elle se jette sur un certain Clément Fauconnet, marié et père de trois enfants, qui récolte plusieurs coups de couteaux au visage en tentant d’expliquer son erreur à « l’ivrognesse exaspérée » (L’Echo de Paris).
Arroseurs arrosés, agresseurs et victimes, ces deux cas nous permettent d’en revenir aux nombreux voleurs, escrocs et autres assassins qu’a abrités l’hôtel. En avril 1921, c’est une certaine Avril Kaiser (23 ans) qui y est arrêtée pour vol (« Kaiser est en prison », titre le journaliste de L’Homme libre, confirmant au sortir de la Grande guerre ce vieux sentiment germanophobe qu’on a déjà rencontré). En juillet 1926, Eugène Gauvin (23 ans), garçon dans un café du boulevard Clichy et demeurant au 32, rue Polonceau, fracasse un siphon sur le crâne d’un de ses collègues (Paris-Soir). En décembre 1928, un musicien corse de Calanza, Octave Guidoni, est arrêté au moment où il sort de l’hôtel et inculpé de tentative d’escroquerie : il se faisait passer pour un officier de marine et portait « des brochettes de décorations indument » (Le Gaulois). Il avait déjà été interdit de séjour pour les mêmes faits mais se cachait dans l’hôtel, peut-être dans la même chambre que ce Jules Villain, déserteur du 23e Dragons, arrêté en novembre 1906 (La Libre Parole). Jules Villain était rémois, comme son homonyme Raoul, l’assassin de Jaurès, qui fut réformé en 1907 : on se prend à imaginer des liens secrets… Un an après l’escroc corse, en juin 1929, c’est un voleur à la petite semaine, Eugène van Lancher (29 ans), que les agents arrêtent à l’hôtel : avec des complices, il subtilisait depuis plusieurs semaines du bois (des lames de paquet et des madriers) dans un chantier de l’avenue Mathurin-Moreau (L’Œuvre).
À cette époque d’installation des premiers Kabyles à la Goutte d’Or, un charpentier en fer algérien mérite une mention à part, ayant deux fois les honneurs des rubriques de faits divers : en mai 1930, au métro Clignancourt, le susceptible Idir ben Guichoud (dans Le Petit Parisien, il devient Idir Guéchoud) donne un coup de pied dans le ventre d’une femme enceinte, Mme Flurot (Fleurot dans Le Petit Parisien), parce qu’elle le « dévisageait trop fixement » (Paris-Soir) ; l’année précédente, en septembre, le même Idir (dont le nom est orthographié Guéchaud dans Le Matin) avait échangé des coups de couteau avec un certain Lambert, rue de la Charbonnière, et fini à Lariboisière. Il avait déjà été inculpé une fois, ce qui le laisse loin derrière Edouard Legendre, onze condamnations, qui poignarderait le charbonnier Marcel Billard quelques années plus tard, en avril 1935, boulevard Barbès (Le Matin). Et dire que c’est avec ce genre d’énergumènes que Dora Bruder aurait pu cohabiter, à la même époque…
Après, c’est la guerre. Le temps sont durs. Jusqu’alors refuge de malfrats, l’hôtel en devient la cible. Juste retournement des choses ! En mars 1941, un dénommé Lahars Benghart s’y introduit à l’aide de fausse clés et dérobe 49.000 francs. Mais le propriétaire a dû en voir d’autres, on ne la lui fait pas : il surprend Benghart et le fait arrêter (L’Œuvre). Un mois plus tôt, le trafic de cocaïne auquel Xavier Cazaoni, alias Jeannot-le-Corse (33 ans), se livrait dans sa chambre avait été démantelé par la brigade mondaine. Ce Tunisien de Sfax était en cheville avec la gérante du bar de l’hôtel, qui allumait et éteignait trois fois la lumière dans sa chambre depuis le tableau de la cuisine si un consommateur se présentait (L’Œuvre). Une fois de plus, le bâtiment lui-même facilite le crime. On ignore si le propriétaire de cet hôtel criminogène fut inquiété…
Après la guerre, les sources sont moins accessibles. Un autre travail d’archives serait nécessaire pour voir comment le 32 a traversé, en particulier, la guerre d’Algérie, quand la rue Polonceau fut le théâtre de nombreux attentats, règlements de comptes et assassinats politiques (deux bouteilles d’essence lancées dans un café musulman du 28 en janvier 1957, la vitrine d’une boulangerie de la même confession brisée par une brique au 36 en février, un mort par balle dans un restaurant du 33 en avril, un autre quand le café du 28 est à nouveau mitraillé par des membres de l’OAS en juin 62 : on voit mal comment le 32 aurait pu passer au travers…). Jusqu’à ce jour d’octobre 2003 où les 44 pensionnaires de l’hôtel (« des célibataires d’origine étrangère, notamment des travailleurs immigrés à la retraite » à en croire Le Parisien) sont évacués après l’affaissement de la façade (une première évacuation avait eu lieu en décembre 1920, après un incendie dans le plafond du premier étage). Un arrêté de démolition est pris depuis plus de dix ans déjà. Il en faudra autant avant la destruction. Ébranlé par tant de passions humaines dont il a été le témoin ou le complice, l’hôtel du 32 a été détruit en 2012. Hasard ou fatalité, en 2013, la grue de forage qui travaillait au chantier s’est renversée. Il n’y eut pas de blessé…
Sébastien Rutés
(No-)go zone
[1] Cette chronique n’est basée que sur des sources de presse, des recherches aux archives de la préfecture de police permettraient de la compléter avantageusement.
[2] À l’époque, c’était le dernier : c’est le propriétaire Campazzi dont parle Modiano qui a fait rajouter deux étages à l’immeuble en avril 1927.



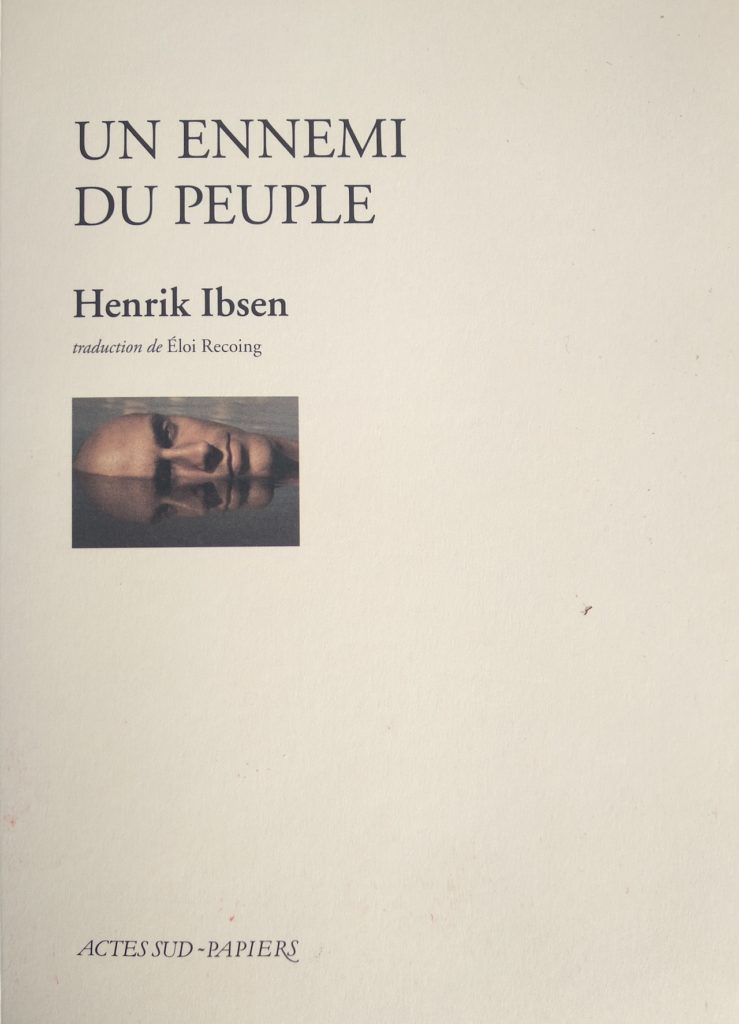






0 commentaires