À 15 ans, en compagnie de mon ami Antonio Garst, nous avons organisé une expédition nocturne pour planter un drapeau cubain dans les jardins de l’ambassade des États-Unis ; malgré notre peur panique, tout s’est bien passé. Ce fut la première action politique de ma vie. Quelques mois plus tard, j’ai participé à une manifestation contre les bombardements américains au Vietnam et les flics mexicains m’ont ouvert l’arcade sourcilière devant le cinéma Roxi, à San Cosme. Ma première blessure, trois centimètres en arc de cercle au-dessus de l’œil gauche.
Quand j’avais 11 ans, mon grand-oncle a discrètement déposé trois livres sur le bureau à côté de mon lit. À l’époque, j’avais déjà lu les œuvres complètes de Salgari, Jules Verne, Karl May, Alexandre Dumas, Michel Zevaco et tout Conan Doyle. Mon oncle pensait qu’il était temps de passer à autre chose. Les trois livres, qui n’étaient pas des lectures imposées et n’appelaient pas de commentaires en retour, étaient par un curieux hasard trois romans écrits par des auteurs américains : Le Vieil homme et la mer de Hemingway, Chroniques martiennes de Bradbury et Spartacus de Howard Fast. Je les ai lus de façon obsessionnelle, je crois même que je suis tombé malade pour continuer à lire sans que l’école perturbe les progrès dans mon éducation. Ils ont signifié pour moi la fin de l’adolescence et la transition vers le monde adulte de la lecture.
La première fois où j’ai dansé (et le mot danser est en l’occurrence une sorte d’insulte à la langue), je l’ai fait (mal) au rythme de Elvis Presley, lors d’une fête de fin d’année àl’école primaire.
En 1969, à l’initiative de René Cabrera, j’ai publié mon premier travail dans les Cahiers de l’École nationale d’anthropologie et d’histoire ; il s’agissait d’une anthologie de poésie noire des États-Unis.
Je veux dire par là que, en termes de rituels initiatiques, les Américains ont occupé pour le meilleur et pour le pire une place énorme dans ma vie.
Comment résoudre alors l’apparente contradiction entre l’empire, la grande force suprême du mal qui influençait nos vies à distance, et ses fruits dorés ?
Une partie de la gauche Néandertal, qui à force de lire les livres de cuisine de la mère de Staline avait pété un boulon, se contentait d’ignorer cette contradiction en décrétant le boycott de tout ce qui venait des États-Unis, en expliquant que le rock était le nouvel opium du peuple, les Levi’s une mode bourgeoise décadente, les hotdogs une insulte aux tacos, et le Coca-Cola le sang des Vietnamiens.
Avec ma génération, ils sont tombés sur un os. On était anti-impérialistes, d’accord, mais on refusait d’être cons.
Et nous, alors, qu’est-ce qu’on a fait ? D’un côté, on a nationalisé tout ce qu’on pouvait : la guitare de Carlos Santana venait de Autlán, dans l’État de Jalisco ; John Dos Passos était un Portugais (bref, un Ibère) passé par Ellis Island ; Anthony Quinn était né dans le Chihuahua ; et si on me cherche, Tony Hillerman était du Nouveau Mexique, dont chacun sait que c’était un territoire mexicain avant la guerre de 1847. Par ailleurs, tout le monde n’était pas logé à la même enseigne idéologique : Hemingway avait figuré sur les listes noires du FBI et Howard Fast, après avoir été mis à l’index, avait fini persécuté, failli mourir de faim, été jeté en prison et vu ses livres retirés des bibliothèques ; Bob Dylan avait pris position contre la guerre du Vietnam et Robert Redford jouait le rôle d’un employé de la CIA naïf traqué par ces mêmes enfoirés de la CIA ; Jane Fonda était de gauche et John Steinbeck avait écrit les meilleures pages qui soient, vu de la gauche, dans À l’est d’Éden, le livre des livres avant que ne paraisse Conversation dans la cathédrale (et avant que Vargas Llosa ne passe à droite).
Pour finir, on a simplement décrété que la contradiction n’existait pas. Qu’il était impossible de cohabiter de façon amicale avec l’empire, mais qu’on pouvait avoir des amis américains tels que Barney le dinosaure, Scott Fitzgerald, les BD de Frank Miller, Jane Fonda, E.T. et Oliver Stone. Au fil des ans, j’ai même élaboré cette théorie : contre les forces les plus sombres de la planète, on pouvait mettre sur pied une alliance de la gauche du tiers-monde avec Hollywood. Contre le fondamentalisme du FIS algérien (assassin de paysans et d’intellectuels, lanceur de vitriol contre les femmes en minijupes), le gant de Rita Hayworth dans Gilda. Contre le curé de Pachuca exorciseur de Pokémons, Jane Fonda dans Barbarella. Contre le cavaliere Berlusconi, la distribution gratuite, pour tout adulte italien en âge de voter, du dvd de Spartacus de Kubrick.
Paco Ignacio Taibo II
Traduit de l’espagnol (Mexique) par René Solis
© délibéré 2016
[print_link]





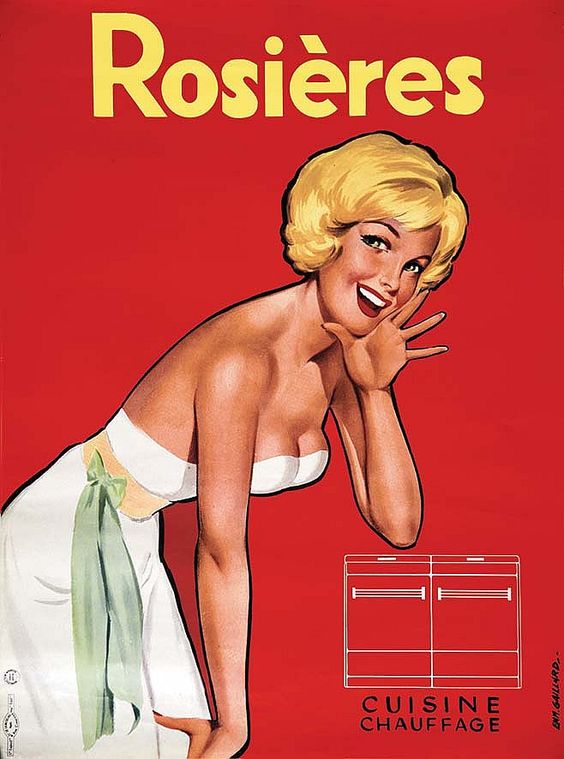

0 commentaires