Benito n’était pas petit et poilu comme l’âne Platero, c’était plutôt la version défectueuse d’un mini flashman : sa vitesse ne l’empêchait pas de se cogner contre toutes les portes, de renverser tous les verres, d’envoyer valser toutes les poubelles, de faire exploser toutes les bouteilles de soda.
Ses exploits, majeurs et mineurs, avaient fini par devenir légendaires : il avait rampé sous la table de la salle à manger pour mettre des glaçons dans les souliers de la femme d’un consul qui s’était déchaussée. Prudemment posté derrière la grille verte qui séparait le garage de l’entrée, à l’âge de cinq ans, il affrontait à coups d’injures les éboueurs, qui se plaignaient amèrement auprès de ma mère :
– Cet enfant est grossier, madame.
– Arrêtez vos conneries, gros pédés, répondait l’enfant.
Il s’était pris de passion pour le baseball, accompagné de l’assistant de mon père, parce que c’était un sport démocratique :
– Et celui-là, Genaro, je peux le traiter de connard ?
– Celui-là non, mais celui qui joue shortstop si tu veux.
L’enfance est un destin, comme disait Santiago Ramírez, et, à l’âge de deux ans, Benito était la préfiguration de ce qu’il serait plus tard. Je lui tendais deux doigts et il s’accrochait à eux, dans son parc, pour sauter au rythme de “Fort, audacieux et courageux”, le refrain de Pancho Pantera dans la pub pour Chocomilk, pendant dix minutes, un quart-d’heure, infatigable, inépuisable, bourreau des grands frères ; et ça repartait dix minutes, un quart d’heure.
À l’âge de cinq ans, il m’a donné l’un des meilleurs conseils que j’aie reçu de ma vie. Nous étions dans une piscine, en train de nous affronter en combats singuliers. Les petits frères étaient les cavaliers et les grands frères, les montures. Ma mission, en tant que cheval, était simple : porter Benito sur mes épaules jusqu’à la zone de combat, le laisser attraper les cheveux d’une cavalière ennemie puis me mettre à galoper pour la faire tomber. Nous avions perdu la première douzaine de batailles quand Benito m’a dit à l’oreille :
– Quand tu t’approches du cheval ennemi, mords-le !
Mais toutes ces images qui aujourd’hui s’accumulent dans mon cerveau – ce placard qui conserve ce qui lui chante et fait de la mémoire un délicieux galimatias – s’effacent devant le souvenir de cet après-midi où il me persuada de l’amener à l’usine Textil Lanera qui était en grève, pour offrir sa bicyclette aux grévistes.
Les grévistes devaient faire face à un patron impitoyable, à des négociateurs pourris, et à des policiers très agressifs au service d’un syndicat bidon. La résistance des ouvriers était comme l’essence de l’héroïsme dans une ville où les héros étaient condamnés à la répression, au licenciement et au bûcher.
Benito n’arrêtait pas de rôder autour de ma chambre où, avec un groupe d’activistes post 68, nous étions en train de mesurer la portée limitée de nos actions de solidarité avec les grévistes. Il devait avoir sept ou huit ans et nous avions beau le mettre à la porte de notre réunion, il ressurgissait sous les prétextes les plus bizarres (une fois, par exemple, pour partager un sachet de petits pains et un pot de beurre de cacahuète avec les militants), ce qui avait le don de nous énerver beaucoup, compte tenu des précédentes incursions de Benito dans nos vies, qui ressemblaient plutôt à celles d’un fils de Staline ; entre autres exploits divers et variés, il avait versé du piment dans le décolleté d’une camarade, transformé en torche un fascicule de Martha Harnecker ou caché les chaussures du loup garou. Au moment où nous partions pour l’usine en grève, il a réapparu à la porte pour me demander d’une petite voix :
– Amène-moi, frangin.
– C’est pas pour les enfants. Si on se fait charger par les flics, maman va me tuer.
– Juste un petit moment, je veux donner mon vélo aux grévistes.
Et il me regardait avec son visage d’ange.
Et j’ai cédé.
Quelques jours plus tard, le piquet de grève a été attaqué par la police. À grand renfort de coups de pied et de coups de matraques, les flics ont tout cassé sur leur passage et arrêté plusieurs camarades.
Nous n’avons jamais su ce qui était arrivé à la bicyclette. Je te parie que c’est cette bande de lâches qui l’a volée.
Paco Ignacio Taibo II
Traduit de l’espagnol (Mexique) par René Solis
© délibéré 2016
[print_link]






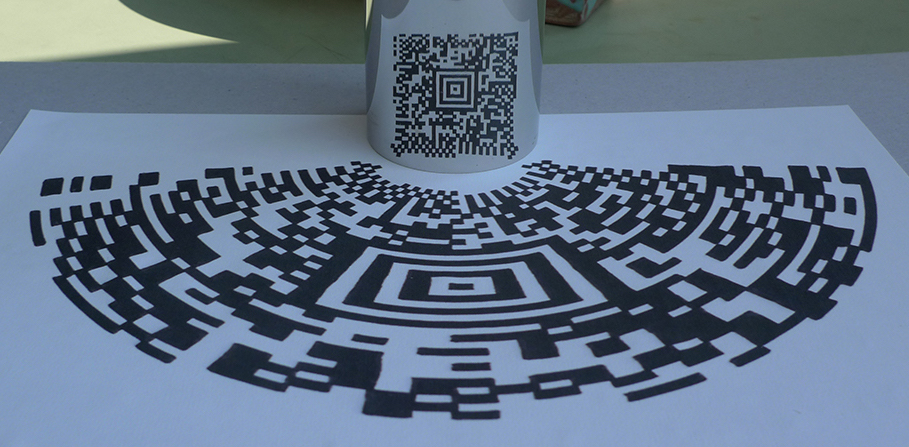


0 commentaires