Quel décor pour Macbeth ? Metteurs en scène et scénographes s’y cassent souvent les dents. Entre la forêt, la tanière des sorcières, le château du crime, le champ de bataille, comment ne pas se disperser ? Et comment représenter spectres, esprits et autres apparitions ? Stéphane Braunschweig qui a pour habitude de dessiner lui-même ses décors, affectionne les défis visuels. Avec des réussites majeures, ainsi cette maison de Tartuffe dont le plancher s’effondrait acte après acte.
De quoi est-il parti pour imaginer un cadre pour Macbeth ? Peut-être tout simplement de Soudain l’été dernier, le spectacle monté il y a un an dans cette même salle de l’Odéon, avec ses murs molletonnés de blanc qui évoquaient l’asile où la jeune Catherine était enfermée. À moins que le chaudron des sorcières ne l’ait mené à l’idée de la cuisine. Cette cuisine du château où, la fin du premier acte, le metteur en scène imagine de faire lire à Lady Macbeth la lettre où son époux lui annonce la prédiction des sorcières –« Salut, Macbeth, toi qui plus tard seras roi ! » – et où commence à se concocter le régicide. Mais les monumentales parois de faïence nue renvoient aussi à la morgue (la pièce jonchée de cadavres), et à la folie (la hantise de la tache). Cet espace presque vide se remplit par moments (le bureau de Macbeth, la table du banquet) mais les accessoires du pouvoir, lustres, dorures ou fauteuils, fonctionnent alors comme des illusions d’optique, des mirages prêts à s’effondrer.
À cet environnement clinique correspond un texte que Braunschweig ne craint pas d’élaguer – plusieurs scènes et personnages passent même à la trappe. Il a cru bon d’autre part – c’est la partie la moins convaincante de son projet – de proposer une nouvelle traduction (qu’il co-signe avec Daniel Loayza), qui a pour principal défaut d’évacuer une bonne partie de la musique et du foisonnement lyrique : les élucubrations des sorcières tiennent du service minimum et la beauté des monologues ne saute pas aux oreilles. Ce qui n’empêche pas d’entendre beaucoup de choses et fort bien. Et d’abord la banalité du mal : vite dépassés par les événements, les époux meurtriers, dans leurs habits modernes (Macbeth passant du treillis militaire au costume-cravate) ne sont pas des génies du crime. Chloé Réjon et Adama Diop qui les interprètent forment un tandem complice contrasté et crédible, elle en nerfs, lui en rondeurs. La terreur de Macbeth face aux apparitions du spectre de Banquo qu’il vient de faire assassiner déclenche les rires, comme si la farce s’invitait au dîner, et c’est très bien ainsi.
Tous les deux pourraient aussi bien être de petits escrocs à l’assurance. Mus par une culpabilité sans remords, doublée d’un amour sincère, ils n’ont pas d’autre issue que la fuite en avant, avec l’illusion que le coup suivant sera le dernier. D’autres ingrédients s’ajoutent à ce cocktail de médiocrité et d’ambition : l’absence d’enfants les mène à une fixation sur ceux des autres. Si l’on peut trouver des raisons politiques à leur volonté de se débarrasser des rejetons de Duncan et de Banquo, qui sont des menaces directes, le massacre des enfants de MacDuff tient d’abord du crime gratuit, ou du stade ultime de la politique : terre brûlée et terreur pour la terreur.
Parcours politique, parcours meurtrier, même combat, Shakespeare est bien, pour reprendre le titre fameux du livre de Jan Kott, « notre contemporain ». Et ce ne sont pas les sorcières, avec leur venin de crapaud, leurs pattes de lézard et leurs ailes de hibou qui font peur, mais les humains en lutte pour le pouvoir. La scène la plus éclairante de la pièce – on l’entend très bien aussi – étant à cet égard celle où Malcom (Roman Jean-Élie), le fils de Duncan, sommé par Macduff (Jean-Philippe Vidal) de prendre la tête du combat contre le tyran, met en garde son interlocuteur et dresse la liste de ses propres turpitudes : tu crois avoir tout vu en matière d’horreur, lui dit-il en substance, mais tu te trompes, une fois roi, je serai pire que lui. Pas si grave, lui répond d’abord Macduff. Et Shakespeare a beau renverser la scène d’une pirouette – Mais non, je plaisantais, finit par lâcher Malcom –, le doute est semé et le malaise formidable.
René Solis
Théâtre
Macbeth de Shakespeare, mise en scène de Stéphane Braunschweig, Odéon-Théâtre de l’Europe, 75006, jusqu’au 10 mars. Rencontre avec le public à l’issue de la représentation le jeudi 8 février. Spectacle donné du 16 au 18 mai à la Comédie de Reims.



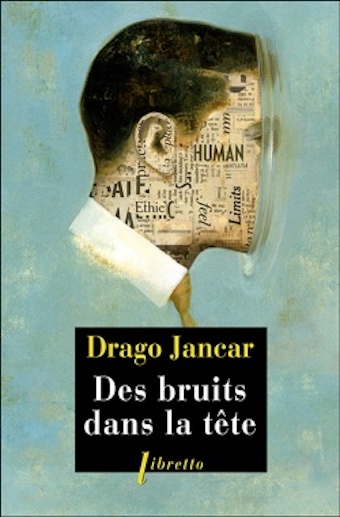






0 commentaires