Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
Jeudi dernier, le 26 avril, le ministre américain de la défense Jim Matiss déclarait devant le Congrès : « les Français nous ont renforcés en Syrie avec des forces spéciales au cours des deux dernières semaines ». Peu de temps auparavant pourtant le président de la République française avait lui-même affirmé lors de sa visite en Inde : « Il faut être clair : la France n’interviendra pas militairement sur le sol en Syrie ». Qui croire ?
Peu importe sans doute puisque comme le dit Pascal, quoique dans un contexte fort différent : nous sommes « embarqués » (Les Pensées, fragment 418). La France est en effet intervenue militairement à plusieurs reprises en Syrie. Le 14 avril, à côté des Américains et des Anglais, notre armée bombardait un site où devaient se trouver des armes chimiques censées avoir été utilisées par le régime syrien contre la population civile.
Mais alors sommes-nous en guerre avec la Syrie ? Notre gouvernement a-t-il officiellement fait une déclaration de guerre ?
La réponse de la France à ses questions est simple autant que lapidaire : nous ne sommes pas en guerre et l’État n’a pas, semble-t-il, l’intention de déclarer la guerre à la Syrie.
En ce sens Jean-Luc Mélenchon avait tort de reprocher à Emmanuel Macron d’avoir lancé une opération militaire sans consulter le Parlement. L’article 35 de la Constitution n’oblige en effet l’exécutif à solliciter l’avis du Parlement que lorsque les opérations militaires se prolongent au-delà de quatre mois. Et puis, encore une fois, nous ne sommes pas en guerre.
Est-ce pourtant si simple ? En droit, un gouvernement doit avoir l’aval de son Parlement pour déclarer une guerre, quelle que soit la durée qu’aura celle-ci. Personne n’est jamais en effet en mesure de connaître la fin d’un conflit. Seul le début est certain. On voit déjà sur ce premier point l’intérêt qu’a un gouvernement à refuser de déclarer officiellement la guerre. Il peut passer outre l’avis de son Parlement pour engager des hostilités. Une « intervention militaire », « une frappe ciblée », « une opération de protection des populations civiles » (selon les mots de François Fillon à l’époque de l’intervention française en Libye) : ce sont autant d’expressions, d’euphémismes au fond employés par les gouvernements d’ici et d’ailleurs pour requalifier ce qu’on appelait autrefois la guerre.
Mais pourquoi aucun État ne déclare-t-il plus officiellement la guerre ? La question peut surprendre à une époque où les conflits armés se multiplient aux quatre coins de la planète.
La première raison se trouve dans le pacte Briand-Kellogg de 1928 (article 1) qui condamne toute forme de guerre à l’exception des guerres de légitime défense et de celles qui prennent la forme d’une action collective armée prévue à l’article 16. En 1945 la Charte des Nations Unies reprend et renforce les termes de cet article 1 puisque la Charte ne condamne plus seulement la guerre mais tout « usage de la force », sauf, à nouveau, dans les cas d’une action collective approuvée par les Nations Unies ou bien sûr dans le cas de la légitime défense.
La guerre est ainsi rendue illégale : elle est par principe contraire au droit. Cette évidence pour beaucoup d’entre nous ne l’a pourtant pas toujours été. Il faut rappeler que la guerre, avant le pacte Briand-Kellog, était encore considérée comme une façon parmi d’autres de régler des conflits entre États. Elle n’était que « la continuation de la politique par d’autres moyens » (Clausewitz).
En apparence tout change avec la Société des Nations puis avec la Charte des Nations Unies. La guerre est désormais proscrite en droit, sinon en fait. Et c’est bien là le problème. Car enfin qu’appelle-t-on une guerre ? Elle oppose traditionnellement, selon Hobbes et Rousseau, deux États : « Chaque État ne peut avoir pour ennemi que d’autres États » (Le Contrat Social, Livre I, chapitre IV). La guerre s’exprime par l’usage de la force et engage la responsabilité de l’État qui la déclare. Elle peut être juste ou injuste selon la cause qu’elle sert. Enfin elle marque la rupture de l’état de paix et l’entrée dans l’état de guerre.
Le point délicat de cette définition de la guerre est, on s’en doute, la question de sa légitimité. Quand peut-on parler d’une guerre juste ?
Le cas de la légitime défense n’est évident qu’en apparence. En effet lorsqu’un État envahit le territoire d’un autre État, celui-ci semble justifié à se défendre. Il est la victime d’une agression injuste. Pourtant lorsqu’on examine le tracé des frontières de cet État, on peut parfois noter qu’elles sont elles-mêmes le résultat d’une guerre antérieure. Les frontières de tous les pays sont en effet ou arbitraires ou l’expression de la force. La partition de l’Empire ottoman après la première guerre mondiale fournit un bon exemple du caractère fragile des frontières des États modernes. On ne peut comprendre les revendications des Kurdes sans se rapporter à l’action des Français et des Anglais dans cette partie du Moyen-Orient (voir le fameux accord Sykes-Picot). Les frontières peuvent toutes en ce sens être contestées un jour ou l’autre. Il n’existe ni frontières naturelles (les États sont des conventions), ni frontières rationnelles. Le droit à la légitime défense dans le cas des États est ainsi beaucoup plus problématique qu’il ne le semble à première vue. C’est au demeurant l’argument qu’avait invoqué Saddam Hussein lorsqu’il avait envahi le Koweit.
Le second cas de guerre juste est énoncé par Cicéron dans son De Republica (livre III, § 35, cité par Andrea Hamann dans son excellent article : « Le statut juridique de la guerre » in Jus politicum, n°15) : « Nulle guerre n’est réputée juste si elle n’est pas annoncée, si elle n’est pas déclarée, et si elle n’est pas précédée d’une réclamation des choses dues. » (je souligne)
Mais qui décide quelles sont « les choses dues » sinon l’agresseur lui-même ? Les motifs de la guerre apparaissent toujours subjectifs. Ou du moins ils étaient telles jusqu’à ce que les Nations Unies tentent, tant bien que mal, d’objectiver les motifs de la guerre en soumettant ceux-ci à l’approbation des nations. Si celles-ci tombent d’accord, les motifs d’engager une guerre deviennent rationnels ou objectifs : justes. Comme en démocratie, la voix de la majorité est présentée comme une expression de la raison.
J’en reviens maintenant à ma question initiale : sommes-nous en guerre avec la Syrie ? La réponse est maintenant toute différente puisqu’à l’évidence nos interventions militaires, frappes chirurgicales et autres formes d’actions violentes entrent toutes dans le cadre de ce qui a été défini comme une guerre. Cette guerre est-elle juste au sens moderne que nous donnons à cette idée ? Non, puisque les frappes aériennes du 14 avril ont été décidées sans consulter ni les parlements nationaux ni les Nations Unis : elles ne peuvent donc répondre qu’à des motifs subjectifs qui sont en soi contestables. Mais enfin pourquoi nos États, car la France est loin d’être seule dans ce cas, font-ils la guerre sans la nommer ? Il y a, semble-t-il, au moins trois raisons à cela. J’ai déjà indiqué plus haut la première d’entre elles. Ne pas nommer la guerre permet à l’exécutif d’exercer son pouvoir sans limite. Le Parlement n’a pas à être consulté. La deuxième raison est que la guerre est désormais illégale. Comment déclarer une décision que le concert des nations ne pourra que condamner ? Enfin ne pas nommer la guerre permet de ne pas en porter la responsabilité. Une déclaration de guerre présuppose en effet une intention et donc une volonté. Et tout acte volontaire doit en principe savoir assumer ses conséquences. En refusant de nommer la guerre, c’est bien notre responsabilité dans le conflit syrien que nous dégageons, faisant comme si nous n’y étions pour rien, refusant encore d’accepter que nous vivons désormais dans un état de guerre permanent.
Dans son Projet de paix perpétuelle, Kant rappelle qu’il faut distinguer la paix d’un simple cessez-le-feu pour constater aussitôt que la paix, c’est-à-dire la paix perpétuelle, n’a encore jamais existé. Le monde dans lequel nous vivons, malgré les efforts successifs de la Société des Nations et des Nations Unies, ne fait hélas que confirmer la remarque de Kant. La paix, aujourd’hui plus que jamais, est de l’ordre de l’idéal. Mais alors il serait peut-être temps que nous acceptions de reconnaître et de nommer la réalité des choses.
Gilles Pétel
La branloire pérenne


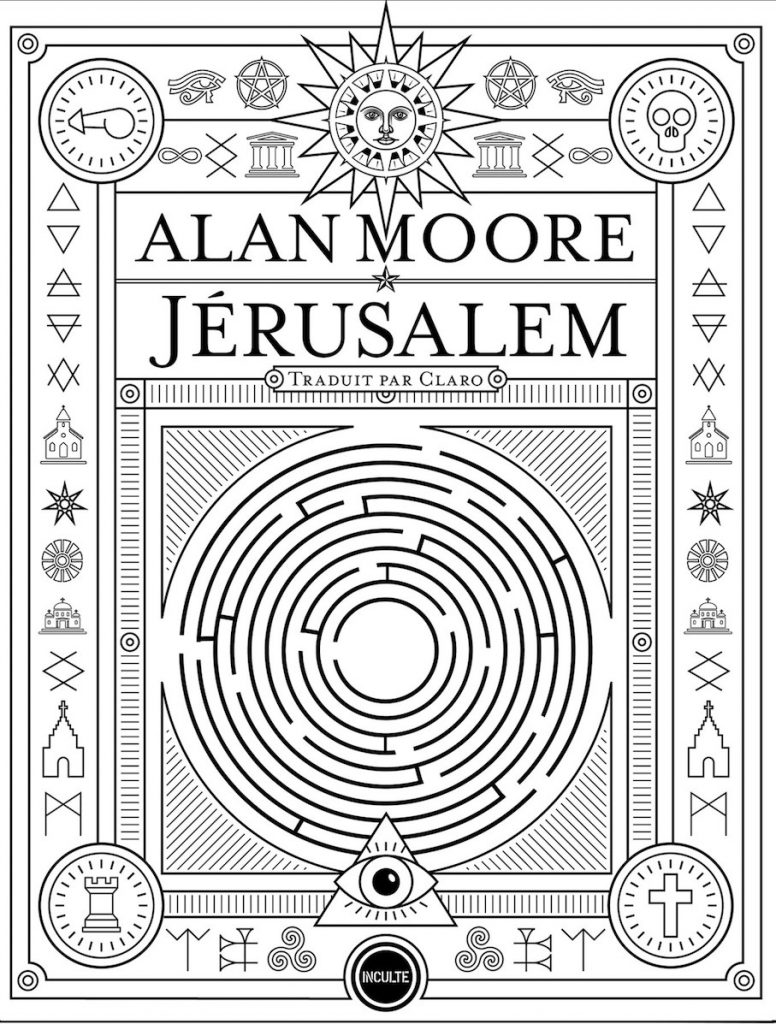






0 commentaires