Vidéo réalisée à partir de la manipulation de 4 photographies numériques capturant l’effet d’une chambre noire.
ISO : 800
Ouverture : f/5
Temps d’exposition : 300 battements de cœur
Date : 22-30 mai 2020
Éteindre la lumière pour mieux regarder
Notes sur une expérience de chambre noire
Cette vidéo est le fruit d’une frustration et d’une surprise : frustration face à des contraintes techniques, surprise de voir une photographie en mouvement.
L’objectif est la partie la plus simple : une capsule de bouteille de bière et un clou pour la percer avant de la coller avec un morceau de carton à la fenêtre. Ensuite, la première étape consiste à boucher complètement toutes les sources de lumière possibles dans la chambre. Le mieux est de couvrir les vitres avec du papier d’aluminium, de couper le courant dans la pièce pour visualiser tous les endroits par lesquels le soleil continue à entrer, en petites franges qui s’infiltrent par les cadres des fenêtres, par-dessous la porte, etc. Aller chercher du ruban adhésif pour en coller sur tous ces interstices, et voir apparaître les petits points de lumière qui entrent à présent là où le papier alu est abîmé, petit ciel étoilé dont il faut démanteler les constellations pour revenir à l’origine, le noir total.
Rien que le noir
Une fois éliminées toutes les fuites de lumière et l’objectif placé à l’endroit désiré, éteindre une fois pour toutes la lumière électrique. Il n’y a rien, ni projection, ni images de l’extérieur, rien que le noir et un minuscule filet de lumière qui entre par la capsule de bière comme si de l’autre côté de la fenêtre il n’y avait pour seul monde qu’une obscure bouteille qui, perforée, se vide de ses dernières gouttes contre le mur.
Mais au début il n’y a rien, les yeux doivent s’adapter à l’obscurité, le sang doit affluer pour que les pupilles se dilatent au maximum. C’est alors que cela commence à apparaître, lentement, comme lorsque l’on met le papier photo dans le bac de révélateur et que peu à peu la vie nous montre l’image désirée, tandis que nous tenons le papier aves des pinces et que nous agitons délicatement le bac jusqu’au moment précis où le temps reste fixé, capturé, pétrifié. Sauf que là, tout se passe sur le mur et ce sont mes pupilles qui contrôlent l’alchimie et, logiquement mais d’une certaine manière contrairement à mes attentes, l’image n’est pas fixe.
Intimité
C’est le premier moment de reconnaissance, même si je préfère dire d’intimité : je comprends soudain des choses que je savais déjà intellectuellement mais qu’à présent j’éprouve, réaction étonnamment romantique face à un processus que je pensais devoir être principalement mécanique. Je suis à l’intérieur d’une chambre, et cette évidence si souvent expliquée dans les livres de photographie se transforme à présent en fait réel et tangible. Je suis à l’intérieur d’une chambre, je suis dans ma chambre à coucher et c’est mon nouvel appareil photo. Le monde extérieur, celui des façades parisiennes, commence à se matérialiser dans ma chambre et l’image n’est pas statique : je peux voir des oiseaux voler sur mes draps pendant que sur mon mur le volet d’un voisin se ferme (pour accueillir peut-être une autre obscurité).
C’est étrange : au lieu de me dire que je suis en train de travailler avec un appareil photo énorme, je me vois, presque à la troisième personne, comme un homme en miniature en train de bouger à l’intérieur d’un appareil photo de taille normale. Je pense alors à la vie intérieure de mes autres appareils, au constant flux vital qui pénètre dans ces petites chambres avec de petits hommes et de petits rêves, flux que de façon insensée j’interromps avec le désir égoïste d’emprisonner une tranche de vie, de garder en cage un instant solide à l’intérieur d’une réalité/temps que je devine à présent liquide.
En guise de trépied, les livres
Second moment d’intimité : en guise de trépied, les livres. Je pose un tabouret sur une chaise et commence alors une amusante tentative d’équilibre pour atteindre la hauteur qui permettra le cadrage parfait. Je prends les livres les plus gros et les plus résistants de la bibliothèque et je vois avec plaisir que ce sont en majorité des livres de photo ou d’art. Mais voici que le fétichisme pointe le bout de son nez pour me souffler que oui, 500 photographies, et oui, Koudelka, mais qu’il n’est pas très juste de convier deux livres de cuisine à notre petite cérémonie sans avoir invité Cortazar et ses Fils de la vierge. J’essaie d’argumenter : « Écoute, Féti, le poids, la taille, nous sommes dans le noir, on risque de trébucher. La stabilité… » Mais le fétichisme me regarde, l’air de dire que tout peut s’arranger, et il est clair qu’il a raison : à quoi bon mettre Cuisine japonaise et pas l’anthologie de Herberto Helder. Et sans m’en rendre compte, je me retrouve à construire une tour instable de belles phrases qui me font pleurer et rêver, merde à la fin, on est en train de créer quelque chose de beau ici, on ne se contente pas d’appuyer sur des boutons.
Je sors du placard un vieil appareil numérique qui me permettra de tester les paramètres d’exposition. Première restriction technique : le réglage automatique autorise des temps d’exposition d’une durée maximale de 15 secondes. Les premières expériences fonctionnent bien à condition que je reste, vêtu de blanc, près de la tour-trépied. Ce qui devient vite problématique car je n’arrive pas à capter le fond de la pièce où se projette la façade entière de l’immeuble d’en face. L’appareil ne peut pas encore voir ce que je vois, il lui manque encore du sang pour dilater ses pupilles. Il faudra changer d’angle et le placer dans le coin de la pièce, de façon à ce que je puisse tenir manuellement l’obturateur sans apparaître sur la photo. Le trépied ne remplit plus son rôle mais je suis content de savoir qu’il est toujours là, juste à la limite du cadre, comme un spectateur ou un coéquipier qui observe depuis le banc.
Le cœur comme chronomètre
15 secondes ont suffi pour prendre des photos sur une surface blanche proche de l’objectif. À présent, il est nécessaire de trouver le bon temps d’exposition pour capter les images reflétées sur le mur, mais mesurer le temps dans le noir n’est pas facile. Troisième moment d’intimité : le cœur comme chronomètre. Entrer dans cette pièce pour y observer l’obscurité tend à se transformer en exercice de méditation, mon corps miniature se détend, ma respiration est beaucoup plus calme et il m’est facile de me concentrer sur chaque battement du cœur. Je respire profondément, je pose la main gauche sur le cœur, la main droite sur l’obturateur, j’appuie et je compte jusqu’à 50. Je cherche l’image dans l’appareil : trop sombre, il va falloir essayer des temps d’exposition plus longs. Yeux, chronomètre, obturateur, 100 battements : trop sombre. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que je trouve le temps exact, 300 battements.
Durant la journée, après manger, je prends plaisir à retourner dans la chambre noire et à rester assis en silence jusqu’à l’heure de retourner au travail. Pendant que je travaille aussi, parfois, j’aime revenir passer un moment sans prendre de photo, juste le temps nécessaire pour que les yeux s’habituent et me persuader que c’est bien vrai, qu’elle existe, que j’ai construit un appareil photo dans lequel je peux entrer par la porte. Un instant de complète intimité : la nuit je dors dans l’obscurité complète avec la tranquille émotion de savoir que le matin le monde extérieur remplira la pièce et que ce sera le changement de la couleur du ciel sur mes draps qui me réveillera.
Dix jours de travail passent ainsi, mon ordinateur installé dans la cuisine, des visioconférences sur Zoom avec en fond une bibliothèque dont ont été discrètement retirés les livres qui me font vibrer. Et entre deux occupations, réunions, coups de fil, ou bien à l’heure du déjeuner, je retourne aussi souvent que possible dans ma chambre pour recommencer la cérémonie : respirer profondément, laisser le sang affluer dans mes pupilles, voir l’image qui surgit sur les surfaces de la pièce, la main gauche sur le cœur pour chercher le chronomètre, la main droite sur l’obturateur, silence, 300 battements.
La chambre, bien sûr, n’est pas mobile ; par conséquent, il n’y a qu’une seule image à capturer. Mais cette image n’est pas fixe, et je tente donc de la capturer à tous les moments possibles pour tisser ensuite les instants et la sortir de sa prison temporelle. Je tente de la capturer avec la lumière du matin quand le ciel est plus bleu, à 11 heures, qui est le moment où le soleil se pose avec le plus d’intensité sur la façade d’en face, et à différents moments de la journée pour suivre le mouvement des ombres jusqu’à ce que la façade disparaisse et qu’il soit seulement possible de voir la couleur du ciel changer sur les draps et la lumière qui s’éteint quelle que soit la durée de l’exposition, 300 battements, 500 battements, 800 battements, noir.
Pedro Escobar
Texte traduit de l’espagnol par René Solis











Pedro Escobar est un photographe amateur mexicain, passionné de littérature, ayant fait des études au Mexique, aux États-Unis et un peu en France. Un peu seulement, parce qu’il a abandonné deux doctorats au profit de ses passions plutôt chronophages : enregistrer les oiseaux, faire du podcast, écrire ou simplement passer de longues minutes à regarder les murs.
Lire le texte en V.O. (espagnol)

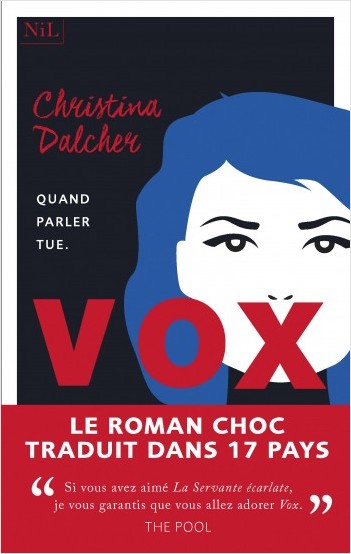







0 commentaires