Depuis plus de quinze ans, l’association Les Filles du loir fait vivre la littérature contemporaine en organisant des rencontres avec des auteurs et des autrices. Animées par quatre « filles » que réunit la passion de la littérature, Anne Delaplace, Marine Jubin, Delphine Lizot et Stéphanie Perrin, les rencontres ouvertes à tous et à toutes se font autour d’un livre dont un exemplaire a préalablement été offert aux adhérentEs. C’est dans un nouveau lieu que Les Filles du loir ont repris leurs activités après deux années d’involontaire suspension : la librairie-café Tram, à Paris. Marion Wolff, responsable de la librairie qui s’est récemment ouverte tout près du Panthéon, accueille volontiers les rencontres des Filles du loir dont elle partage l’envie de rassembler autour d’une « littérature vivante », pas toujours en lien direct avec l’actualité éditoriale. Choisir des titres dans le flux continu des publications, soutenir des parutions dont on parle moins dans la presse, travailler sur le long terme sont les intentions d’une libraire très attentive à la qualité des livres et qui rejoignent la philosophie des Filles du loir. Philosophie à laquelle souscrit également délibéré qui souhaite relayer la démarche des Filles du loir en accompagnant leurs choix. Cinq rencontres ont lieu dans l’année, pendant lesquelles les participantEs échangent avec l’autrice ou l’auteur invitéE puis se retrouvent pour un moment de convivialité.
Le 21 avril, les Filles du loir recevront Emmanuelle Bayamack-Tam pour Arcadie, éditions P.O.L (2018), et Folio (2020). Un roman foisonnant et déroutant, tissé de références littéraires, qui questionne la résistance aux travers contemporains par la recherche du bonheur hors du monde. Mais chacun sait qu’en Arcadie, pays mythique de la liberté pastorale, le roi fait servir de la chair humaine. La mort est aussi en Arcadie parmi l’amour qu’on y dispense à profusion.
La réussite de ce roman étonnant d’Emmanuelle Bayamack-Tam repose notamment sur l’invention d’une narratrice dont la personnalité et la voix font tenir ensemble ce panorama hétérogène du bonheur puisé dans le retour à la nature. Farah, de quatorze ans à vingt ans, raconte son apprentissage de la vie, de l’amour, sa découverte compliquée des corps et du sexe au domaine de Liberty House où règne Arcady, « le bon berger », parmi tout un aréopage d’inadaptéEs à la société dominante. Invalides, vieillardes, hypersensibles, mal-foutus, éclopéEs vaquant librement dans un paysage luxuriant constituent un tableau à la Jérôme Bosch. Il faut s’approcher, aller y voir de plus près pour déceler l’ombre du mal gîtant au sein de cette société idéale, ultime refuge contre une modernité qui fait courir le monde à sa perte : rien n’y est obligé sinon le végétarisme, rien n’y est interdit sinon les nouvelles technologies, la communauté pratique l’amour libre, les sociétaires débattent démocratiquement et nul n’impose quoi que ce soit à personne. La langue inventive, ironique, de Farah campe des portraits drôles et cruels des habitantEs de Liberty House, de sa mère, beauté neurasthénique allergique aux ondes, de son père intellectuellement diminué et passionné de fleurs, de Kirsten sa grand-mère lesbienne et naturiste :
Pour ma part, je suis habituée à voir Kirsten déambuler dans le plus simple appareil. Un de mes premiers souvenirs, c’est de m’être trouvée nez à nez avec sa vulve alors que je sortais de ma chambre. Mon regard arrivait à peu près à la hauteur du piercing industriel qui transperçait l’une de ses grandes lèvres, une sorte de rivet doré du plus bel effet, et je n’ai pas pu m’empêcher d’y porter la main pour m’en emparer fermement, suscitant des hurlements compréhensibles.
L’ironie de Farah est sans concession pour relever ce que cette société hédoniste comporte de cynisme. Les généreuses donatrices y sont les très bienvenues pour assurer la subsistance de ce petit monde de gueules en biais et bras cassés :
L’idéal, ce serait de rallier à notre cause des veufs richissimes ou des héritiers disgraciés qui trouveraient auprès de nous l’emploi utile de leur grande fortune. […] En tous cas, j’ai reçu ma feuille de route comme les autres : si je croise un riche, j’ai comme consigne de le séduire et de l’emmener à Liberty House où Arcady se chargera d’enfoncer le clou.
Mais le deal n’est pas défavorable aux spoliées volontaires qui trouvent à Liberty House le lieu où être acceptées avec ses vices et ses qualités mais sans fausse bienveillance, comme la vieille Dadah, qu’on imagine mal dans un ehpad:
toujours partante pour le plaisir : un repas fin, une fête, une visite, une promenade. Sans compter qu’à quatre-vingt-seize ans, elle ne désespérait pas de trouver l’amour ou, à défaut, une bonne séance de baise dans l’éventualité de laquelle elle se tenait prête (…).
Arcadie est le roman des tous les brouillages, les catégories habituelles sont malmenées, les frontières mises à mal entre le beau et le laid, le moral et l’amoral, l’enfance et les âges adultes, les repères ordinaires de l’existence sont questionnés par ce mode de vie communautaire, en marge. La lecture s’en trouve donc bousculante jusqu’à la fin. On est proche de condamner ce que l’on perçoit comme une secte, mais on entend cette réflexion de Farah qui se souvient de son enfance à Liberty House :
Heureuse de grandir dans une communauté d’adultes aimants ; heureuse d’habiter un palazzo un peu vétuste mais tellement plus romanesque que les pavillons ou les apparts des autres ; heureuse de régner sans partage sur mes hectares de pinède, ma châtaigneraie, mes prés, mes sentiers ombragés, mon peuple de poules, de chats et de geais bleus – sans compter les mares pullulant de tritons, les terriers de renardeaux, les cabanes à la fourche des arbres, les clarines résonnant d’une vallée à l’autre, me donnant tantôt la paix, tantôt l’exaltation- soit très exactement ce qu’il faut à une âme d’enfant.
Brouillage, encore, de l’identité sexuelle de Farah dont la gynécologue donne brutalement une explication à ce qu’elle ressent d’étrange depuis longtemps, en formulant le diagnostic du syndrome de Rokitansky. Née sans utérus et pourvue d’un vagin raccourci, Farah se sent fille mais son corps se masculinise :
Je mesure un mètre soixante-dix-huit, je suis carrée, musclée, et, depuis peu, moustachue : ça fait beaucoup pour prétendre être une fille. Mais justement, je me disais que la féminité était à portée de main. Qu’il suffirait que je me laisse pousser les cheveux, que je m’épile le duvet, que je me résigne au gloss, au mascara, aux couleurs vives ou aux couleurs claires, pour enfin rejoindre le gang des go. Non que ledit gang m’intéresse plus que ça, mais il m’est toujours apparu comme mon inévitable destination après une enfance délicieusement indéterminée, une enfance nuageuse, florale, élémentaire.
À Liberty House, Farah construit son univers de questionnements, de curiosités et de découvertes autour du personnage charismatique mais ambigu d’Arcady. Là encore, le trouble est produit par un décalage entre la perception subjective du gourou par la jeune Farah et la description peu flatteuse qu’elle en donne. Si Arcady la persuade qu’elle porte en elle sa propre beauté irrésistible, s’il agit en s’assurant de son consentement plusieurs fois répété, les relations sexuelles entre ces deux personnages dont l’un, l’homme, a l’âge et l’ascendant d’un père sur l’autre, l’ado de quinze ans en manque d’amour, dérangent par leur crudité et leur semblance d’inceste :
Nous roulons dans l’herbe et tout recommence, la mêlée confuse de nos chairs ardentes, les souffles, les ahanements, les ajustements, ses mains qui m’empoignent, me hissent, me retournent, sa voix qui me dirige et mon bonheur à obéir.
Le miroir, cet objet qu’Arcady voulait bannir pour faire de « Liberty House une zone mirror free », se fêle à l’épreuve de l’inattendu venu de l’extérieur, de l’irruption de l’Autre dans ce monde forclos. Les reflets équivoques du bonheur se ternissent quand la réalité étouffe l’illusion : Liberty House n’est pas une île. Fin du mythe ? Mais les mythes sont faits pour être redits, variables et pourtant inchangés à travers le temps : l’âge d’or est toujours passé mais toujours à venir.
♦
Jeudi 21 avril à 19h30 Les Filles du loir rencontrent Emmanuelle Bayamack-Tam à la librairie-café Tram, 47 rue de la Montagne Saint-Geneviève, Paris 5e. Entrée libre.


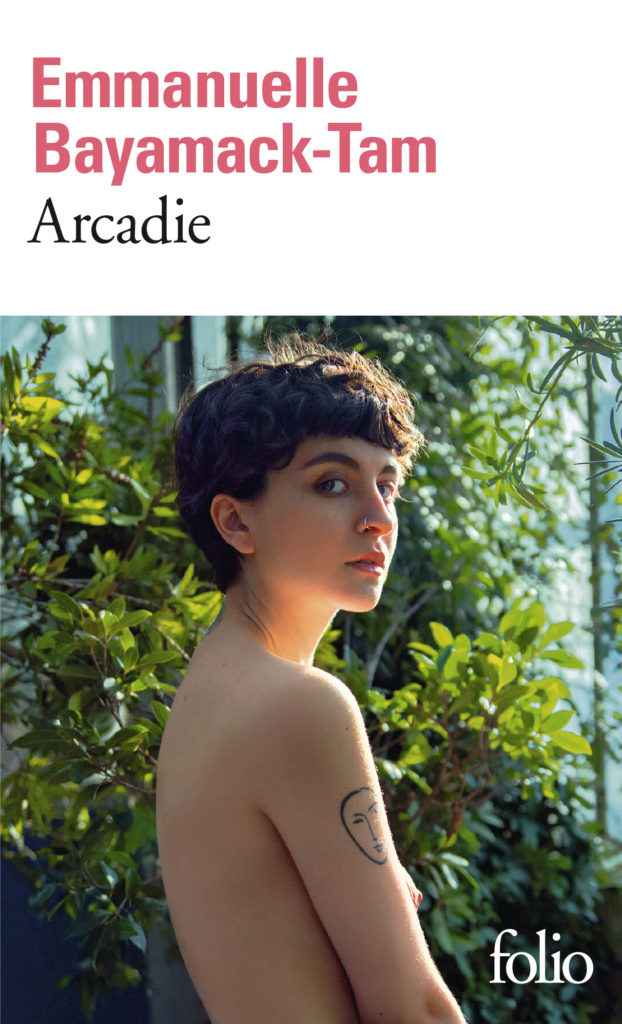

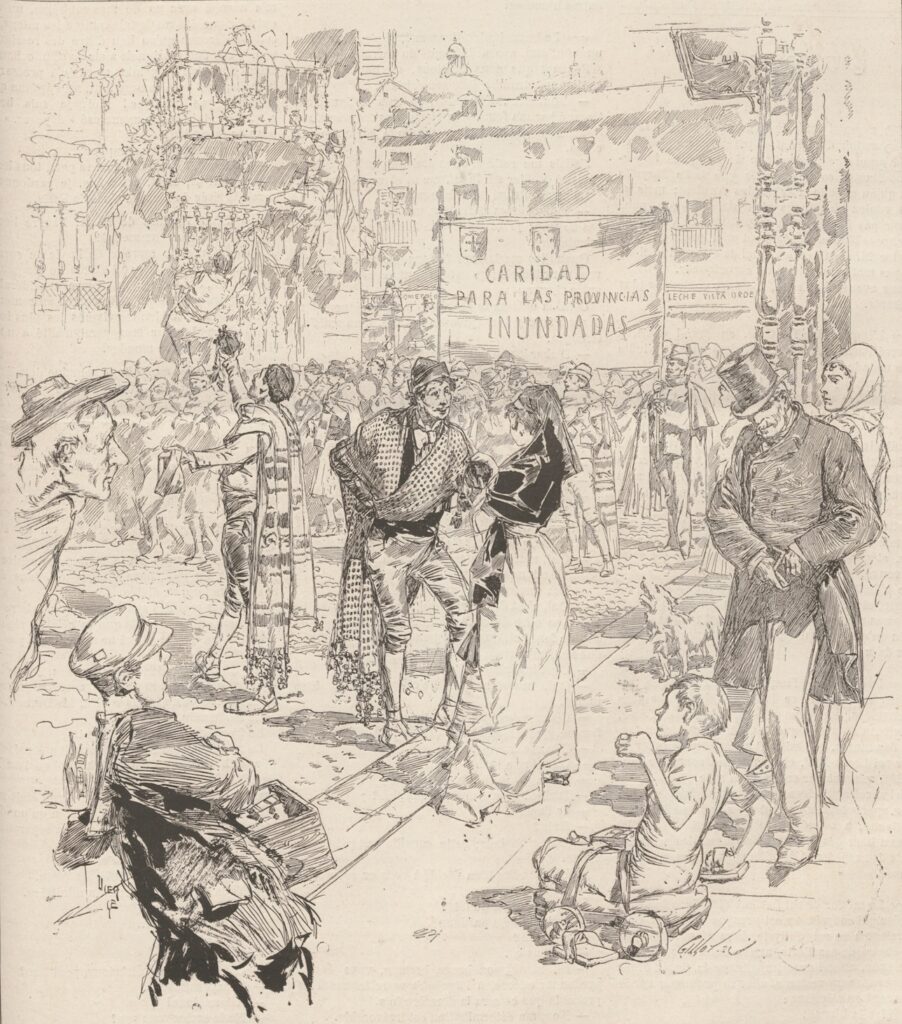






0 commentaires