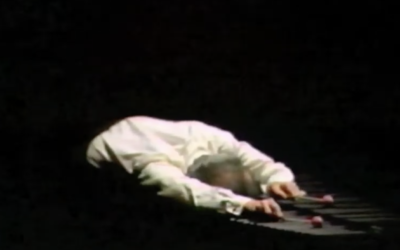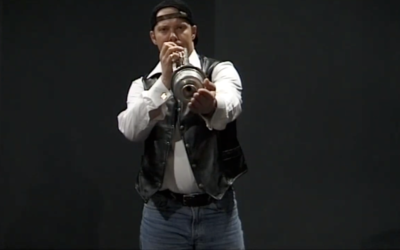Brève n°7 pour marimba, interprétée par Gaston Sylvestre. Captée à l’Opéra-Bastille en 1991.
par Jacques Rebotier
Ce sont de petits solos (maintenant aussi duos, trios, quatuors) pour différents instruments. Les musiciens sont en situation d’acteurs, jouant des partitions qui sont aussi des partitions de parole. Du tuba au violon, du glockenspiel à la trompette marine, de la boîte à meuh aux costumes à puces électroniques, depuis 1987 ils alimentent – toutes proportions gardées! – mon petit “clavier bien tempéré” des rapports texte-musique.
Les Brèves sont souvent assemblées, au plaisir des musiciens ou des ensembles, pour composer des spectacles (Zoo-muzique), concerts ou fil rouge de concerts, interventions publiques, expositions, rues et jardins.
Alexandrine
Brève n°6 pour vibraphone, interprétée par Gaston Sylvestre. Captée à l’Opéra-Bastille en 1991.
Hé !
Brève n°5 pour xylophone, interprétée par Gaston Sylvestre. Captée à l’Opéra-Bastille en 1991.
Je veux les deux
Brève n°23 pour chalemie et bombarde, interprétée par Marc Duvernois
Le dépassement
Brève n°69 pour violon, ou tout instrument à corde, pourvu qu’on aie un archet: tirer, aussi loin que possible, et même plus! Un peu comme dans un dessin animé de Tex Avery, on reste un moment au-dessus du vide…
Le boire
Brève n°59 pour basson, interprétée par Marc Duvernois
Violetta
Brève n°114 pour violoncelle et accordéon: une petite pièce pour violoncelliste-parlant sur un des poèmes de Ernst Herbeck, jouée par Adeline Lecce
Le sable de l’oubli
Brève n°112 pour trio à cordes, interprétée par Amaryllis Billet, Hélène Desaint, Sarah Givelet. Une des pièces écrites pour la lecture-concert du 9 décembre 2012 aux Bouffes du nord du texte de Jacques Roubaud, l’Ode à la ligne 29 des Autobus parisiens.
Pressés ?
Brève n°107 pour quatuor à cordes, interprétée par Rachel Givelet, Amaryllis Billet, Hélène Desaint et Sarah Givelet (Quatuor A4&+)
Surviennent les souvenirs
Brève n°38 pour waterphone, interprétée par Virginie Michaud (1998) et composée par Jacques Rebotier.
Reviens !
Brève n°19 pour cor des alpes. Les cornistes joueront avec une petite embouchure, qui leur permettra d’atteindre le suraigu; les trombonistes, les tubistes, avec une embouchure plus grande, qui les consolera avec des sons pédales gravissimes, et une voix qui sortira mieux dans l’instrument.
Et regrette
Brève n°35 pour alto solo. Interprétée par Robin Kirklar, cette brève pour alto travaille l’unisson voix-instrument.
Or ça!
Brève n°113 pour voix et scratch. Un texte de Rabelais sur l’injustice sociale. Les petits sont pris dans la toile des lois, les taons, frelons et autres puissants passent à travers.
Tu viens?
Une des premières Brèves pour musiciens parlants: elle est fondée sur des équivalences phoniques langage/instrument, avec une phrase qui se construit par accumulation à partir du « tu » articulatoire de la trompette, jusqu’à faire éclater le sens, et le son de l’instrument.
Nuit 5
Brève n°11 pour glockenspiel, captée à l’Opéra-Bastille en 1991, avec Gaston Sylvestre.
Qu’est-ce que tu dis?
Brève n°105 pour 2 violons par Amaryllis Billet et Rachel Givelet
Pouah
Brève n° 21 pour trombone contrebasse Pouah, par Maxime Morel, sur une partition de Jacques Rebotier
Yo
Brève nº53 pour concertina diatonique interprétée par Mélanie Brégand
Et ainsi de suite
Brève nº30 pour violoncelle à deux archets, interprétée par Sarah Givelet © Jacques Rebotier
Ton morceau
Brève 91bis pour violoncelle interprétée par Sarah Givelet. Texte et musique © Jacques Rebotier. Enregistrement au Centre Wallonie-Bruxelles, le 14 mai 2012
Brèves galantes
12 phonèmes, 12 syllabes, 12 pieds. Les 3 Brèves se jouent à la suite. Elles ont été créées par Gaston Sylvestre à l’Opéra-Bastille le 8 février 1991.
Vous habitez chez vos parents?
Une brève collector: la n°8 pour étui, créée par Gaston Sylvestre en 1991 au tout jeune Opéra-Bastille, sur son étui de trompette.
Litanie des points cardinaux
Brève nº4 pour violon, interprétée par Eric Crambes. Paroles et musique © Jacques Rebotier
Apollinaire?
Brève n°1 pour trompette marine: première des 66 (et quelques) Brèves pour 66 (et quelques) musiciens-parlants de Jacques Rebotier, interprétée par Virginie Michaud, à partir d’un poème à vers unique de Guillaume Apollinaire.
Pourquoi tu m’aimes plus?
Pour inaugurer la série des brèves pour musiciens-parlants, la nº17 pour tuba, de Jacques Rebotier, interprétée par Maxime Morel. Bonne Saint-Valentin!
À lire également
Bref récapitulatif
Libérée, délivrée…
Remerciements
Traduire le malentendu
Depuis sa création en 1836 dans une Grèce fraîchement indépendante, la pièce La Tour de Babel (Vavylonìa) de Dimitris Vyzantios n’a pratiquement pas cessé d’être jouée, lue, adaptée sous diverses formes sur le territoire actuel de la Grèce et dans toutes les régions habitées par des communautés de langue grecque. On a même soutenu qu’il s’agissait là de « la plus grecque de toutes les pièces grecques ». S’y frotter pour tenter d’en donner une version française, c’était dès lors se colleter avec un mythe. Sa traductrice entend ici donner une idée du voyage qu’a constitué ce travail, au jour le jour.