Cette Seconde surprise de l’amour était bien faite pour Alain Françon. Pas d’arlequinades, pas de lazzis, pas de circonstances extérieures qui mèneraient l’intrigue, rien de ce « goût italien » encore présent dans La surprise de l’amour (la première). Ici, c’est simple et c’est clos : la marquise vient de perdre son mari ; le chevalier, sa femme, entrée au couvent. Ils se rencontrent (puisqu’ils sont voisins), et découvrent comme il est bon de partager son affliction. Dès la septième scène, la marquise dit au chevalier : « vous me ressemblez ; vous êtes né sensible ». Le chevalier n’est pas en reste : « le même jardin nous est commun (…) c’est un bonheur pour moi que de vous avoir vue. » L’affaire semble pliée. D’autant que Lisette, la servante de la marquise, et Lubin, le valet du chevalier, en pincent vite l’un pour l’autre et que leur seul espoir, pour convoler, est que leurs maîtres se fassent « l’amitié de s’épouser par amour ».
Bien sûr, l’affaire n’est pas pliée, elle va même se tordre en nœuds de plus en plus serrés. Marivaux, que seul occupe l’amour au travail, ses aveuglements et ses feintes, s’occupe à miner le terrain, et Françon à faire jaillir de l’examen scrupuleux de la langue les contradictions, les contenus inconscients, et le rythme caché.
Comme à son habitude, comme depuis longtemps, depuis qu’il a appris avec Michel Vinaver à faire du théâtre pour l’oreille et pas pour l’œil, il traque les reprises de mots, les glissements de sens, le groupes rythmiques, les piano et les forte. Il fait de la musique sur la base d’une partition très construite, et qui pourtant semble s’inventer à mesure qu’elle progresse.
On est d’abord décontenancé. Quoi ! Où est passée la belle langue dix-huitième de la conversation galante ? Pourquoi ces passages dits comme en apnée de façon monocorde ? À l’inverse, Lisette (Suzanne de Baecque), mélange foldingue d’Anémone et de Bernadette Laffont, ne ménage pas sa gouaille parigote.
On se raisonne : belle langue galante, c’est vite dit. Le style de Marivaux est chiche en périodes ourlées, il est rapide, fait de phrases aboutées, très virgulées, qui galopent à la diable. Pourquoi pas cette torsion que lui fait subir Françon ? On s’y fait vite, parce qu’on se sent conduit. On se ressouvient de la façon dont les jeunes acteurs d’Abdellatif Kechiche, dans L’Esquive, disaient, la bouche pleine, des répliques des Jeux de l’amour et du hasard. On s’imagine sans déplaisir la tête d’Alain Finkielkraut ou de Fabrice Luchini face à ces outrages. On jubilerait presque.
Mais voici une autre extravagance. Le chevalier et la marquise sont d’emblée vénère comme pas possible. Chagrins, dépités, agressifs l’un vis-à-vis de l’autre, parfois au bord de la crise de nerfs. L’ambiance est plombée, seulement éclaircie par les impertinences de Lisette et de Lubin.
Où Françon va-t-il chercher cela ? Certes, le chevalier et la marquise ont de quoi mélancoliser (« il me plaît d’être triste »), mais enfin, comme le dit Lisette : « Tout perdu ! vous me faites trembler. Est-ce que tous les hommes sont morts ? ». Peine perdue : la marquise travaille de l’atrabile, et cela ira de mal en pis. À l’acte II, la voici au désespoir. La raison ? Lisette a fait courir le bruit que sa maîtresse soupirait après le chevalier, et que celui-ci n’en avait été que modérément touché. Voilà qui est inacceptable. Qu’un homme puisse la refuser même si elle ne désire ni l’aimer ni en être aimée est un outrage absolu. La marquise est de son temps : elle ne fait qu’obéir au « code des honnêtes gens » ; la voici déshonorée. On se dit alors deux choses. Un : que ce code propre à l’aristocratie du 18e siècle est si éloigné de nous qu’il peine à nous parvenir ; on peut s’irriter qu’il hystérise les affects et les passions, et trouver que la marquise fait bien « na na na des manières », comme la Célimène de L’ami Zantrop (Boby Lapointe) – le chevalier n’est pas en reste. Marivaux, qu’on a coutume de présenter comme la quintessence d’un certain esprit français, nous paraît d’un coup bien exotique. Deux : que c’est peut-être ce fil qu’a tiré Françon, et que de là vient le climat d’exaspération dans lequel baigne toute la pièce.
Au moins le metteur en scène joue-t-il du contrepoint comique offert sur un plateau par les répliques savoureuses de Lisette et de Lubin, qui regardent « comme une énigme » l’embrouillamini où s’empatouillent leurs maîtres ? Sans excès. Ce théâtre-là ne fait pas dans la pitrerie, ne rit pas des faquins. Du reste, maîtres et serviteurs ne se distinguent pas excessivement par leur mise. Les costumes sont décalés (années trente-quarante, comme dans Du mariage au divorce – bout à bout de quatre petites pièces de Feydeau mises en scène par Françon en 2010), ils le sont pour tous. Entre les uns et les autres, une sorte d’égalité dans l’adresse, de ton pré-démocratique.
On ne rigole pas même d’Hortensius le pédant, bibliothécaire et lecteur particulier de la marquise, moliéresque, plaisamment ridicule ? Pas vraiment. C’est qu’il fait presque pitié, ce bonhomme lunaire (Rodolple Congé) en blouse de boutiquier, sorte de Jackie Berroyer affligé d’une coiffure à la Labyrinth Man.
Il faut bien s’y résoudre : ce qui intéresse Françon, c’est la surprise existentielle de l’amour, qui est une épreuve violente et bouleversante, une chose sérieuse. Rien ne doit distraire de cette exploration. La scénographie : simplissime. Deux perrons, un bassin entre eux, et au fond, peinte par Jacques Gabel, collaborateur historique de Françon, une toile – faux Watteau, vrai méli-mélo d’arbrisseaux embrouillés. La musique : quelques accords pour des entrées et sorties, trois fois rien. Toujours le credo de Françon : faire « scandaleusement simple ».
Dites, entre nous, elle ne serait pas un peu trop… austère, cette mise en scène ? Elle l’est, mais rien qui gâte le plaisir. Il est vrai que les « grands continuums » de texte voulus par Françon, s’ils tendent le rythme (jusqu’à l’essoufflement), font perdre des nuances. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’à la revoyure, deux semaines après la première, les acteurs, au premier rang desquels Suzanne de Baecque et Pierre-François Garel en chevalier, semblent avoir trouvé leur prise personnelle sur le texte et desserré un peu le corset des parti-pris. La « pure algèbre des valeurs sentimentales » (Claude Roy) a gagné en chair et en fantaisie. Georgia Scallet (la marquise) pousse jusqu’au rire la convulsion nerveuse. Sur un fil tendu, le pari est gagné.
JB Corteggiani
Théâtre
 La Seconde Surprise de l’amour de Marivaux, mise en scène Alain Françon, 5 novembre – 4 décembre 2021 aux Ateliers Berthier, Paris 17e, du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h, relâche le dimanche 7 novembre, durée 1h50, avec Thomas Blanchard, Rodolphe Congé, Suzanne De Baecque, Pierre-François Garel, Alexandre Ruby, Georgia Scalliet
La Seconde Surprise de l’amour de Marivaux, mise en scène Alain Françon, 5 novembre – 4 décembre 2021 aux Ateliers Berthier, Paris 17e, du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h, relâche le dimanche 7 novembre, durée 1h50, avec Thomas Blanchard, Rodolphe Congé, Suzanne De Baecque, Pierre-François Garel, Alexandre Ruby, Georgia Scalliet










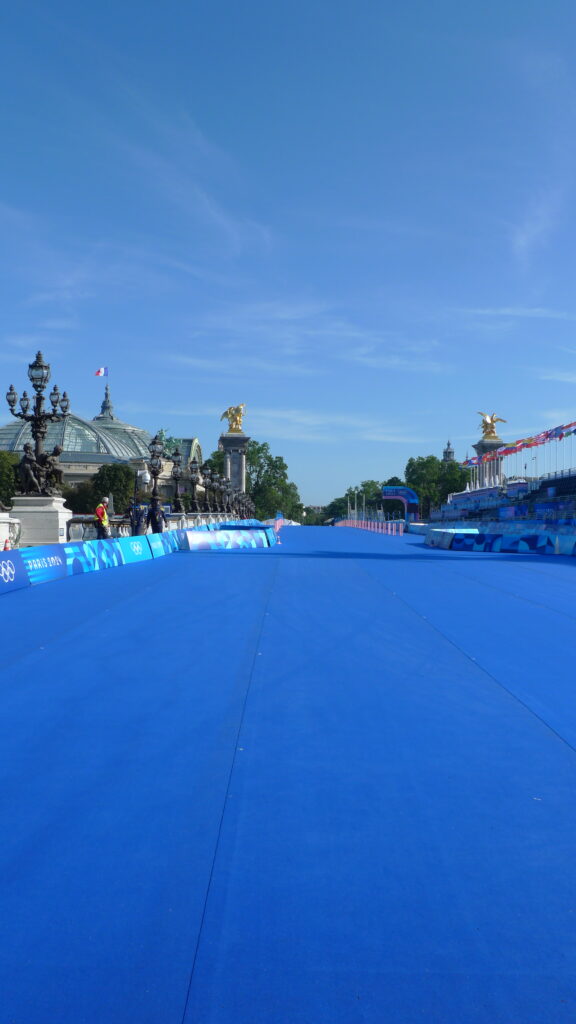

0 commentaires