“Le Gouffre aux Séries”: une plongée bimensuelle dans soixante ans de feuilletons et de séries à la recherche des perles rares et de leurs secrets de fabrication.

Lorsque l’on me demande (cela arrive) si je regarde des séries, je suis bien obligé de répondre oui puisque j’en ai vu près de trois cents dont certaines alignaient jusqu’à huit saisons. Ai-je perdu mon temps, plusieurs milliers d’heures au bas mot ? Parfois oui, parfois non, en tout cas j’ai souvent passé de bons moments, volés à la lecture hélas. Ai-je des séries ou mini-séries préférées ? Bien sûr : Le Prisonnier, The Wire, Breaking Bad et Black Mirror évidemment, mais aussi American Crime (à ne pas confondre avec American Crime Story, pas mauvaise non plus), Severance, Show me a Hero, Unbelievable, The Haunting of Hill House, Succession, The Good Fight, Les Shtisels, Our Boys (à ne pas confondre avec l’amusante The Boys). Je garde par ailleurs un souvenir ému de Que ferait-donc Faber ?, une mini-série diffusée par l’ORTF en 1969, laquelle n’est peut-être belle que dans mes souvenirs. Je me souviens surtout que Claude Piéplu y jouait avec malice un représentant en produits de Farces et attrapes.
Ai-je appris des choses durant ces longues heures devant l’écran ? Au moins une : la soif de fiction peut être étanchée de mille manières. L’être humain, nous le savons bien, adore qu’on lui raconte des histoires. La littérature, le cinéma, le théâtre, les conteurs ou simplement les rêves et rêveries en fournissaient déjà beaucoup, nous plongeant dans d’autres vies que les nôtres, nous projetant dans des mondes totalement imaginaires ou vraisemblables, offrant des expériences de pensée, aidant parfois à renforcer le lien social. Les séries ont cette qualité supplémentaire d’offrir le reflet le plus actuel, le plus synchrone et peut-être le plus précis de la société telle qu’elle va. Elles y parviennent en déployant une incroyable diversité de thèmes, de rythmes, de formes, de longueurs et d’ambition. Rien qu’aux Etats-Unis, il s’en produit annuellement plus de quatre cents, certaines bénéficiant de moyens importants : 15 millions de dollars par épisode pour la dernière saison de Game of Thrones. Malgré tout, les joyaux ne se comptent, bon an mal an, que sur les doigts d’une ou deux mains.
Au volant
Le succès ou l’échec d’une série repose en partie sur la qualité de son pilote, le premier épisode de la première saison. Une cinquantaine de minutes pour installer des personnages, un univers, des ressorts dramatiques, un ton, c’est vraiment court. Le pilote de Breaking Bad est un des plus réussis, attrapant le spectateur par le col dès les premières secondes. Cependant un premier épisode mollasson ou convenu peut cacher une série captivante (c’est le cas avec The Wire). Il arrive que cette introduction soit un peu confuse lorsqu’il s’agit de présenter une dizaine de personnages en un tour d’horloge, mais la suite peut s’avérer d’une grande fluidité (Shameless, Downton Abbey). Le problème est différent pour les séries dites d’anthologie, celles dont chaque saison voire chaque épisode change d’univers et de personnages (Black Mirror, Fargo, American Crime, The Twilight Zone, etc). Ce sont des recueils de nouvelles où la chute est plus importante que l’incipit.
Il suffit en général de quelques minutes pour savoir à quelle distance de la réalité l’œuvre va se tenir, pour sentir si elle va nous noyer sous un déluge de points sur les i ou si au contraire elle va nous traiter en spectateurs adultes et avertis. Car, avertis, nous le sommes désormais : nous avons grandi avec les séries autant qu’elles ont grandi avec nous. Au fil du temps, nous avons appris à apprécier leurs acrobaties : ellipses, audaces formelles, jeu avec le temps (nous y reviendrons dans un prochain épisode), bref nous avons été formés et ce n’est pas superflu. N’est-il pas plus facile d’apprécier Ligeti lorsqu’on s’est construit l’oreille avec Bach ? Les transgressions du be-bop ne sont-elles pas plus jouissives quand on connaît les standards du jazz des années vingt et trente ? Avec le Nouveau roman, n’avons-nous pas aimé piétiner Balzac sans l’enterrer pour autant ?
De leur côté, les réalisateurs et showrunners se sont appuyés au fil des années sur cette, disons, plasticité neuronale pour casser les codes, aller plus dans la transgression ou la connivence. Les producteurs de The Good Fight n’hésitent pas à balancer ex-abrupto, au beau milieu d’un épisode, des séquences pseudo-didactiques sur le droit ou l’économie sous forme de chansons et d’images d’animation. Le contrat qui lie une série à son spectateur comprend de moins en moins de clauses formelles.
Il n’en reste pas moins que tout pilote a un impératif : installer rapidement des personnages. C’est sans doute le plus difficile car un bon personnage est un personnage complexe, atypique voire ambigu, et quand ils sont nombreux … La qualité du jeu des acteurs reste évidemment un facteur déterminant, en sus du travail d’écriture qui est fait en amont. Le pilote donne un premier schéma de la psychologie des gens avec qui nous allons (ou pas) vivre quelques heures, en attendant qu’il s’affine au fil des épisodes, et même, dans le cas de personnages secondaires ayant crevé l’écran, dans un spin-off, c’est-à-dire une série dérivée de la série. Ainsi l’avocat Saul Goodman (Bob Odenkirk) de Breaking Bad est-il devenu le héros de Better Call Saul, ainsi l’avocate Diane Lockhart (Christine Baranski) de The Good Wife est-elle au centre de The Good Fight.
Moteur !
Donc voilà : ce soir, nous nous installons devant la télé en nous branchant sur la VOD, un service de streaming, une chaîne spécialisée, un lecteur de DVD ou bien après avoir chargé (légalement bien sûr !) sur notre ordinateur le premier épisode de la première saison de telle ou telle série. Quelques critiques pêchées ici ou là ont orienté notre choix. Cela peut être aussi un simple pitch, quoiqu’il faille souvent s’en méfier (nous y reviendrons aussi).

Prêts ? Embarquons ! Ce soir, tout commence par quelques images nocturnes indéchiffrables, puis apparaît à l’écran un type face caméra interrogé par deux policiers qui restent hors champ tout au long de la séquence. Le type semble assez désabusé, ce qu’il raconte est opaque mais cette opacité-même nous fait tendre l’œil et l’oreille. Nous devinons que cet interrogatoire se déroule après les faits qui vont nous être racontés, c’est-à-dire qu’on nous les raconte déjà en creux. L’interrogatoire est entrecoupé de ce que l’on imagine être de courts flashbacks, guère plus éclairants que les scènes initiales. Nous nageons complètement mais agréablement et, d’emblée, séduits par le rythme, la qualité du jeu et le style de narration, nous signons le contrat. Et c’est parti pour la première saison de True Detective (1).
♦


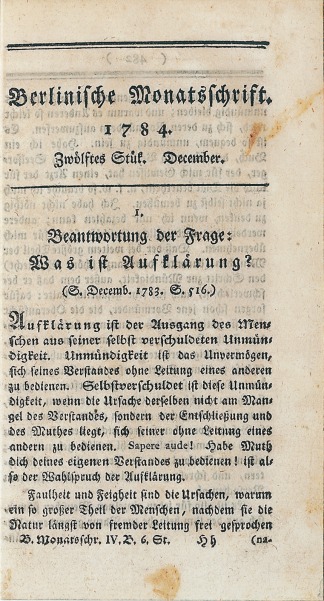


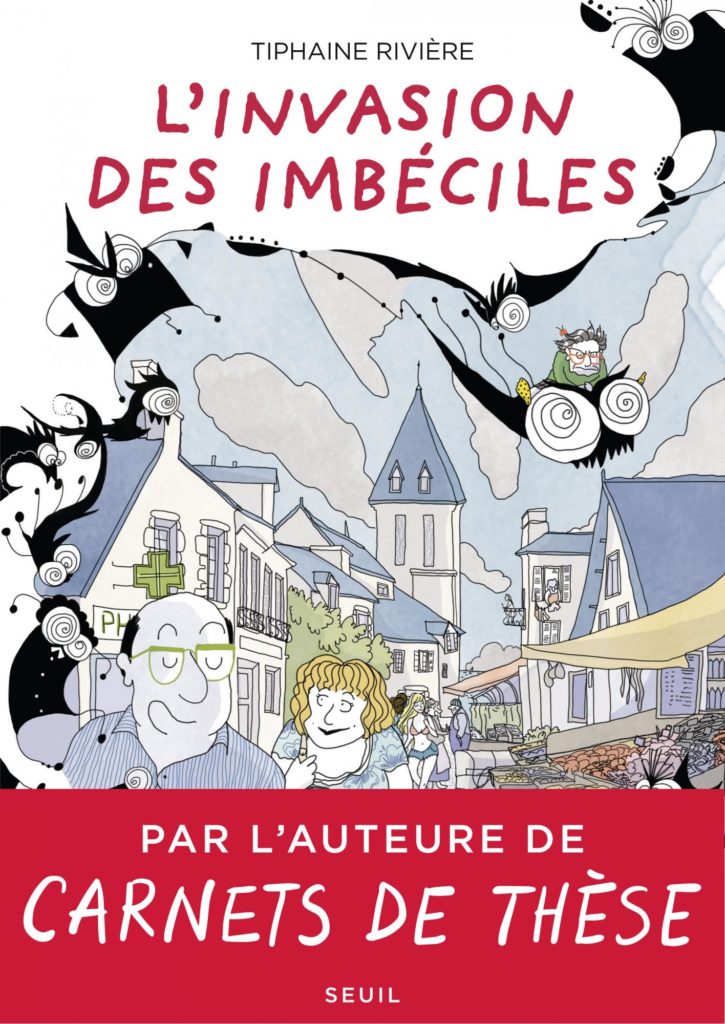



0 commentaires