Les chorégraphes ont toujours aimé la fantasmagorie tout en ayant une vraie appréhension de la narration. Comment dire sans illustrer, comment raconter sans mimer ou sans pantomime ? Comment conter sans livret ? Telles sont les questions dont la danse contemporaine jugea bon de se débarrasser afin de ne plus être soumise au texte. Mais le merveilleux n’a pas fini d’œuvrer et bien que l’on préfère l’abstraction ou le minimalisme aux champs ouverts sur tout fantasme, il n’est pas désagréable de s’en laisser conter comme avec, par exemple, la Cendrillon de Maguy Marin.
En rendant visite à Cocteau qui signa avec René Clément le film fantastique La belle et la Bête en 1946, Thierry Malandain, directeur du Centre chorégraphique national de Biarritz et du festival Le Temps d’aimer, s’est attaché principalement à deux personnages : celui du créateur (Cocteau) et celui de la bête. La belle se contente d’être gracieuse. Scénographiquement, les jeux de pendillons qui permettent de passer d’une scène à l’autre, d’une ambiance à une autre, rythment correctement le spectacle. La danse est ample, piquante, bien qu’un peu bavarde, et l’on regrette de ne pas voir la transfiguration de la bête en prince. Le ballet est également un brin trop pathétique par sa résonance avec la sixième symphonie de Tchaïkovski.
Pour le reste tout public, on se balade dans le conte écrit par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, porté par 22 danseurs au top et visiblement heureux dans la compagnie. Jamais prétentieux, Thierry Malandain sait se mettre à l’écoute tout en prenant en charge la lourde responsabilité de directeur du ballet. Ce qui rugit en lui se retrouve dans la bête. Il n’en dira pas plus pas plus que ne le dit Cocteau dans son journal de tournage : “C’est la réserve incrédule des grandes personnes qu’il faut vaincre.”
Au Grand Théâtre de Provence à Aix, en suivant “l’aventure extraordinaire” décrite dans un conte chinois médiéval La peinture sur le mur, Angelin Preljocaj – accompagné, excusez du peu, pour la musique originale par Nicolas Godin du duo Air, pop en diable, et de Azzedine Alaïa pour les costumes, sexy en diable – trouve aussi le moyen de s’affranchir des règles narratives trop appuyées. On passe ainsi du monde virtuel au réel avec des créatures de rêve, des femmes aux chevelures déliées, promises au mariage. L’histoire bien que parfois un peu confuse est attrayante : un homme se prend d’amour pour une femme peinte et se marie avec elle. Mieux vaut mariage d’illusion que mariage de raison.
La Fresque se lit comme un album joliment illustré, dans une scénographie où tout n’est que volutes de fumée ou cheveux d’ange. Seule une scène glace les sangs : les femmes y sont tirées symboliquement par les cheveux. Ce que raconte ce conte dansé est que l’on peut se perdre dans un tableau ou une toile de Jouy, ne plus avoir la moindre idée du temps qui passe et vivre en bonne entente avec ses propres illusions.
Bien foutue aussi, même si la farine qui recouvre les danseurs et le plateau en fin de spectacle, nous paraît alourdir le propos dans la pétrification, la pièce d’Olivia Grandville Combat de Carnaval et Carême, inspirée du tableau de Brueghel l’Ancien, disloque la peinture pour en tirer les motifs et les redistribuer. La chorégraphe joue sur les poses, les arrêts, mettant en scène des personnages outranciers, grimaçants. Les rituels populaires y sont passés au crible, jeûne et fiesta. Les dix danseurs équipés d’une oreillette obéissent à des tâches, des consignes comme dans les performances des post-modern américains et se fondent ainsi dans les 160 personnages du tableau de référence. Gloutonne, Olivia Grandville dévore ses propres influences et les recrache à sa façon.
Marie-Christine Vernay
Danse
On retrouve Olivia Grandville en janvier à la Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, Thierry Malandain dans une tournée en France et à l’étranger et Angelin Preljocaj dans une longue tournée qui passera par le Théâtre national de Chaillot à Paris et s’achèvera en juin à la Criée de Marseille.
[print_link]







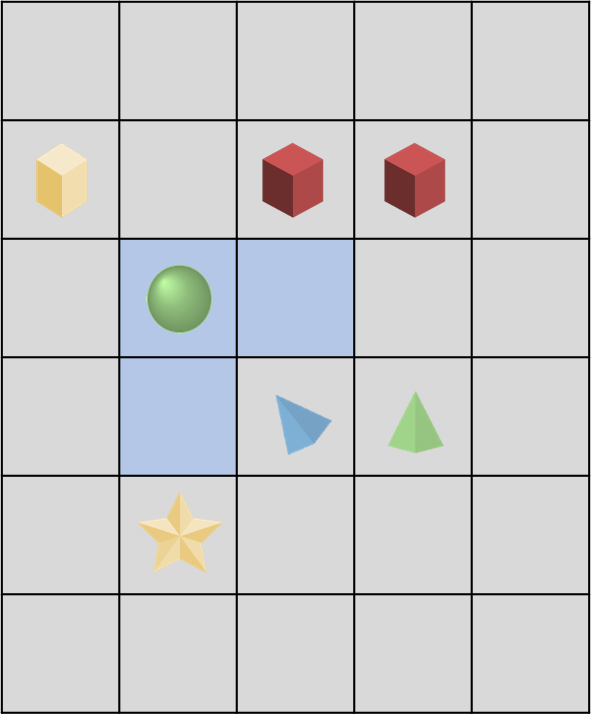




0 commentaires