On croit voir l’ombre immense et consolante de Wajdi Mouawad, l’homme, l’acteur, se pencher sur une maison de poupée dont il aurait ôté le toit. Dans cette maison de poupée, qui est la scène, il y a Wajdi petit (dix ans), sa sœur aînée et sa mère. Tous les trois sont réfugiés à Paris, au début des années 1980, tandis que le père est resté au Liban, où la guerre civile fait rage. Le Wajdi d’aujourd’hui, 53 ans, circule sur le plateau, invisible, entre le mini-lui-même et les siens qui s’activent à la cuisine (odeurs de cannelle et d’oignon haché), sursautent à chaque sonnerie de téléphone, s’engueulent à propos de dates et de souvenirs. À la nuit tombée, Wajdi couvre d’un drap les corps endormis à même le sol. C’est simple et c’est poignant. « Lentement, il faut guérir lentement, consoler lentement », disait un des personnages de Tous des oiseaux (2018).
Après Seuls et Sœurs, Mouawad poursuit avec Mère son cycle Domestique, non prémédité, engagé dans l’élan, comme l’avait été le cycle précédent, Le sang des promesses (de Littoral à Ciels). Changement de focale, centrage sur l’intime et la famille : ici se confirme la mise entre parenthèses du principe éthique et narratif qui gouvernait les grandes fresques du Sang des promesses: «donne la parole à celui que tu as détesté» (dans le cas de Mouawad, chrétien maronite : le juif et le musulman). Un apaisement relatif s’est fait jour, le drame laisse une place à la comédie tendre. C’est Mouawad lui-même qui donne le ton, en lever de rideau. Il prévient : les surtitres sont un peu longs, mais c’est qu’en libanais, « mon chéri » se dit « ô toi qui j’espère m’enterreras ». Le public est cueilli, conquis.
Non seulement les surtitres sont longs, mais ils sont omniprésents : les comédiens parlent l’arabe du Liban ; l’auteur a écrit en français avant d’être « détraduit ». En entretien, il affirme s’être rendu compte, à cette occcasion, qu’il avait « toujours écrit en arabe », que c’était comme si « on avait enlevé le vernis de la langue française ». On ne saurait le dire. Ce qu’on sent bien en revanche, c’est une langue plus concrète et moins lyrique que dans les premières pièces. Rien de comparable à ceci, dans Littoral (1999) : « Raconte [la mer] ! – Bruit mouvement du bleu tout le temps tout le temps va-et-vient oiseaux et vent et grand très grand c’est grand de tous les bleus possibles ».
Encore une pièce autobiographique de Mouawad ? Il n’en finira donc jamais ? Non, sans doute pas. Mais c’est d’un mentir-vrai qu’il s’agit ici, d’une histoire personnelle enrichie par les histoires d’un collectif théâtral et humain. Le programme était déjà énoncé dans Littoral : « Tout ce qu’ils veulent nous faire oublier, on va l’inventer, le raconter ! » On songe à Fellini : « Maestro, y aura-t-il d’autres souvenirs d’enfance dans votre prochain film ? – Laissez-moi le temps d’en inventer de nouveaux. »
De sa mère, Mouawad dit d’emblée qu’elle est morte il y a 34 ans. Voici Aïda Sabra, toute en lamentos, imprécations, hululements, malédictions, tendres menaces (« je vais te faire manger un meurtre »). Ses saillies de mère orientale déchaînée portent une bonne partie du comique – parfois jusqu’à l’usure. On la préfère parfois en duo avec sa fille adolescente (Odette Makhlouf), qui décrypte ses outrances pour le public : « c’est une figure de style ». Ensemble, elles se rappellent l’histoire désopilante de cette femme sur qui est tombée une grenade le jour de son mariage, et qui a fini sur un arbre sans bras ni jambes (« en libanais, c’est drôle »). Et il n’y avait pas d’échelle assez haute pour la descendre ! Même que les gamins tiraient au lance-pierre pour écarter les oiseaux qui voulaient becqueter son cadavre ! Les deux femmes sont pliées. Dans Tous des oiseaux, c’était moins drôle : « Il y avait un bougainvillier en fleur, rouge, magnifique, et au milieu des cris, des hurlements, j’ai pensé à cette beauté dans la lumière du soleil, mais ce n’était rien ! Ni beauté ni bougainvillier, mais les restes ensanglantés d’un corps humain éparpillés contre les fils de fer barbelés. »
Loin des fous rires, le petit Wajdi, qui est en CM2, s’applique à ses devoirs. Il écrit encore mézon pour maison et dit « je alle », du verbe aller. A l’école, on lui donne du « sale arabe » (lui qui est « phénicien »). Il écoute à la radio Julio Iglesias et Enrico Macias, Mort Shuman et Claude François, mais ce qu’il préfère c’est regarder Goldorak à la télé. Goldorak et Christine Ockrent, qui réunit toute la famille. C’est ici que Mouawad tente – et réussit – son premier coup de culot. Comme dans La rose pourpre du Caire, de Woody Allen, la star (interprétée par elle-même et non surtitrée) sort de l’écran et s’invite dans l’appartement de la famille. On l’interpelle, on la houspille : « La Sécu, on s’en fout ! On veut des nouvelles du Liban ! » Alors soudain, dans les reportages de Philippe Rochot, notre correspondant sur place, ce n’est plus la litanie du malheur abstrait, Sharon-Gemayel-Abou Nidal, c’est « l’immeuble de notre coiffeur, notre église, notre quartier ! », « un obus est tombé dans la chambre de Nayla ! ». On entend le son énorme de « vraies » bombes. Les sonneries du téléphone se transforment en rafales d’armes automatiques. Le petit Wajdi s’amuse à pasticher un reportage du JT en imaginant une guerre civile à Paris : « Il y a du sang partout sur les cols roulés en promotion ! ». On se sent tout de suite plus concerné.
Le deuxième coup bluffant, c’est la rencontre imaginée par l’auteur Mouawad entre l’acteur Mouawad et sa mère : « J’ai écrit cette scène pour pouvoir te parler. » Il lui raconte : « J’ai deux enfants, j’ai quitté le Québec, je suis revenu en France. Pierre Bachelet est mort. Les Français mettent toujours de la semoule dans le taboulé. » C’est parti pour être drôle. Ça ne dure pas. Des photos de la mère en mariée apparaissent sur le fond de scène. « Tu ne souris pas, tu as l’air d’une femme qui va vers son malheur. » Aïda Sabra répond par un vibrant « je chante, tu n’es pas venu », a cappella. Ça met les poils, plus que Bertrand Cantat prolongeant curieusement Emmenez-moi (Aznavour) ou Le Sud (Nino Ferrer) – sa dernière « chanson » est en rechanche une réussite tellurique et fulgurante, dans la lignée de l’album Des visages des figures (Noir Désir).

Comment ça, bluffante, une rencontre entre un vivant et une morte ? N’est-ce pas tout naturel, dans le théâtre de Mouawad ? C’est vrai, mais elle très habilement « scénarisée », et tendue par une émotion poignante. Fallait-il souligner que le théâtre, c’est comme « le jardin des fantômes » ? Sans doute pas. Mais holà sur la critique paresseuse et facile qui reproche à Mouawad emphase et pathos. Il faut être un bien triste frigide pour qualifier de pathos l’expression lyrique et ample du sentiment. De l’emphase il y en a un peu, parfois : « Ne laisse jamais ton identité devenir une insulte », dit Ockrent au petit Wajdi. C’est vraiment pour pinailler.
Puisqu’on en est aux énervements : les mises en scène de Wajdi Mouawad sont-elles académiques ? Tout dépend du taux d’avant-gardisme que l’on a dans le sang. Si l’on a-do-ré, par exemple, voir chez Julien Gosselin, sur un écran situé au-dessus de la scène, des comédiens filmés en direct dans un espace masqué au public (dans Le Passé, actuellement au théâtre de l’Odéon) [1], alors oui, les mises en scène de Wajdi Mouawad sont académiques. Mais d’une délicieuse fluidité – travail de lumière, souplesse des déplacements de décor, surtitres qui filent et glissent sur le fond de scène au gré des déplacements des comédiens– d’une fluidité qui rappelle l’art du montage invisible des grands films de l’âge d’or hollywoodien.
JB Corteggiani
Théâtre
Mère de Wajdi Mouawad, ms de l’auteur, Théâtre national de la Colline, Paris, jusqu’au 30 décembre.
[1] Beaucoup de ratages dans cette mise en scène – normal, Julien Gosselin déclare qu’un artiste doit avoir l’ambition de rater – mais aussi des trouvailles audacieuses. Et une incroyable performance d’athlétisme affectif de Victoria Quesnel, qui pour elle seule mérite le déplacement.








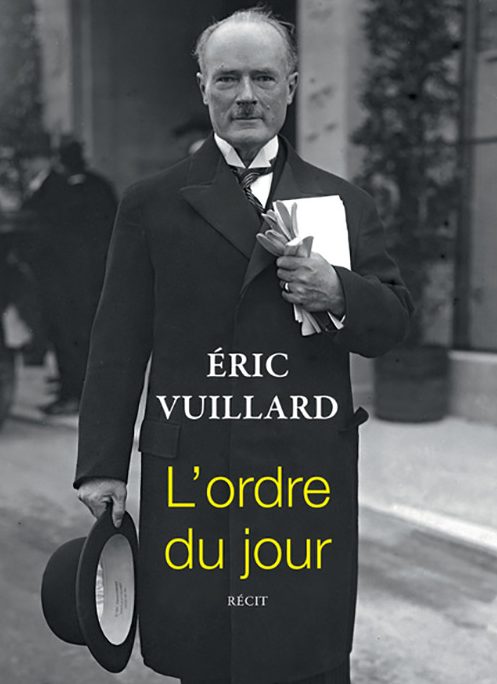



0 commentaires