Le coin des traîtres : pièges, surprises, vertiges, plaisirs et mystères de la traduction…
Au début des années 1980, pendant quatre ou cinq ans, j’ai traduit des chansons de variétés, pour des « interprètes » de toutes sortes et des maisons d’éditions tout aussi variées. C’était l’époque où l’Espagne était à la mode, pendant la Movida, et beaucoup s’imaginaient, en France, qu’il serait intéressant – et juteux – de conquérir un marché qui avait tant souffert pendant des années de dictature. Les pauvres, un peu de musiquette française ne pouvait que leur faire du bien. Donc, c’était à qui sortirait son disque en espagnol avec la french touch, de toute urgence.
Mes compétences pour une telle entreprise, moi, un Français qu’on faisait traduire en espagnol ? On ne me les a jamais demandées. Que je sois prof de fac, spécialiste de poésie contemporaine, etc., tout le monde s’en moquait éperdument, surtout les impresarios ou les chanteurs qui traitaient généralement les traducteurs avec un dédain manifeste, quantité négligeable devant les œuvres immortelles qu’on devait lancer sur le marché. Il y en même une, chanteuse et violoniste fort talentueuse, qui m’a franchement traité comme un larbin (non rétribué) devant sa cour enamourée. On a même parfois évincé ma signature sur les contrats de la SACEM, au profit d’une « personnalité » plus susceptible de doper des ventes qu’on supposait vertigineuses.
 Je ne devais ma soudaine « autorité » de traducteur qu’à un ami espagnol, alors représentant pour la France et l’Europe du Nord des intérêts de la plus grande compagnie de disques américaine, qui cornaquait quelques vedettes du moment qui voulaient, elles aussi, conquérir l’eldorado hispanique. Du copinage donc, mais l’aventure c’est l’aventure. Après un premier essai, juste pour voir (de quoi j’étais capable), qui ne déboucha sur rien, on attaqua un disque entier d’Hervé Vilard qui, après son exil sud-américain de dix ans se débrouillait en espagnol. Il pinailla bien un peu sur les traductions, mais le ponte de la CBS veillait et tout rentrait dans l’ordre. Capri c’est fini, devait faire un tabac en Espagne et relancer la carrière d’Hervé Vilard. Raté.
Je ne devais ma soudaine « autorité » de traducteur qu’à un ami espagnol, alors représentant pour la France et l’Europe du Nord des intérêts de la plus grande compagnie de disques américaine, qui cornaquait quelques vedettes du moment qui voulaient, elles aussi, conquérir l’eldorado hispanique. Du copinage donc, mais l’aventure c’est l’aventure. Après un premier essai, juste pour voir (de quoi j’étais capable), qui ne déboucha sur rien, on attaqua un disque entier d’Hervé Vilard qui, après son exil sud-américain de dix ans se débrouillait en espagnol. Il pinailla bien un peu sur les traductions, mais le ponte de la CBS veillait et tout rentrait dans l’ordre. Capri c’est fini, devait faire un tabac en Espagne et relancer la carrière d’Hervé Vilard. Raté.
Hervé Vilard, El ladrón de sueños
Hervé Vilard, Me importa un bledo
Ensuite, les propositions se sont enchaînées. Toutes n’ont pas débouché sur un disque, mais certains projets furent quand même menés à bien (façon de parler). Linda de Suza tenait à exporter La Valise en carton et quelques fados vers l’adversaire de toujours. Personne ne s’est inquiété de ma compétence en portugais. Menée tambour battant, l’entreprise n’eut pas non plus le succès espéré. L’histoire la plus longue et la plus persévérante eut lieu avec un impresario convaincu d’avoir trouvé la pépite qui nous rendrait tous riches (c’était sa rengaine à lui), en la personne d’un jeune homme, un blondinet de vingt ans, de bonne mine, qu’il suffisait de formater et d’encadrer convenablement, malgré un talent approximatif et une voix qui n’avait rien de renversant. On enregistra donc trois ou quatre disques, qui visaient l’Espagne et les pays latino-américains, et même les Hispaniques des États-Unis. L’idée était de refaire le coup d’Hervé Vilard en rajeunissant l’image du french lover. « On » a quand même été entendu au Chili, on a été premier au hit parade d’une obscure radio locale de Wichita, au Kansas, et pas trop mal placé dans quelques radios très locales au Texas et en Floride, pendant une semaine ou deux. Le début de la gloire !
Les principes de la traduction variaient peu. La musique était toujours déjà composée. À moi de m’y adapter. Pour les paroles, soit on me demandait de réinventer une ritournelle bien sirupeuse sur un nouveau sujet, soit la traduction devait rester fidèle à l’original. Ce qui, pour une chanson, reste très relatif. Comme les accents de mots et les temps forts musicaux devaient absolument coïncider (on aurait pu jouer avec les mesures et les mots, mais il était hors de question de compliquer la vie des interprètes avec des subtilités prosodiques), la fluidité était essentielle : le confort avant tout, dans une langue qu’ils ne maîtrisaient pas. Surtout que les chœurs et les diverses parties instrumentales avaient déjà été enregistrés, conservés sur des pistes à part, en gardant trois ou quatre pistes pour le chanteur (c’était avant l’ère du numérique). Et on ne badinait pas avec le phrasé. Plus de dix ans après, j’ai reçu un coup de téléphone d’un chef d’orchestre très renommé qui me reprochait sans aménité d’avoir pondu un vers bancal qu’ils étaient incapables de restituer en studio. J’ai essayé de lui expliquer que mon vers était irréprochable, qu’il suffisait de respecter la synalèphe (la voyelle finale d’un mot et la voyelle qui commence le mot suivant ne constituent qu’une seule syllabe), un réflexe spontané pour n’importe quel Espagnol, dans la chanson ou dans la vie courante. Je ne connais pas la suite.
Même chose pour la rime qui devait sonner haut et clair. Résultat, il fallait jongler avec les accents toniques et les sons, quitte à s’écarter un peu (beaucoup) de l’original. Traduire corazón par « cœur », par exemple, c’est une évidence ou une nécessité, sauf qu’il faut se débrouiller pour compenser deux syllabes en moins ; et « cœur » manque de rimes intéressantes en français, alors que corazón rime (ou assone) avec une foule de mots (pasión, amor, dolor, calor, yo, etc.), ce qui est bien pratique et constitue la trame de base de tant de chansons d’amour espagnoles ou mexicaines. Et puis il était pratiquement exclu de mettre à la rime des mots autres que oxytons (accentués sur la dernière syllabe, faisant coïncider l’accent tonique et le dernier temps musical fort : « Mi amooooor »), et ce même si la rime en français comportait des paroxytons (« Toi que j’aaaaiiiiime »)… ce qui limitait singulièrement les options lexicales. Bref, il en faut de la gymnastique sonore, syntaxique et sémantique pour respecter le tempo, la prosodie et la sonorité, sans compliquer la vie du chanteur.
La partie la plus intéressante, surtout pour un prof étranger au milieu, c’étaient les séances d’enregistrement. Elles duraient quatre ou cinq heures, parfois même toute la nuit à partir de neuf heures du soir jusqu’au petit matin. Je n’y officiais pas en qualité de traducteur, mais comme « technicien » phonéticien, pour corriger les prononciations ou accentuations défectueuses. Il était bien clair pour tout le monde que j’intervenais comme bénévole, gratis ; une sorte de service après vente. Et c’était du boulot ! Je ne dirai rien de l’enregistrement musical et du travail de la voix, ce n’était pas mon rayon, encore qu’il est arrivé qu’on me place derrière le chanteur accroché à son micro, en plein studio, pour battre la mesure à coup de tapes aussi silencieuses qu’impérieuses sur son épaule, pour imprégner le rythme pour une voix hésitante. La patience des professionnels est infinie. Lors de la première séance d’enregistrement du jeune apprenti crooner, après sept heures d’efforts intenses, on n’avait pu garder que trois vers de la première strophe de la première chanson et encore, en jouant avec plusieurs pistes où on avait pu garder des bouts de vers « justes ».
Et on ne se rend pas compte à quel point l’espagnol est compliqué. Bizarrement, une voyelle aussi simple en apparence que le O devient un enfer qui guette presque à chaque mot : et certains E également. Et on s’aperçoit très vite aussi que certains sons ou mots, qu’on croit naturels, posent pour le pauvre rossignol des problèmes insolubles. Par exemple, le mot mujer, si banal dans une chanson d’amour, avec la succession d’une Jota et d’un R roulé double, est tout simplement impossible pour un palais peu agile : et, ce jour-là, il était hors de question de trouver un synonyme. Il est arrivé, parce que l’obstacle devant lequel le pur sang se trouvait était à ce point insurmontable, de devoir inventer de toute urgence une autre version plus à la portée de ses compétences linguistiques. Accoutumer l’hispaniste débutant à la synalèphe a exigé bien de la patience. Dans ces conditions, arriver à finir une chanson, avec des bouts disséminés sur quatre ou cinq pistes que le technicien raboutait avec une extraordinaire habileté, en jonglant avec les manettes et les boutons de sa console, était une grande satisfaction pour tout le monde : j’ai même vu un technicien se montrer capable de gagner un quart de ton sur une note que l’infortuné crooner en herbe n’arrivait pas à chanter juste, après des heures de tentatives. D’autres ont renâclé et ont préféré abandonner : Les lacs du Connemara, en espagnol, c’est difficile à articuler, surtout quand la musique s’accélère de plus en plus.
Mais je me suis bien amusé. Le milieu de la chansonnette n’est pas d’une gaieté folle, mais ces séances de phonétique appliquée m’ont appris beaucoup de choses. Et, contrairement à tout ce qu’on m’avait promis, je ne suis pas devenu riche avec mes traductions. L’Espagne, malgré les accords théoriques de réciprocité avec la SACEM, n’a jamais reversé le moindre sou (en tout cas pas à moi). Et imaginer que le Chili, l’Argentine ou le Kansas allait verser les droits était de la pure fantaisie. La seule chose que j’ai obtenue, c’est d’être admis comme « auteur-adhérent », en février 1982, à la SACEM, sans avoir à passer l’examen d’entrée, parce que j’avais plusieurs chansons déjà enregistrées, avec contrat et tout et tout, en échange de 350 francs de l’époque quand même. Tous les dix ou quinze ans, la SACEM m’envoie un courrier aimable avec l’état de mes comptes, un courrier où il est précisé que, vu la modicité des sommes dues (une poignée d’euros), elle remet à plus tard la liquidation de ce qu’elle me doit. Je la comprends.
Serge Salaün
Le coin des traîtres
Serge Salaün est professeur émérite de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, au sein de laquelle il a dirigé le Centre de recherche sur l’Espagne contemporaine. Ses traductions des pièces de Ramón del Valle-Inclán Lumières de Bohème et Carnaval de Mars ont été publiées aux éditions Ellug en 2015.








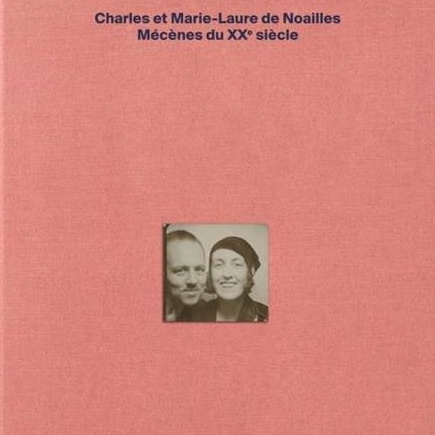
0 commentaires