On saluera bien sûr la performance sportive. Enfermés ensemble durant une douzaine d’heures à la Fabrica, acteurs et spectateurs ont toutes les raisons, vers 2 heures du matin, de se féliciter mutuellement. Avec ce spectacle auquel nous avons assisté lors de sa création au mois de juin au Phénix de Valenciennes, Julien Gosselin a relevé le défi : son adaptation de 2666, le roman fleuve posthume du Chilien Roberto Bolaño [1], tient la route, fidèle à la structure du roman, restituant l’histoire et les principaux personnages, se baladant d’Europe au Mexique sans lâcher le fil de la narration, et révélant à de nombreux spectateurs un auteur majeur de la littérature du XXIe siècle [2].
Pari réussi donc ? Tout dépend de ce que l’on entend par là. D’un roman au théâtre, on peut faire beaucoup de choses. S’en servir comme d’un matériau prétexte à une forme neuve, le faire entendre sur un mode proche de la lecture (ce ne sont pas les options retenues par Gosselin), le scénariser en le découpant en scènes ou séquences… Le roman de Bolaño s’y prête, avec à chacune de ses étapes, une structure narrative et un style particuliers. La première partie – “la partie des critiques” –, est une comédie en forme de chassé-croisé amoureux entre quatre universitaires européens (trois hommes, une femme) qui partagent l’obsession pour un auteur allemand aussi culte que confidentiel, que personne n’a jamais vu. Suit le portrait d’un philosophe chilien en train de basculer dans la folie, exilé dans la ville de Santa Teresa – le double fictionnel de Ciudad Juárez – à la frontière du Mexique et des États-Unis. Puis vient un récit à la Hemingway, l’histoire d’un journaliste new-yorkais envoyé couvrir un combat de boxe à Santa Teresa… cette ville étant le cœur des cinq parties du roman et du spectacle.

© Simon Gosselin
Avec cela, il est bien sûr possible de faire du théâtre et Gosselin a le savoir-faire pour embarquer les spectateurs dans un récit frontal auquel on s’intéresse. Le début du spectacle – “la partie des critiques” – se voit comme un vaudeville contemporain, avec sa suite amusante de coucheries et de quiproquos. Aussi plaisant que réducteur, le parti pris fonctionne. Cela se gâte après. Le traitement anecdotique se prête beaucoup moins à l’histoire du philosophe schizophrène, et à l’angoisse au cœur de la relation avec sa fille adolescente. Il retrouve sa pertinence au début de la troisième partie, qui offre la meilleur séquence du spectacle via un numéro d’acteur particulièrement réussi : le prêche, dans l’église où l’on enterre la mère du journaliste, d’un ancien Black Panther reconverti dans des émissions de cuisine à la télé. Adama Diop, le comédien qui tient le rôle, joue à fond le jeu de l’identification avec son personnage et le rend totalement crédible. Mais ce moment réussi a un effet paradoxal : il met en lumière l’une des faiblesses du spectacle, le défaut d’incarnation, justement. À partir du moment où Gosselin opte pour un traitement réaliste, il lui faudrait des comédiens aptes à jouer le jeu. Ce n’est pas toujours le cas, et les torts sont partagés entre interprètes et metteur en scène. Les premiers oscillent entre le surjeu – la véhémence des voix, renforcée par la saturation des basses, comme si cela était nécessaire pour souligner les tensions du roman – et l’entre-deux, parlant par moments espagnol avec l’accent français (l’effet est étrange, vaguement gênant), comme embarrassés de leurs rôles. Le même Adama Diop, excellent en prêcheur, a plus de mal avec le rôle de Fate, le journaliste en route pour Santa Teresa. Certains parti pris ne les aident pas, quand tel personnage – le géant allemand soupçonné des viols et meurtres de jeunes femmes à Santa Teresa – est caricaturé en Hannibal Lecter, ce qui tient carrément du contresens.
Les choses se gâtent encore dans la quatrième partie, celle qui plonge au cœur de l’horreur avec son interminable litanie de noms de jeunes femmes assassinés, et d’extraits de rapport de police ou d’autopsie. Julien Gosselin choisit de projeter ces listes sur un écran au dessus de la scène, mais est bien en peine d’en imaginer une traduction théâtrale, qu’elle soit de l’ordre de l’image ou du vide. Sans doute touche-t-on la limite de l’audace de Julien Gosselin, que l’on pouvait déjà pressentir dans son précédent spectacle, Les Particules élémentaires, d’après le roman de Michel Houellebecq. À l’époque, l’évidente ferveur qui animait le metteur en scène et sa compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur, n’occultait pas tout à fait le reste : un traitement du roman rythmé et plaisant mais souvent anecdotique et bien trop sage, une façon de rendre accessible – acceptable – un livre autrement plus dérangeant.
Pour 2666, le hiatus est flagrant. Le roman de Bolaño se prête à toutes les entrées, toutes les lectures (on pourrait dire tous les fantasmes). Il est tout à la fois simple –on peut le lire comme un thriller – et complexe – les pistes et les interprétations qu’il ouvre sont infinies. Le spectacle de Gosselin lisse tout cela, fermement accroché au fil des événements sans succomber au vertige, et l’excursion en enfer se transforme en visite guidée. Moins confortable, la lecture du roman dure beaucoup plus de douze heures ; elle peut être une aventure inoubliable. Ce n’est pas le cas du spectacle.
René Solis
[1] 2666 de Roberto Bolaño, traduit de l’espagnol (Chili) par Robert Amutio, Christian Bourgois éditeur, 2008.
[2] Signalons la prochaine parution d’un ouvrage consacré à l’œuvre de Roberto Bolaño : Florence Olivier, Sous le roman, la poésie. Le défi de Roberto Bolaño, Hermann, juillet 2016.

© Simon Gosselin
2666, d’après Roberto Bolaño, mise en scène de Julien Gosselin, La Fabrica, jusqu’au 16 juillet.
[print_link]

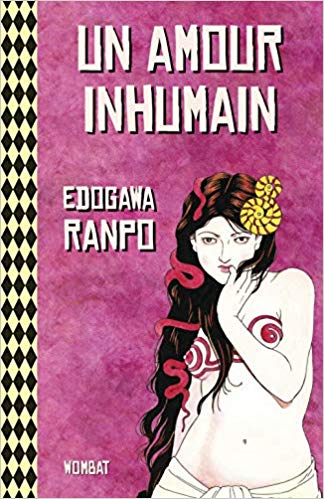






0 commentaires