Quand elle a commencé a utiliser les mots, Valérie Mréjen les a d’abord cherchés dans l’annuaire téléphonique. De l’enfilade alphabétique des noms propres, elle a prélevé ceux qui pouvaient aussi fonctionner comme noms communs, autrement dit : ceux qui pouvaient échapper à l’individu qu’ils devaient désigner pour glisser, inaperçus et anonymes, dans le langage de tous les jours. Valérie Mréjen a utilisé certains de ces noms exfiltrés pour les coller au revers de cartes postales, images désuètes de complexes hôteliers ou de stations de ski et les utiliser comme matériaux du récit d’une banalité vacancière (“Congé Bien Mérité”, “Calme Estival”, etc). Valérie Mréjen a ensuite abandonné l’annuaire – trop fastidieux – elle a écrit ses propres textes, tantôt pour les publier, tantôt pour les faire dire par des acteurs qu’elle filme. Mais même sans annuaire, une constante demeure dans l’art de Valérie Mréjen, l’art de détourner des noms propres pour dire des lieux communs.
Le lieu commun, bien sûr, c’est le banal, c’est ce qu’on dit trop et sans y penser, une expression prête à l’emploi et que, pour cette raison, on croit souvent vide de sens : celui qui parle par lieux communs est alors considéré comme celui qui parle “pour ne rien dire”. Rien n’est plus faux. Parce qu’il est partagé, parce qu’il est un terrain connu, parce qu’il tait l’essentiel mais le laisse deviner, le lieu commun parle souvent bien mieux que tous les “lieux propres”, ces formulations contournées, subtiles et supposément adéquates, toutes de nuances et de complexité, qu’un individu élabore pour décrire la spécificité de son expérience, de sa perception, voire (car c’est souvent à cette triste extrémité que mènent les lieux propres) de son ressenti. Valérie Mréjen a le génie de réhabiliter les lieux communs et l’exposition qu’elle présente actuellement à la galerie Anne-Sarah Bénichou le démontre une fois encore.
L’exposition s’intitule Roots. Roots, racines : il y a bien des raisons pour lesquelles le travail de Valérie Mréjen résonne dans ce terme – une certaine nostalgie, une attention à ce qui a précédé, le goût des histoires de famille et des histoires d’enfance… Mais sans doute pourrait-on supposer que le lieu commun est, lui aussi, une racine : sorte de composante originaire et commune du langage, qui existe avant que celui-ci se complique et ne se disperse en ramifications individuelles.
Quatre des vidéos présentées dans l’exposition sont de petites histoires en peu de mots, écrites par Valérie Mréjen, dites par des comédiens (tantôt filmés, tantôt invisibles, tandis que défile à l’écran un diaporama de cartes postales). Les mots sont simples, les phrases sont courtes, elles décrivent sans analyser. Les voix sont calmes, sans expression. Les histoires sont minimes : un homme prend des vacances avec sa femme dans un hôtel ; un homme et une femme assis côte à côte énumèrent leurs souvenirs ; une femme fait le récit de son séjour à La Baule… Mais rapidement, le spectateur pressent autre chose dans ces histoires simples, il devine que la simplicité et la banalité composent une surface trompeuse dans les replis de laquelle se logent des drames. Et c’est ici que Valérie Mréjen est un génie du lieu commun : dans ces phrases qui semblent ne rien dire, elle sait faire affleurer les non-dits. Ainsi dans Hors Saison, défilé de cartes postales d’hôtels et de restaurants accompagné en voix off par le récit quasi télégraphique d’un homme qui se félicite de voir sa femme plus heureuse que jamais. Il dit qu’elle rencontre d’autres estivants, sort, rit, rajeunit même. Lui, en petite forme, ne la suit pas dans ses escapades mais s’enthousiasme de la voir ainsi revenue à elle-même. Sans que rien d’autre ne soit dit, le spectateur s’émeut et reconnaît, dans les motifs de satisfaction du mari ceux de l’éloignement de la femme. Là où lui voit un retour, c’est un départ qui se trame. La reviviscence est une fin. Un même procédé est à l’œuvre dans La Baule, ciel d’orage. Mais, est-ce lié au choix des mots ou au grain de la voix de la narratrice ? La tension atteinte dans Hors Saison ne fonctionne pas ici : trop tôt, il est évident que le récit benoît que fait une femme qui attend qu’un conjoint la rejoigne à La Baule est voué à être déçu. L’homme ne viendra pas et elle finira seule ses vacances.
Quand Valérie Mréjen raconte des histoires d’adultes, ce sont toujours des histoires de défaites : les adultes font des reproches, les adultes se quittent, les adultes ne s’aiment plus, les adultes ont des regrets. Mais il y a aussi, dans Roots, des histoires d’enfants et d’adolescents. Au contraire des histoires d’adultes, elles-ci sont des histoires en train de se faire : enfants qui apprennent à maîtriser la langue (La Peau de l’ours) ou à raconter une histoire (Cadavres exquis et Princesses), adolescents qui apprennent à se raconter eux-mêmes en cherchant ou en refusant des modèles, en s’imaginant des futurs et des espoirs conformes ou turbulents (Voilà c’est tout).
Ici bien sûr, rien n’est écrit et ceux qui sont filmés ne sont plus des acteurs : tout est vrai. Dans ces expressions enfantines, l’émotion est causée par une parole balbutiante, qui ne maîtrise pas les sens convenus et ne s’est pas encore glissé dans leurs structures, une parole inventive, audacieuse, tourbillonnante – l’inverse exact des mots d’adultes, calmes et maîtrisés. Dans La Peau de l’ours, des enfants tentent d’expliquer le sens d’expressions imagées (“un froid de canard”, “serrés comme des sardines”, “vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué”, etc.) et leurs tentatives sont comme autant de tours de magie qui transforment des expressions trop connues en histoires imprévisibles et surnaturelles : avec des lieux communs, ils construisent des histoires merveilleuses quand les adultes, eux, ne savent que les détruire.
Nina Leger
Valérie Mréjen, Roots, jusqu’au 23 octobre 2016 à la Galerie Anne-Sarah Bénichou, 45 rue Chapon, 75003, Paris. Ouvert du mardi au samedi, 11h-13h / 14h-19h.
[print_link]







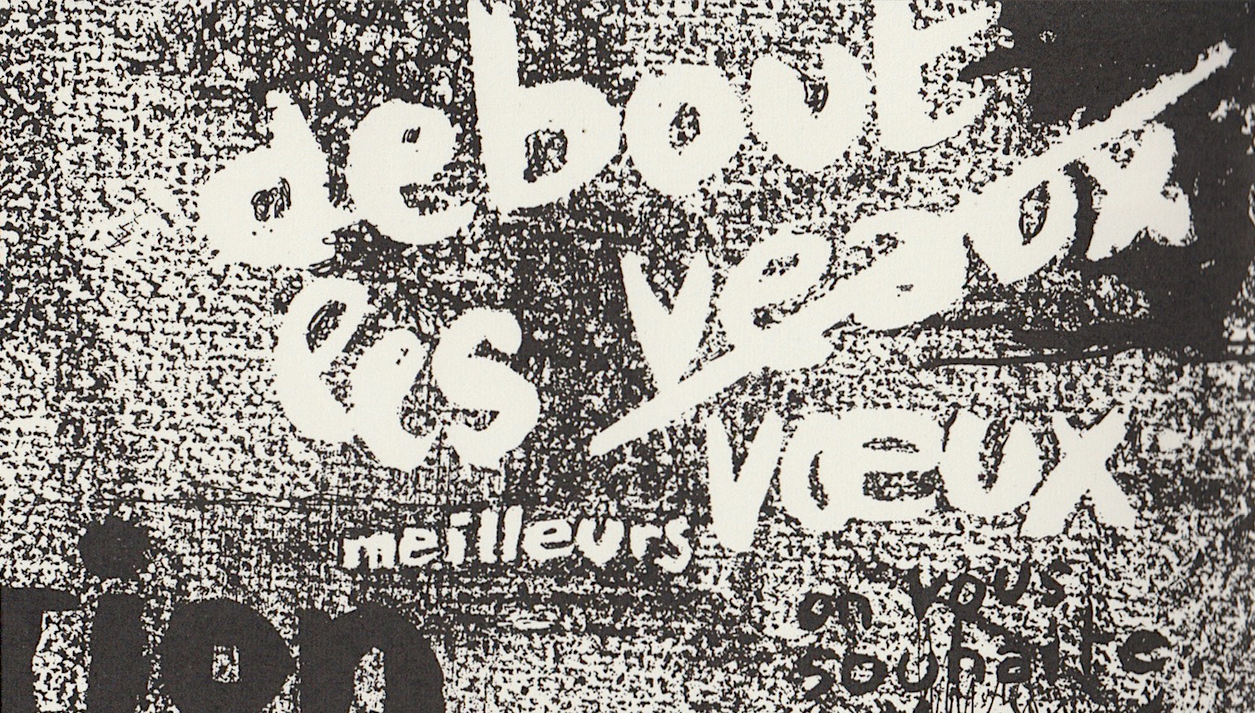
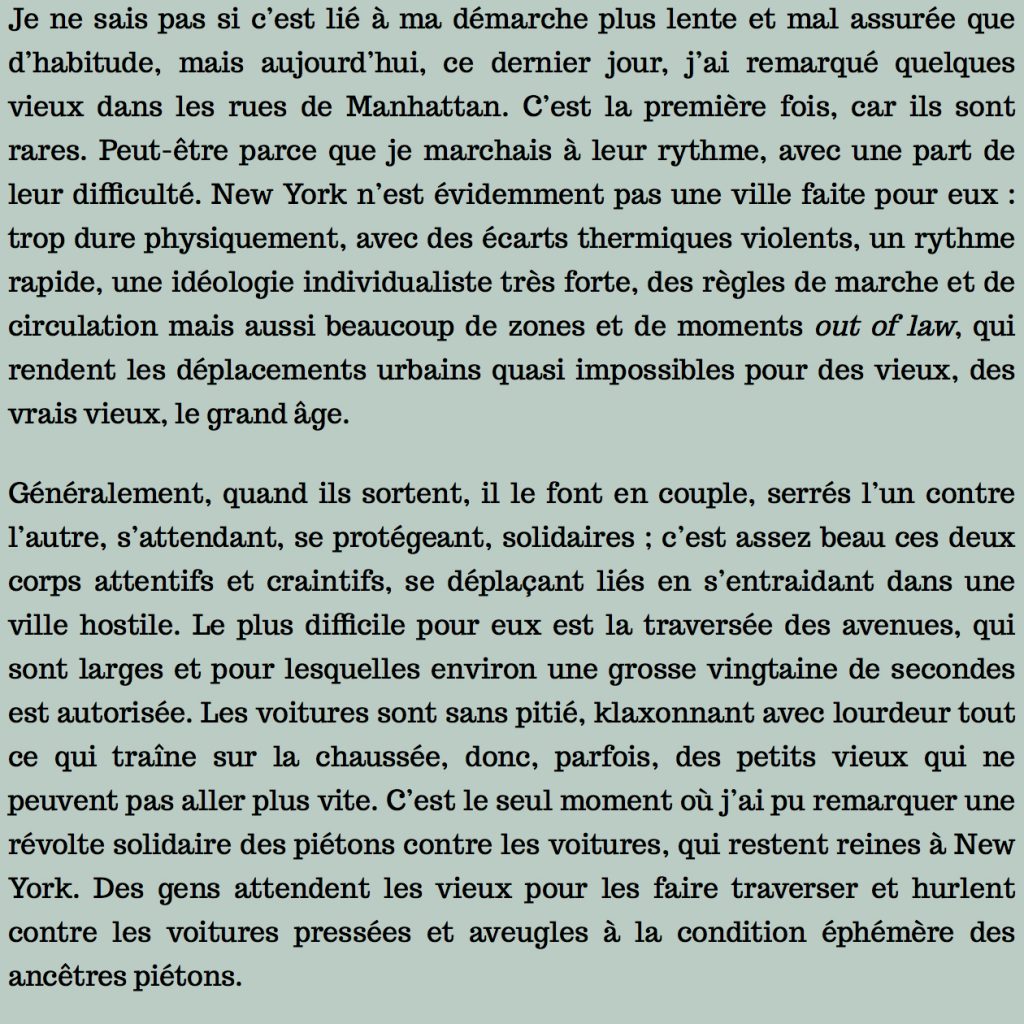


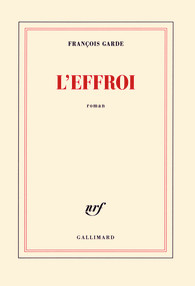
0 commentaires