Italie-Espagne, c’est un classique du football qui fleure bon l’olive, les souvenirs d’un passé au nom illustre, la fureur, la rage et la sueur. Toute une mystique de mains sur le cœur et de regards vers les cieux quand résonne l’hymne (italien, surtout) ; un classique qui, à l’Euro ou à la Coupe du Monde, se terminait traditionnellement par la victoire de l’Italie et les lamentations ibériques.
L’Espagne made in Barça avait rompu avec ce passé, le temps était venu des joueurs stars, les équilibristes du ballon rond, et du jeu du taureau sans fin. L’Italie avait perdu, et perdu encore, et les jeunes spectateurs en étaient venus à croire que mouiller le maillot, c’était bon pour les pauvres italiens, les besogneux ouvriers du football (des ouvriers millionnaires, néanmoins), les gens dépourvus d’imagination. Que le football était une liturgie presque mystique, une sorte d’opéra pour ténors espagnols.
Mais à force de se répéter, de se plaire, de s’enjoliver et de se persuader que le ballon roule toujours pour qui le traite le mieux, l’Espagne (et le football n’est pas loin de représenter une métaphore de ce que nous sommes devenus) s’est laissée ensorceler à son propre enchantement, comme ces génies qui se complaisent dans leur supériorité intellectuelle et esthétique, et méprisent la crue réalité du monde. L’Espagne s’est regardé jouer comme se regardaient les courtisans des palais baroques, tournant sur elle-même sans autre but que d’admirer son reflet dans les miroirs dorés à l’or fin, émerveillée par sa propre beauté, sans comprendre que danser seul n’a pas de sens.
La tautologie espagnole sera toujours cette redondance de l’inutile, ce tape-à-l’œil imprécis, cet amour de soi sans but ni raison.
Et tandis que l’Italie enseigne à l’Espagne les vertus de l’effort (rehaussé, cependant, d’un peu de tape-à-l’œil espagnol, mais en plus réaliste) et qu’elles valent toujours mieux que de s’en remettre aux dieux de l’Olympe, Messi, le grand Messi, manque le pénalty qui lui aurait offert la seule gloire qui manque à son palmarès : l’amour inconditionnel des Argentins.
Si seulement l’Espagne avait Messi, et Messi l’Espagne. Si seulement le soleil devenait la lune et la lune, le soleil. Mais la vie est comme elle est, et moi qui rêvais d’une demi-finale contre une France qui n’a jamais été moins France, je dois me consoler du stoïcisme méditerranéen que m’inspire l’île de Formentera, au milieu d’Italiens euphoriques qui préfèrent ne pas penser qu’à Bordeaux les attend l’Allemagne éternelle et têtue. On ne verra pas une réédition anticipée de la fameuse finale France-Espagne, avec la boulette d’Arconada et un Michel Platini sidéral qui n’était pas encore le bureaucrate du football qu’il est devenu, mais un de ces artistes que j’appelais de mes vœux. Cette finale eut lieu à Paris, et je l’ai vue entouré de Français qui ne doutèrent pas un seul instant de la victoire.
Aujourd’hui, l’équipe d’Espagne est en vacances, tandis que nous nous demandons s’il faudra une troisième élection législative, et que les plages de Formentera résonnent des célébrations italiennes.
Je ne me sens pas triste, que voulez-vous que je vous dise ? Il y a tout l’été pour oublier, et ces plages aux eaux turquoise, le soleil sur les oliviers, et les rires francs, bronzés, heureux, de mes camarades italiens. Le football est une métaphore de la vie mais la vie continue quand le football s’arrête.
Les Italiens méritent leur victoire, ne serait-ce que pour faire comprendre aux prétentieux que la tautologie est un vilain mot, que l’esthétisme n’a pas de sens lorsqu’il n’est qu’un exercice vain, évident, redondant et inutile.
Peut-être tirerons-nous les leçons de tout cela. Mais le plus probable est que demain, en lisant les gros titres des journaux sportifs, mes compatriotes vouent aux Gémonies ce qu’ils ont auparavant adoré, et que ces journaux servent finalement à envelopper les sandwichs pour le pique-nique à la plage.
J’espère que vous autres aurez plus de chance, que vous serez heureux quelques matchs de plus, et ensuite, ne vous en faites pas : nous nous reverrons au prochain Euro, et alors peut-être la Roja aura-t-elle trouvé son Messi, pour accompagner Iniesta.
Víctor del Árbol
Traduit par Sébastien Rutés
Víctor del Árbol a travaillé vingt ans pour la police catalane, jusqu’au succès de son deuxième roman, La tristesse du samouraï (Actes sud, 2011), traduit en douze langues et qui a reçu notamment le Prix du Polar européen. Toujours chez Actes sud, il a publié La maison des chagrins (2013) et Toutes les vagues de l’océan, Grand prix de littérature policière en 2015. En Espagne, son dernier roman lui a valu le prestigieux Prix Nadal (2016).
[print_link]




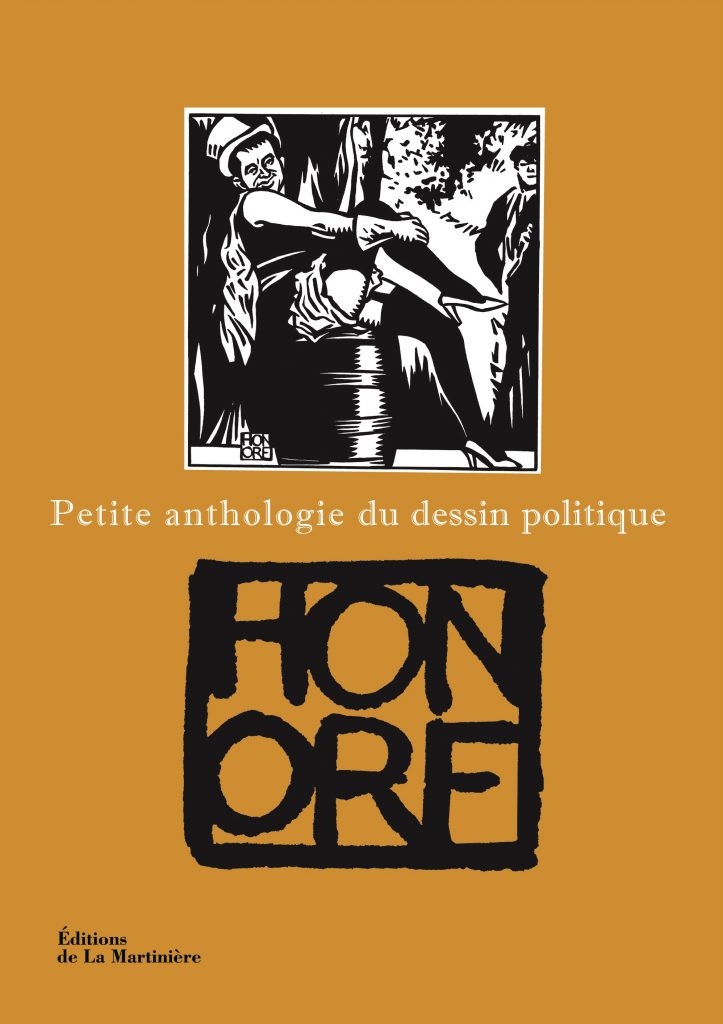



0 commentaires