“Diogène en banlieue” : heurs et malheurs d’un prof de philo aux confins du système scolaire.
L’anecdote remonte à une douzaine d’années. La salle où j’enseignais se trouvait à l’entresol d’un lycée construit sur une pente. On avait d’ailleurs installé dans cette partie de l’établissement la plupart des salles réservées aux classes techniques. L’endroit était sinistre et manquait cruellement de lumière. Personne, pas plus les élèves que les professeurs, n’aimait s’y attarder. Un jour, alors que mon cours était déjà bien avancé, je fus surpris par une odeur de brûlé, d’abord légère puis rapidement désagréable et forte. Soudain j’aperçus une fumée noire s’échapper par la porte de ma salle. J’ouvris sans réfléchir davantage. Dans le couloir, à deux pas de ma classe, les détritus d’une poubelle se consumaient lentement. Par chance le feu n’avait pas pris aussi vite que l’auraient souhaité ceux qui avait commis ce qui n’était encore qu’une mauvaise plaisanterie. Cinq minutes plus tard c’était un accident, au bout d’un quart d’heure nous aurions peut-être été en plein drame.
On ne voit jamais ou plutôt je n’ai jamais rencontré, en dehors des récréations, de surveillants parcourir les couloirs des lycées. Il m’est arrivé de devoir me rendre dans la classe d’un collègue au moment de son cours parce que j’avais une communication à faire à nos élèves. Chaque fois j’étais frappé par le calme bien sûr mais aussi par le vide de ces couloirs interminables que comportent certains bâtiments scolaires. Le manque de lumière souvent, le silence que vient seulement rompre la voix des professeurs qui perce à travers les maigres cloisons des salles de classe, tout rend ces couloirs pesants et un peu inquiétants. Une agression ou un racket pourrait s’y dérouler sans que personne ne le sache. Le cas a dû se produire. Si ces couloirs restent désespérément vides en dehors des moments où l’agitation des élèves les réanime comme par un coup de baguette magique – tout semblait endormi ou mort et c’est soudain la vie qui recommence avec son bruit et sa fureur –, si ces couloirs restent déserts la plupart du temps, la faute n’en incombe pas aux surveillants. Ils sont trop peu nombreux pour quadriller un établissement qui compte souvent trois étages, un millier d’élèves et des centaines de mètres de couloirs.

© Gilles Pétel
Je me rappelle un autre cas plus surprenant que le précédent. Le lycée où je travaillais était ouvert sur l’extérieur. Il n’existait ni mur d’enceinte ni grillage pour séparer la cour de récréation de la ville nouvelle où avait été construit cet établissement à une époque plus optimiste que la nôtre. Un matin, pendant que je fumais une cigarette dans la cour (ce geste était encore autorisé), je vis surgir un homme d’une quarantaine d’années à l’allure inquiétante. À mesure qu’il s’approchait du bâtiment, je distinguais plus nettement ses traits. Il était mal rasé, habillé en haillons, sa démarche était chaloupée comme s’il avait trop bu ou fumé des substances. Il tenait à la main un fusil à canon scié sans paraître étonné. Une dizaine d’élèves le suivaient avec circonspection tandis que d’autres s’étaient déjà précipités vers moi afin de me demander d’intervenir. J’envoyai aussitôt chercher de l’aide auprès d’un surveillant qui se destinait à une carrière sportive. Il serait sans nul doute plus efficace que moi si la situation s’envenimait. Puis je me dirigeai lentement vers l’homme au fusil qui paraissait absolument indifférent au monde. Par chance, il ne manifestait aucune sorte d’agressivité. Interrogé, il me répondit avec calme. Il cherchait Raoul ou quelqu’un d’autre. Je ne sais plus bien. Je fus assez vite rejoint par le surveillant que j’avais envoyé quérir et nous réussîmes tous deux à le persuader de quitter l’enceinte de l’établissement.
L’été suivant, le lycée faisait grillager la cour de récréation.
Gilles Pétel
Diogène en banlieue
[print_link]


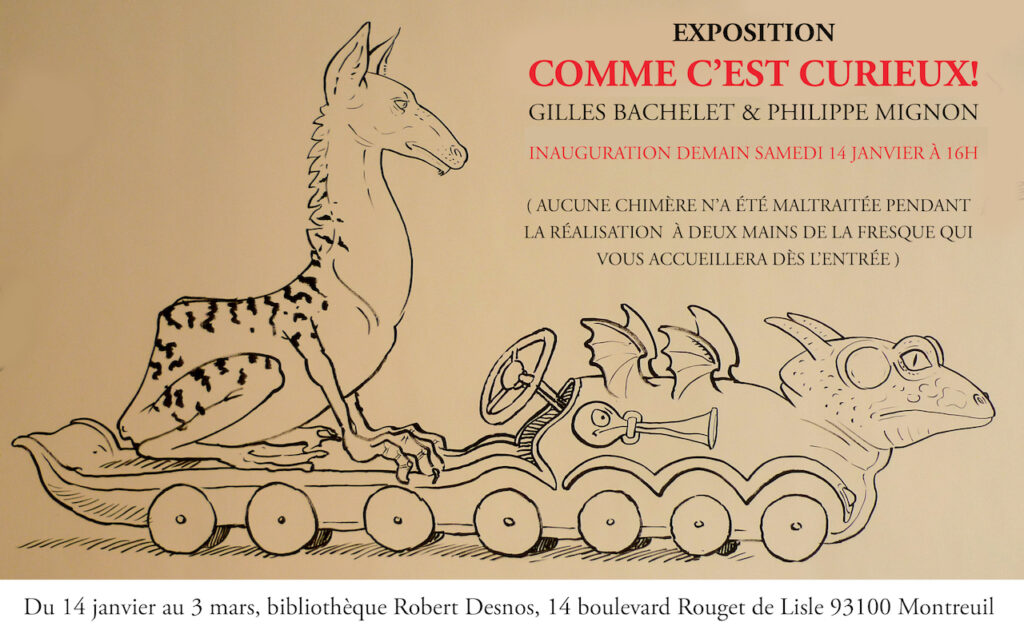
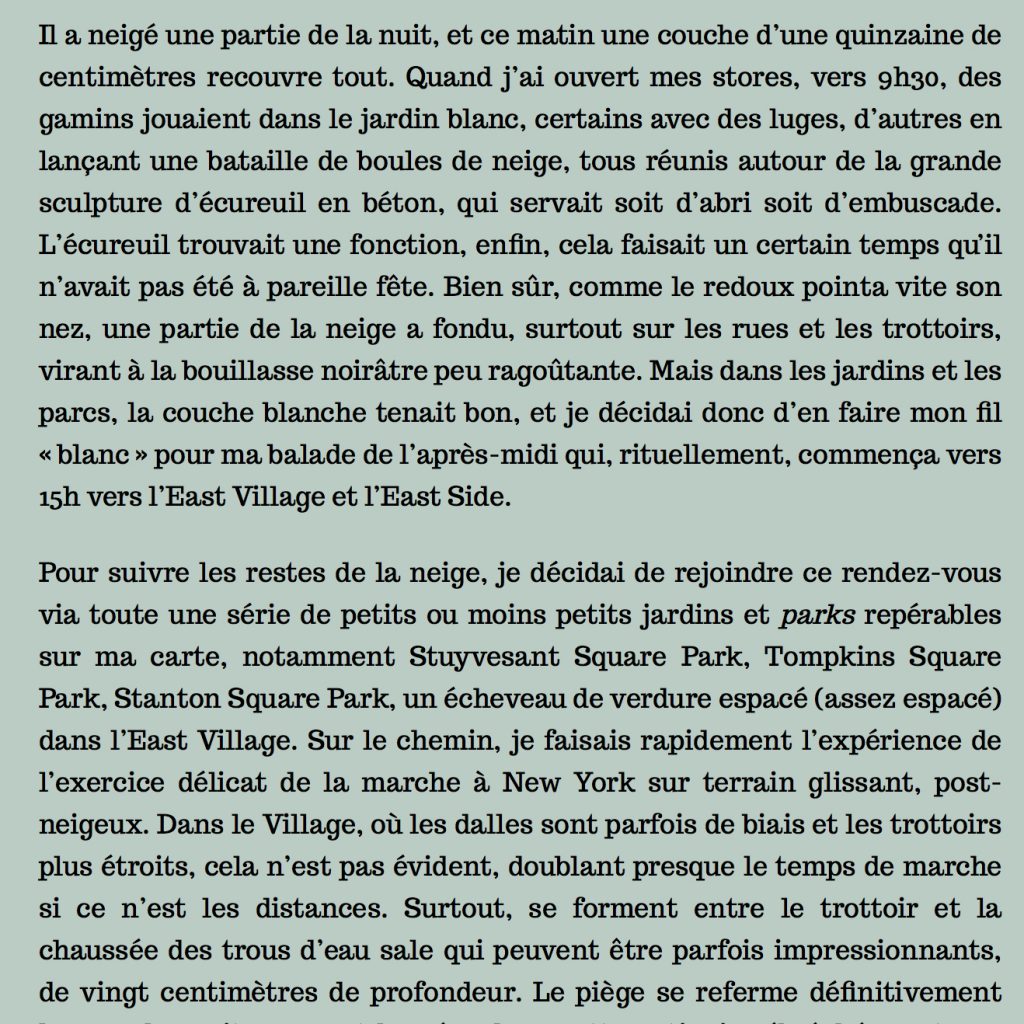

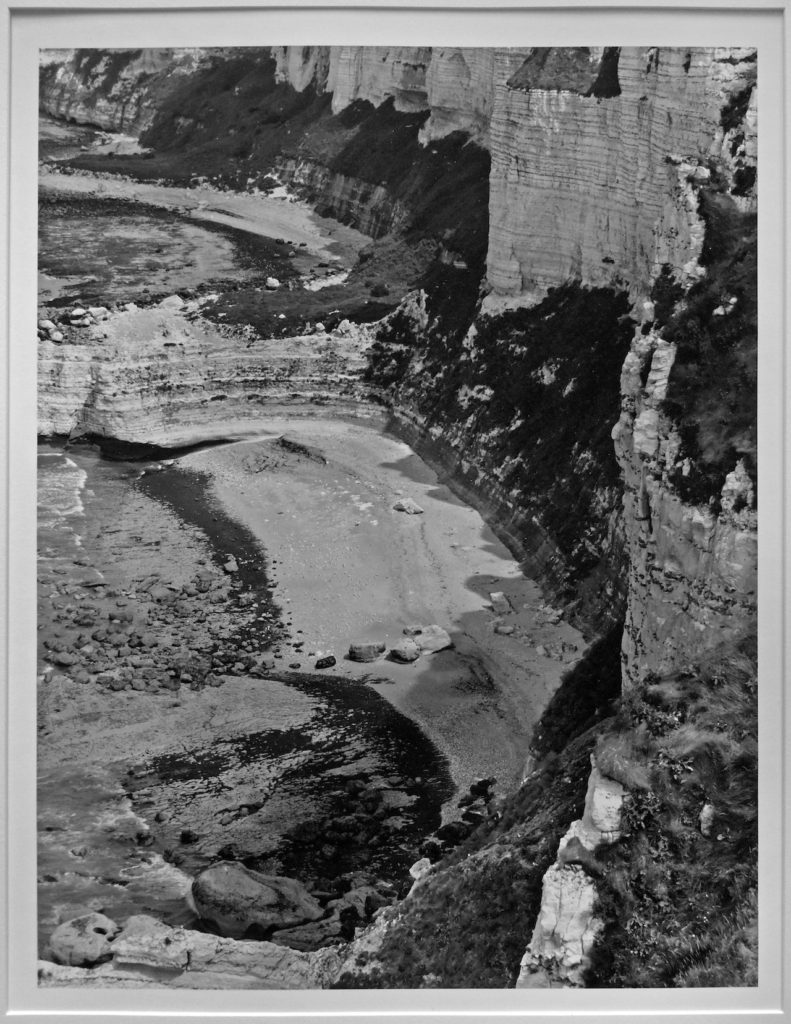


0 commentaires