Sur le personnage du traducteur
en spectre et en auteur
Le moins que l’on puisse dire, c’est que lorsqu’il porte des jugements sur la traduction et les traducteurs, Thomas Bernhard n’y va pas avec le dos de la cuiller. Il affirme par exemple, dans un entretien passé à la postérité: « Une traduction est un autre livre. Et celui-ci n’a plus rien à voir avec l’original. C’est un livre de celui qui l’a traduit. » [1]
On n’est bien entendu pas obligé de prendre systématiquement Bernhard au pied de la lettre. L’entretien dans lequel se trouve cette phrase porte du reste en titre une autre provocation du même genre, à savoir : « Les gens qui veulent faire un entretien me sont suspects ». La phrase pourrait alors passer pour une déclaration ronchonne dans le cadre d’une interview ronchonne, et mon introduction pourrait s’arrêter là.
Mais on peut aussi prendre Thomas Bernhard au sérieux, non pas comme polémiste, non pas même comme écrivain, mais aussi comme penseur, et en l’occurrence comme penseur de sa propre œuvre et de l’effet qu’elle a produit en Autriche, dans les pays de langue allemande et dans le monde. Si je suis bien informé, on peut aujourd’hui lire l’œuvre de Bernhard sous forme de traductions dans quarante-cinq langues différentes. Ses pièces de théâtre sont jouées partout et il a eu de gigantesques succès à l’étranger. On a peine à croire que Bernhard ait sérieusement pensé que ses œuvres menaient sous son nom une vie totalement indépendante et n’aient plus rien eu à voir avec l’original. Si l’on exclut la pure provocation, on est donc forcé de supposer que ces mots ont un autre sens que celui qu’ils semblent exprimer.
La question à laquelle Thomas Bernhard répond ici est assez simple : « Est-ce que vous vous intéressez au destin de vos livres ? » lui demande son interlocuteur, Werner Wögerbauer. « Oh, pas vraiment », répond Bernhard. « Aux traductions, par exemple ? » demande Wögerbauer. « Je m’intéresse à peine à mon propre destin, alors à celui des livres… non, pas du tout. Vous avez dit quoi ? Des traductions ? » – « Ce que deviennent vos livres à l’étranger. » Et c’est là qu’arrive la phrase : « Absolument pas, parce qu’une traduction est un autre livre. C’est un livre de celui qui l’a traduit. Parce que, moi, j’écris en langue allemande. » Et quelques lignes plus loin, il exprime ce jugement définitif : « En vérité, on ne peut pas traduire ». C’est avec ces mots, pour nous funestes, que débute le bref voyage que je veux faire aujourd’hui avec vous dans le monde de la traduction.
Bernhard n’est pas seul à penser que la traduction est une activité à part, détachée de celle de l’écrivain avec laquelle elle entretient ce fameux « rapport ancillaire » dont on a tant parlé. L’auteur et écrivain français Pierre Assouline a écrit voici quelques années, à l’occasion de son rapport sur l’état de la traduction en France, ces mots très simples : « Dans tout livre traduit, il n’y a pas un seul mot de l’auteur qui signe le livre. Tous les mots sont du traducteur. » [2] Assouline ne voulait cependant pas dire ainsi que la traduction est un art de la trahison, mais que le traducteur est un auteur (ce qui ne veut pas nécessairement dire : un écrivain), avec tous les droits et tous les devoirs que cela implique. Cela signifie-t-il que la traduction est un phénomène schizophrénique, où l’auteur de l’œuvre commence par disparaître pour faire place à un autre auteur qui, avec d’autres mots, dans un autre style, produit une mauvaise copie, ou du moins une copie infidèle de l’original – c’est-à-dire, pour reprendre les termes de Bernhard, un autre livre ?
C’est une question chargée de sens, et une lourde question, que l’on se pose depuis des temps immémoriaux, sans doute au moins depuis la traduction de la Bible, qui fut l’œuvre, on le sait, de soixante-dix traducteurs conjurés pour ou contre le livre d’origine. Beaucoup de choses ont changé depuis. Mais il a fallu beaucoup de temps. Au Moyen Âge, on trouvait couramment des traductions dont les auteurs se contentaient de restituer à peu près le sens global de l’original, en l’adaptant à leur pays et en réécrivant parfois des passages entièrement nouveaux. Suivit l’ère des « belles infidèles », qui n’était pas, elle non plus, pour infirmer la thèse de Thomas Bernhard : de grands et célèbres auteurs se traduisaient les uns les autres, Goethe traduisit le Neveu de Rameau de Diderot, mais aussi Ossian, Madame de Staël et Voltaire, Wieland traduisit Horace, Schelling la Baghdava Gita, et en langue latine par-dessus le marché ! En France, cette tradition qui faisait la part belle au style personnel de l’auteur-traducteur a duré très longtemps : François Victor-Hugo a traduit Shakespeare, Baudelaire Edgar Poe, André Gide Pouchkine, Shakespeare et Tagore, Gérard de Nerval a laissé une très belle mais très inexacte traduction de Faust, etc. Cette pratique, qui faisait de l’auteur l’interprète d’un autre, était courante, et suffisamment lacunaire pour qu’un Goethe écrive, par exemple, dans ses Maximes et Réflexions, « Les traducteurs sont comme des entremetteurs qui nous vantent les charmes d’une belle à moitié voilée : ils suscitent une irrésistible envie de voir l’original ».
Mais qu’ont les traducteurs du XXIe siècle en commun avec ceux du XIXe, ou même ceux de la première partie du XXe ? Si l’on fait abstraction de l’amour de la littérature, de la pensée et des œuvres ? Les grands auteurs ne traduisent plus. À partir de 1945, ils ont eu beaucoup trop à faire avec la politique et l’idéologie pour avoir aussi le temps et l’envie de traduire. Et l’on a vu se constituer peu à peu une nouvelle branche, celle des traducteurs professionnels qui considéraient leur travail comme une activité à part entière, un artisanat ou un artisanat d’art, et eux-mêmes comme des artisans du langage, des spécialistes, des techniciens dans un travail au terme duquel une œuvre originelle devait se transformer en œuvre miroir – non pas une image, mais une création littéraire qui devait restituer le fond, le style, le rythme, la totalité d’un texte, tout en transmettant à ses lecteurs les liens qui portent tout cela, ses « conditions », dirait Freud.
Cet entretien avec Werner Wögerbauer n’est pas l’unique passage où Thomas Bernhard parle de tradition. Il y a dans Weltverbesserer (Le Réformateur) deux pages qui évoquent de manière très critique, et même presque grossière, la traduction et les traducteurs. À les prendre au pied de la lettre, on pourrait même y voir une véritable injure au traducteur :
« Mon traité de la Réforme du monde / a été traduit en trente-huit langues / même en hébreu. Une traduction chinoise est en préparation. / Tous ces traducteurs m’ont toujours chaque fois / appelé au secours / mais je n’ai pu aller au secours d’aucun d’eux. […] Ils ont défiguré mon traité / totalement défiguré / Les traducteurs défigurent l’original […] C’est le dilettantisme / et la boue du traducteur / qui rendent une traduction si répugnante / Ce qui est traduit est toujours écœurant / Mais cela m’a rapporté une masse d’argent. » [3]
La condamnation semble totale et définitive. De la même manière que, dans la même pièce, la condamnation du tailleur, de l’odeur des roses, des fleurs en général, la condamnation du public qui « n’a pas mérité son exposé », des gens en général, qui lui « gâchent » tout, et même de l’auteur lui-même, présenté comme un être cupide. Une pose, donc, une simple attitude, ou juste une tirade qui permet à Bernhard de faire apparaître le cynisme de son personnage ? Oui, tout cela, probablement.
Mais pas uniquement cela. Il y a en effet dans ce passage deux lignes que je n’ai pas citées jusqu’ici et qui sont beaucoup plus intéressantes pour nous. Après la phrase « Mais je n’ai pu aller au secours d’aucun d’eux », il écrit : « Un traducteur ne peut pas être aidé / le traducteur doit suivre son chemin seul. » C’est l’unique phrase, sur cette page, à ne rien avoir à faire avec l’injure et la fureur. On a même l’impression que Thomas Bernhard veut exprimer ici une espèce de mélancolie. Est-ce la réalité ? Sans doute. Parce que la figure du traducteur qu’il décrit ici est aussi une figure de l’auteur. Dans un entretien de 1980, Thomas Bernhard tente de montrer qu’on ne peut pas non plus aider l’auteur. Quand le journaliste lui dit qu’il est « l’écrivain romantique qui voit un lien entre maladie et art, entre folie et art, entre anarchie et art » [4], il répond : « C’est, je crois, comme quand on rêve, vous ne pouvez pas empêcher non plus vos rêves de suivre leur chemin, si nécessaire on peut les réveiller, alors le pire se produit, mais vous n’avez pas de véritable influence là-dessus. » Que dit Bernhard ici ? Que le traducteur n’est pas le seul Ent-steller, celui qui défigure mais aussi, littéralement, celui qui ôte quelque chose à la place qui est la sienne pour la placer ailleurs, qu’une œuvre littéraire mène de toute façon son existence dans la solitude et l’indépendance – pas seulement quand elle est lue et traduite, mais dès l’instant où elle est écrite – que l’œuvre se défigure et se dé-place d’elle-même, en quelque sorte.
L’image que ces deux lignes brossent du traducteur devient ainsi celle d’un écrivain de l’ombre que l’on ne peut pas aider, qui doit « suivre son chemin seul » pour écrire un autre livre. Mais qu’est-ce que cela signifie, et qu’est-ce que cela a à voir avec l’état des « règles de l’art » dans notre profession ?
La traduction a fait d’immenses progrès depuis trois ou quatre décennies. Elle a appris à être ni un calque insipide, ni une trahison éhontée, ni une invention sortie du néant, mais une nouvelle œuvre qui sort de l’esprit de l’auteur et du travail du traducteur. Parfois – et chacun d’entre nous l’a vécu au moins une fois – parfois l’union est si puissante que l’on sent, concrètement, le souffle de l’auteur derrière soi, que l’on sait qu’il est avec nous et travaille.
C’est vrai, on ne peut pas aider le traducteur. C’est vrai, il suit ses propres chemins. Mais une fois qu’il les a parcourus, il arrive que survienne un miracle : l’auteur, qui avait perdu son livre depuis longtemps, le retrouve tout d’un coup, tout neuf. C’est un nouveau livre, et c’est pourtant son livre. Il lui est revenu.
La tâche moderne du traducteur, au moins pour ce qui concerne les œuvres de fiction, serait donc de pratiquer une Ent-stellung, une défiguration qui serait un « dé-placement » positif, pour parodier Heidegger. Le traducteur, dans ce cas, ne serait plus un spectre, mais une sorte de magicien qui invoque l’esprit de l’auteur dans une autre langue. La traduction serait ainsi une sorte de se-placer-au-dessus-de-l’auteur qui permettrait au texte de vivre dans une autre langue sans être entravé par le corps, l’esprit ou le spectre de l’auteur. Elle deviendrait un déplacement vers le lointain visant à replacer l’œuvre ailleurs, sous une autre forme, dans un autre monde. Et le traducteur serait le trans-placeur d’un texte qui était jusqu’alors surveillé et protégé par son auteur, à une autre autorité, celle du lecteur dans une autre langue ou même de la pensée dans cette langue. Pour y parvenir, il faut effectivement faire perdre sa figure au texte pour lui en donner une autre. C’est exactement ce que veut dire Bernhard quand il dit : « Parce que moi, j’écris en langue allemande ». Dès qu’il sort de cette langue, le texte devient immédiatement autre chose, et l’œuvre une autre œuvre, qui a désormais deux sources d’autorité (quoique d’autorité inégale), l’auteur.e et son traducteur ou sa traductrice. On n’a pas de mal à comprendre que cette perspective n’ait pas précisément enthousiasmé Thomas Bernhard, qui avait déjà suffisamment de mal à composer avec lui-même, dans tous les sens du terme.
Ce dé-placement, cette distance que crée la traduction entre l’œuvre et son auteur, est partie intégrante de la tâche moderne du traducteur, celle de faire revivre ailleurs l’esprit de l’auteur. Dans ce cas, l’auteur et le traducteur sont effectivement deux créateurs de deux œuvres différentes, la seconde puisant toutefois son inspiration essentielle dans la première. Et cela, on le sait déjà fort bien : si tel n’était pas le cas, il n’existerait de chaque livre qu’une seule traduction qui conserverait sa validité pour tous les temps. Ce n’est bien évidemment pas le cas. Parce que la traduction n’est jamais une « reproduction technique », parce qu’elle est la subtile traversée d’une œuvre entre un esprit et un autre, le texte faisant ici office de navire, parce que tout ce que contient ce navire n’est pas seulement écrit, mais aussi esquissé, chuchoté, évoqué, ou pas écrit du tout et pourtant présent. Ce voyage-là peut aussi être le moment où une altérité radicale et créative entre les langues, entre l’auteur et son traducteur, entre l’œuvre et sa traduction, peut faire naître une œuvre nouvelle.
La traduction est encore loin d’avoir atteint le bout de son chemin. Il reste encore beaucoup de travail pour comprendre réellement comment fonctionne notre artisanat, si l’on devait le comprendre un jour. Notre mission demeure de porter l’œuvre de l’auteur avec autant de fidélité, mais aussi d’imagination et d’inventivité que possible, dans un autre monde, dans une autre langue. « Enfin, voyons, on ne peut pas traduire », dit Thomas Bernhard. Mais si, on peut. On doit, même. Mais quand Bernhard dit qu’on ne peut pas aller au secours des traducteurs, il a raison : au bout du compte, le traducteur est toujours seul. Seul face au « cadavre » qu’est le texte qu’il doit faire revivre ailleurs. Seul, sans aide. Mais il y parvient, parfois, souvent.
Comme il a été et sera beaucoup question ici de cadavres, d’esprits et de spectres, je citerais volontiers, pour finir, une admirable phrase de Paul Auster : « Translators are the shadow heroes of Literature. » Aujourd’hui, à Vienne, les ombres vont parler de Thomas Bernhard, le rappeler à la vie, et nous pouvons tous nous en réjouir. Alors je vous en prie, chers esprits : « Plus de lumière ! »
Olivier Mannoni
Le coin des traîtres






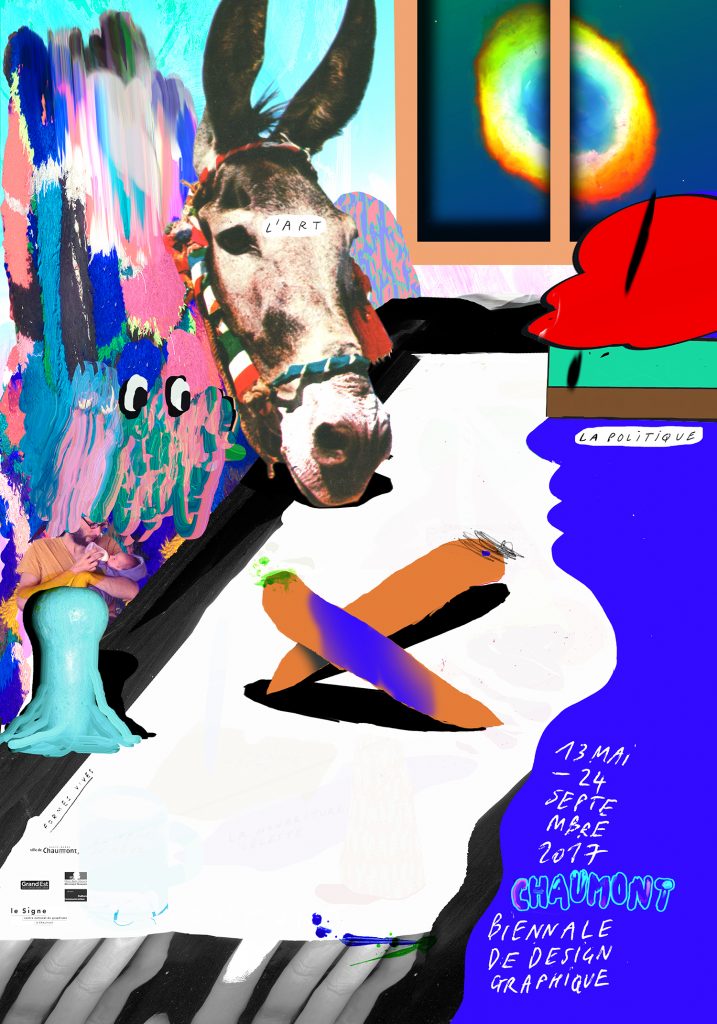



0 commentaires