Le coin des traîtres : pièges, surprises, vertiges, plaisirs et mystères de la traduction… Cette semaine, la parole est à Laurence Sendrowicz, ou plutôt à Fanny Barkowicz qui, comme à son habitude, est en train de traduire un roman. Quand soudain, un coup de fil de son éditeur vient tout bouleverser…
Tout est à cause du téléphone et de cet appel que j’ai reçu le 3 mars 2008, « bonjour, Stéphane Drouet à l’appareil. Je tenais à vous dire personnellement combien j’étais content ! »
Les mauvaises nouvelles arrivent toujours par téléphone, il était content, mon éditeur, content, enthousiaste et soulagé, il a terminé la conversation par un « c’est plus que parfait » survolté, suivi de trois petits couinements rieurs, « hi-hi-hi ! ».
Je suis restée le regard vague, avec, dans la main, le combiné qui avait retrouvé sa tonalité apaisée et continue. Un reflux de sang a fait gonfler mes pieds, est remonté dans mes mollets, mes genoux, mes cuisses, j’ai été prise de vertige, obligée de m’asseoir, sauf que je me suis rendu compte que j’étais déjà assise. Les paroles de Stéphane Drouet continuaient à résonner, une vrille qui me trouait les tympans, je suis content content content, je tenais à vous le dire, Fanny, chère Fanny. Content ? Mais comment pouvez-vous être content ?
Était-il possible qu’il n’ait rien vu ? Rien compris ?
Mais monsieur, dans le texte que je vous ai envoyé, il n’y a pas un mot du roman dont vous m’avez confié la traduction… et vous me dites que vous êtes content ? Vous me dites : c’est plus que parfait ?
Si j’avais pu bouger, je me serais cachée sous la table, mais la pièce, avec mon bureau, mon lit derrière, la bibliothèque au-dessus de ma tête, tout tanguait. Comme si ce n’était qu’à cet instant que je comprenais. Qu’est-ce que j’ai fait ?
Je comprenais ? Non, non, je ne comprenais plus rien. Propulsée tout en haut d’un pic glacé, je me suis mise à serrer très fort les paupières, surtout ne pas regarder en bas !
À l’évidence, c’était à cause des montagnes.
Au bout de quelques minutes ou de quelques heures, quand les objets ont enfin retrouvé leur place, la réalité m’a sauté à la gorge : on allait me traîner en justice et m’accuser d’abus de confiance. J’allais être montrée du doigt, mise au pilori, outrecuidance aggravée et tromperie avérée, moi qui n’ai jamais menti sauf par compassion, je le jure ! J’ai senti la honte dégouliner de mon cuir chevelu et emplir ma bouche d’un goût de ferraille. Avec une infinie précaution, j’ai reposé le téléphone sur sa base. Et tout de suite après, je l’ai arraché pour rappeler l’éditeur. Il était encore temps, oui, j’aurais pu à ce moment-là lui dire, écoutez, c’est… Je ne l’ai pas rappelé. Je ne sais pas pourquoi. J’aurais dû mais une vague d’amour m’a submergée, oui, pendant quelques minutes je l’ai aimé, Stéphane Drouet que je n’avais jamais vu, je l’ai aimé plus que n’importe qui d’autre au monde. J’ai aimé sa voix, son ton guindé qui m’évoquait des ongles bien faits, son petit rire aigu et sa secrétaire, pardon, sa collaboratrice, celle qui s’est toujours adressée à moi avec gentillesse, celle qui, six mois auparavant, m’avait proposé d’un ton enjoué la traduction du nouveau roman de Daniel G. : En passant par la Montagne. La chose en elle-même n’avait presque rien d’extraordinaire, ça faisait dix ans que je traduisais les romans policiers de Daniel G. et ça marchait très bien.
En passant par la montagne, les dieux se sont-ils penchés sur mon sort et ont-ils enfin décidé de me donner un petit coup de pouce ?
Nous étions en septembre et la nouvelle avait secoué la rentrée littéraire : Daniel G. abandonnait le roman policier pour le roman tout court, il prenait un nouveau départ et un nouvel éditeur. Moi, ce qui m’a secouée, c’est qu’il me gardait. Une telle fidélité m’a fait chaud au cœur.
Oui, tout ça, c’est à cause des montagnes.
Quelques jours après avoir signé le contrat, on m’a envoyé le manuscrit, je l’ai avalé d’une traite, je me souviens très bien de cette fin de matinée, douce, avec un de ces ciels limpides que l’automne offre parfois à Paris, j’ai reposé la dernière feuille, je me suis levée du canapé, j’ai ouvert la fenêtre, j’ai entendu les cloches sonner midi à l’église de la rue voisine, à part moi, personne en France n’avait lu ce texte, l’idée étant d’organiser une sortie simultanée en version originale et en traduction. Un joli coup de com’.
Ça n’existe pas ? Non, non, jamais un éditeur n’achèterait un texte qu’il n’a pas lu ou fait lire à des gens de confiance… Non, ça n’existe pas. Enfin, pas vraiment. Enfin, ça dépend. Dans certaines circonstances, tout va tellement vite et lire prend tellement de temps, surtout dans une langue étrangère, alors… non, non, ça n’existe pas. J’avais entre les mains un inédit de 350 feuillets couverts d’une écriture bizarre, des lignes et des lignes de petits caractères tordus qui ne se donnent pas facilement et j’avais signé une clause de confidentialité.
J’ai levé la tête, pas un nuage. Comme mon avenir. Je sortais de quatre jours à lire, ne me restait plus qu’à retrousser les manches, comme d’habitude, écraser les mots de Daniel G. sous les miens, comme d’habitude, aiguiser, préciser, faire dans la dentelle mais surtout ne pas broder, ça bouillait et ça s’embrouillait sous mon crâne, et moi dans tout ça, un feuillet après l’autre, une couche après l’autre, où irais-je chercher le souffle cette fois encore, attention Fanny, là-haut sur les montagnes, l’oxygène se fait rare, traduire, c’est respirer avec, est-ce que c’est pour ça que tout à coup, j’ai eu l’impression d’étouffer ?
Et voilà que six mois plus tard, Stéphane Drouet en personne m’appelait pour me dire à quel point il était content. J’aurais pu le rappeler tout de suite. J’aurais dû le rappeler tout de suite et avouer… mais au moment où j’allais composer son numéro, il y a eu un craquement au-dessus de ma tête, quelque part au milieu des étagères qui occupent le mur jusqu’au plafond, oui, je sais, elles sont trop lourdes ces étagères, un jour, elles vont s’écrouler, il faudrait que j’apprenne à jeter… Ah, jeter ! Ce petit geste miraculeux qui fait qu’une chose est là et tout à coup, elle n’y est plus. Allez, vas-y, jette, Fanny, jette tous ces dossiers que tu ne reliras pas, tes vieux agendas, tes romans dont personne n’a voulu, les paires de lunettes qui ne te permettront plus de voir clairement, les chaussures éculées, les boîtes à chaussures ! Un jour je ferai le tri, promis, à droite, à gauche, à droite, n’aie pas peur, à gauche, il ne t’arrivera rien, courage, chez moi, ça commence toujours comme ça, j’attrape par exemple une jupe noire qui traîne dans mon armoire depuis dix ans, une petite jupe noire moulante… poubelle ! Une jolie petite jupe noire moulante… poubelle… à moins que… oui, il me semble que j’ai un rendez-vous important la semaine prochaine et elle sera parfaite. Poubelle ! Tu ne vois pas qu’elle n’est plus du tout ton genre, plus du tout à la mode et de quel rendez-vous parles-tu ? Et si je surprenais Manu en la mettant ce soir, rien que pour lui, avec des hauts talons ? Je l’accueillerai tout sourire et je lui ferai oublier sa fatigue et notre routine trop confortable, viens Manu, viens, asseyons-nous, prenons le temps en jupe moulante, ne me raconte surtout pas ta journée passée dans la poussière à casser des murs et à sceller des éviers, fais-moi danser, on oubliera tout, promis, je serai douce et légère. Un jour, j’y arriverai.
Le craquement dans mes étagères. J’ai levé les yeux vers les rayonnages ou plutôt vers un épais manuscrit qui faisait tellement d’efforts pour se planquer que je n’ai vu que lui. J’avais toujours le combiné à la main, je l’ai reposé. Évidemment. Qu’est-ce que je croyais ? Je le savais pourtant, que tout avait commencé bien avant cet appel de Drouet. Le 13 mai 2005 exactement… à moins que ça ne soit par une journée de juillet 1942 dont je ne saurai jamais la date précise, une petite rue de Bruxelles, quatre personnes avancent sur un trottoir aux pavés hostiles, il y a deux adultes et deux enfants, les adultes ont 36 ans, ils n’en auront jamais 37 mais ne le savent pas encore, les enfants, ce sont deux garçons, l’un s’appelle Léo, il a neuf ans, et l’autre, le petit bouclé, c’est Maxime, pas encore sept ans.
Le 13 mai 2005, j’ai décidé, enfin, d’interroger le petit garçon de neuf ans. Il avait un peu grandi, bien grossi, il était devenu mon père et moi j’avais perdu combien de temps ? Stop, stop, stop !
Inutile de remonter aussi loin.
Toujours la même ritournelle.
D’accord.
Enfin, tout de même, ça m’a pris des mois et des larmes et j’ai finalement réussi à écrire un texte que j’ai intitulé Les Passe-montagnes de mon père et que j’ai envoyé à des tas de maisons d’éditions.
En fait, je pourrais aussi commencer cette histoire il y a dix ans, le jour de ma première rencontre avec Daniel G.. Oui, ça au moins c’est positif et puis c’est normal de commencer par là, parce que Daniel G. a changé ma vie.
Avant, j’étais une mouche. Il m’a transformée en fourmi.
Pardon, voilà encore qui n’est pas exact, or tout bon traducteur littéraire, c’est bien connu, se doit de veiller en priorité à deux choses : la rigueur et la précision. Je dirai donc que de ma rencontre avec Daniel G. est née une nouvelle espèce : la fourmi-mouche. La fourmi traduit, elle progresse le long d’une ligne donnée, un mot, une virgule, une virgule, un mot, sans écarts ni sautillements, la mouche écrit – à cause des pattes de mouche qui noircissent les feuilles – et la fourmi-mouche, elle fait les deux. Elle essaie d’avancer entre l’utile et le vital, et pas toujours selon une répartition évidente. Je pourrais aussi ajouter qu’il arrive à la fourmi-mouche de déplorer sa lenteur d’escargot, de se rêver aussi souple que le serpent, de vouloir jouer les hirondelles ou de creuser des tunnels pour fuir comme un lapin, mais sa plus grande caractéristique, c’est… Peu importe. […]
Laurence Sendrowicz
Le coin des traîtres
Faute d’impression, de Laurence Sendrowicz, est publié aux éditions Caractères, coll. Théâtre.
 Laurence Sendrowicz est traductrice de théâtre et de littérature hébraïque contemporaine. Elle est l’une des initiatrices du projet de traduction de l’œuvre de Hanokh Levin en français. Pour le théâtre, elle a également traduit David Grossman, Anat Gov, Gadi Inbar, Mickaël Gourevitch, Tamir Greenberg. Pour l’édition, elle est, entre autres, la traductrice des romanciers Yshaï Sarid, Dror Mishani, Alona Kimhi, Batya Gour, Zeruya Shalev, Yoram Kaniuk. En 2012, elle obtient le Grand prix de traduction de la Société des Gens de Lettres, couronnant l’ensemble de son œuvre de traductrice. Fondatrice de la Compagnie Bessa, elle est également comédienne et metteuse en scène ; elle a écrit plusieurs pièces, dont Faute d’Impression, un texte qu’elle interprète seule en scène en 2014, au théâtre de la Manufacture des Abbesses, dans une mise en scène de Nafi Salah.
Laurence Sendrowicz est traductrice de théâtre et de littérature hébraïque contemporaine. Elle est l’une des initiatrices du projet de traduction de l’œuvre de Hanokh Levin en français. Pour le théâtre, elle a également traduit David Grossman, Anat Gov, Gadi Inbar, Mickaël Gourevitch, Tamir Greenberg. Pour l’édition, elle est, entre autres, la traductrice des romanciers Yshaï Sarid, Dror Mishani, Alona Kimhi, Batya Gour, Zeruya Shalev, Yoram Kaniuk. En 2012, elle obtient le Grand prix de traduction de la Société des Gens de Lettres, couronnant l’ensemble de son œuvre de traductrice. Fondatrice de la Compagnie Bessa, elle est également comédienne et metteuse en scène ; elle a écrit plusieurs pièces, dont Faute d’Impression, un texte qu’elle interprète seule en scène en 2014, au théâtre de la Manufacture des Abbesses, dans une mise en scène de Nafi Salah.

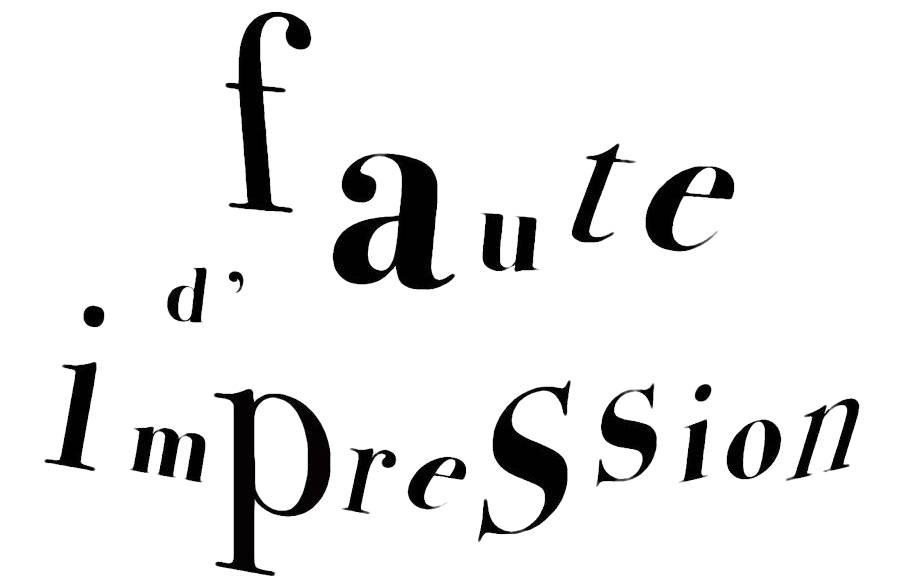
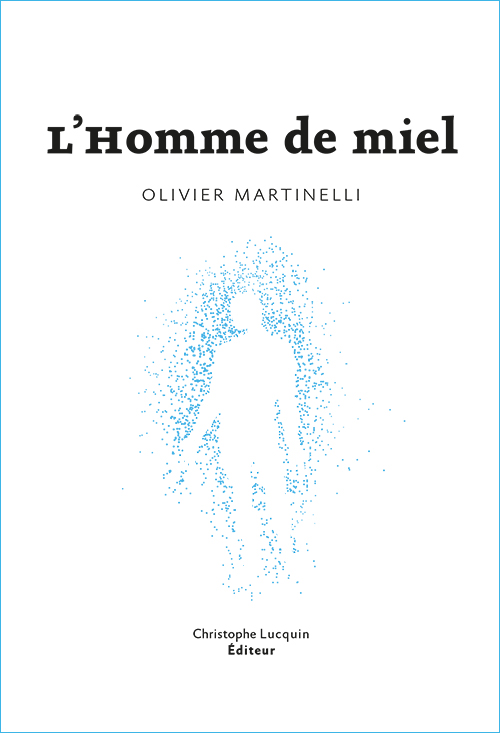

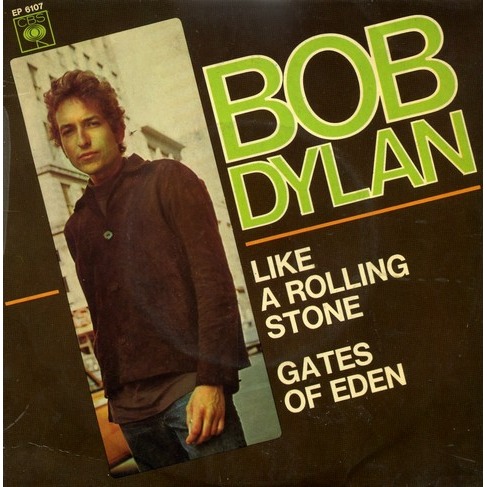





0 commentaires