Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
Vacance fait partie de ces mots curieux qui changent de signification au pluriel. Du latin vacare, être vide, vacance au singulier désigne l’état d’une charge ou d’un poste sans titulaire ou encore l’état du pouvoir dans « une période où les organes institutionnels du pouvoir politique ne sont pas en état de fonctionner » (Le Robert). Au pluriel, le mot laisse en apparence entendre tout autre chose. Les vacances sont en effet d’ordinaire associées aux congés payés. Elles sont synonymes de repos et de liberté retrouvée.
La différence de sens est-elle pourtant aussi sensible ? Partir en vacances, n’est-ce pas abandonner, momentanément, son poste pour le laisser vacant ? N’est-ce pas se décharger de tout emploi ? N’est-ce pas enfin accepter la légèreté de son existence ?
Les vacances, donc, pour partir du sens le plus courant du mot, sont un moment de repos bien mérité. Après avoir trimé durant onze mois, l’ouvrier, l’employé ou le cadre s’accordent trois ou quatre semaines de farniente. Les vacances désignent d’abord le temps de la détente, du laisser-aller, du laisser-faire parfois. Elles s’opposent semble-t-il en tous points au monde du travail, c’est-à-dire au monde de la contrainte et de la surveillance. Car le travail est essentiellement un instrument de contrôle social comme le rappelle Nietzsche dans « les apologistes du travail » (Aurore, livre III, §173) :
« Au fond, on sent aujourd’hui, à la vue du travail – on vise toujours sous ce nom le dur labeur du matin au soir –, qu’un tel travail constitue la meilleure des polices, qu’il tient chacun en bride et s’entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l’indépendance. »
La peur que notre société éprouve à l’égard du chômeur, du migrant, du sans domicile fixe, du vagabond et du romanichel vient sans doute de ce que ces catégories échappent, au moins en partie, au contrôle de l’État. La grande question qui revient sans cesse à propos des chômeurs est de savoir ce qu’ils font tout au long de la journée. À quoi s’ajoute la question de savoir où ils vont. Se promènent-ils ? Le célèbre film de Jean Renoir Boudu sauvé des eaux (1932), avec l’extraordinaire Michel Simon dans le rôle-titre, illustre cette peur mêlée de fascination du bourgeois à l’égard du clochard. D’où vient Boudu ? Où va-t-il ? Nous ne le saurons jamais. À la fin du film, lors d’une promenade en barque, Boudu disparaît ne laissant derrière lui qu’un chapeau haut-de-forme flotter au gré du courant. Mort ? Socialement sans doute, mais vivant certainement.
Les vacances devraient donc nous délivrer au moins une fois l’an des chaînes du travail. Elles devraient être un temps de liberté et de désordre. Éloigné des centres de contrôle (usine, entreprise, atelier, administration), l’homme devrait pouvoir souffler un peu et faire ce qui lui plaît, aller où ça lui chante, avec qui il l’entend ou bien seul s’il le préfère. Un rapide coup d’œil sur l’organisation des congés payés montre que nous sommes loin d’une pareille liberté.
Nos vacances sont en effet très surveillées pour des raisons qui sont à la fois d’ordre économique et social. Du point de vue du marché, il serait désastreux de laisser tant de gens s’ébrouer à leur guise sans qu’ils songent à acheter, dépenser, consommer. Les vacances sont devenues une nouvelle forme d’industrie qui est celle du tourisme. Socialement, il serait cette fois-ci dangereux de permettre à des millions de personnes d’errer sans surveillance, « sans toit ni loi » pour reprendre le très beau titre du film d’Agnès Varda. Les autoroutes que nous empruntons au moment des grandes transhumances de l’été apparaissent comme le symbole de ces vacances dirigées que nous nous imposons à nous-mêmes. Le péage est une forme de pointage, les radars un contrôle infaillible, les grillages qui ceinturent la chaussée dessinent les contours d’une prison à ciel ouvert. Notre moderne TGV, conçu pour nous faire gagner du temps, c’est-à-dire pour nous permettre de rentabiliser au mieux nos congés, nos trains à grande vitesse ne font que renforcer la surveillance de l’État puisqu’il n’est plus possible désormais de monter dans un train sans s’identifier. Les billets sont nominatifs.
Le fait que chacun participe volontiers à cet embrigadement laisse pantois. Sommes-nous devenus si dociles que l’idée d’emprunter des chemins de traverse ne nous traverse plus l’esprit, même en songe ? Peut-être sommes-nous si fatigués, si abrutis à la tâche que nous n’aspirons plus qu’à nous reposer en suivant les rails ? Ou faut-il, à la façon de Pascal, voir dans l’organisation de nos congés payés l’expression de la peur qui terrasse l’individu lorsqu’il est confronté au vide de son existence ? On amuse le touriste par un flot continu d’animations afin de lui éviter de penser.
Mais penser à quoi ? C’est la question qu’il faut bien poser à un moment. Désœuvré, l’homme est tenté de penser à lui. Il cherche à savoir qui il est, d’où il vient, où il va : quelle est, en un mot, son identité. Faute de réponse certaine et évidente, l’homme s’inquiète : n’est-il donc rien d’assignable ? Les vacances qui sont censées être l’occasion de se reprendre, de revenir vers soi, se transformeraient en cauchemar s’il n’y avait tous ces moyens, ces artifices déployés par l’État et quelques grandes compagnies, pour nous distraire et nous éloigner de nous-même.
Il existe pourtant d’autres pensées que celle qui voudrait nous ramener à nous selon une mode sans doute impérissable comme en témoigne le nombre sidérant de livres et de magazines consacrés à la question du moi.
Je vois dans cette manie du moi une des raisons qui expliquent la transformation de notre temps libre en contrainte touristique. La recherche constante, inquiète et toujours insatisfaite de notre identité nous conduit à nous raccrocher à toutes les planches de salut qui s’offrent à nous ou plutôt qu’on nous sert sur un plateau d’argent. Faut-il rappeler que les célèbres fragments de Pascal sur le divertissement et sur la misère de l’homme sans Dieu s’inscrivent dans un projet d’apologie du christianisme ? De façon comique, il est possible de comparer la religion et les vacances organisées (« tour opérateur », club de loisirs, « resort » etc.) : dans les deux cas, on prend l’homme par la main. La progression effrayante des mouvements identitaires dans ces dernières années est contemporaine d’un retour du religieux en même temps que d’une remise en cause de nos libertés.
Mais alors que faire ? Il me semble que si l’on cessait de faire croire aux gens que leur plus noble activité est de chercher à se connaître, ils arrêteraient de marcher droit dans leurs bottes. La grande illusion qui consiste à croire en un moi stable et bien défini a été la source de tous les fanatismes. Le désir d’être soi se transforme rapidement en volonté d’imposer aux autres ce moi que je ne trouve précisément jamais chez moi ! En voyant tout le monde aller du même pas, je réussis à me persuader que je suis bien ce que je cherche à être. Il est toujours rassurant d’observer ses contemporains prendre les mêmes trains, les mêmes avions, emprunter les mêmes itinéraires que les siens, fréquenter les mêmes temples, adhérer au même parti.
Pour en revenir aux vacances, et somme toute à notre liberté, il n’est pas si difficile d’envisager d’autres façons d’en user. Admis que nous ne sommes pas grand-chose, que nous n’allons fondamentalement nulle part, que nos origines enfin sont douteuses, nous n’avons pas de meilleure manière de vivre que vagabonder, loin des sentiers battus. La connaissance du monde est bien plus passionnante que celle de notre être, pour la simple raison que nous n’existons pas en dehors de ce monde.
Comme les grandes vacances commencent et qu’il est bon d’avoir quelques paroles en tête avant de s’en aller par les chemins, je conclurai en rappelant cet adage médiéval de Martinus von Biberach que cite Clément Rosset à la fin de son essai La Force majeure :
« Je viens je ne sais d’où,
Je suis je ne sais qui,
Je meurs je ne sais quand,
Je vais je ne sais où,
Je m’étonne d’être aussi joyeux. »
Gilles Pétel
La branloire pérenne

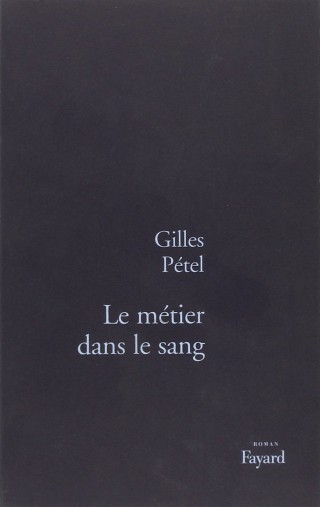

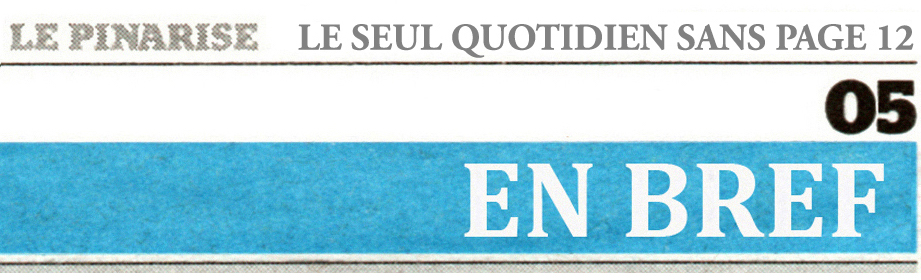

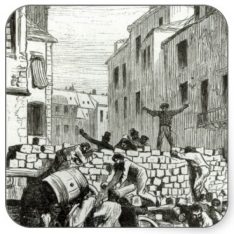


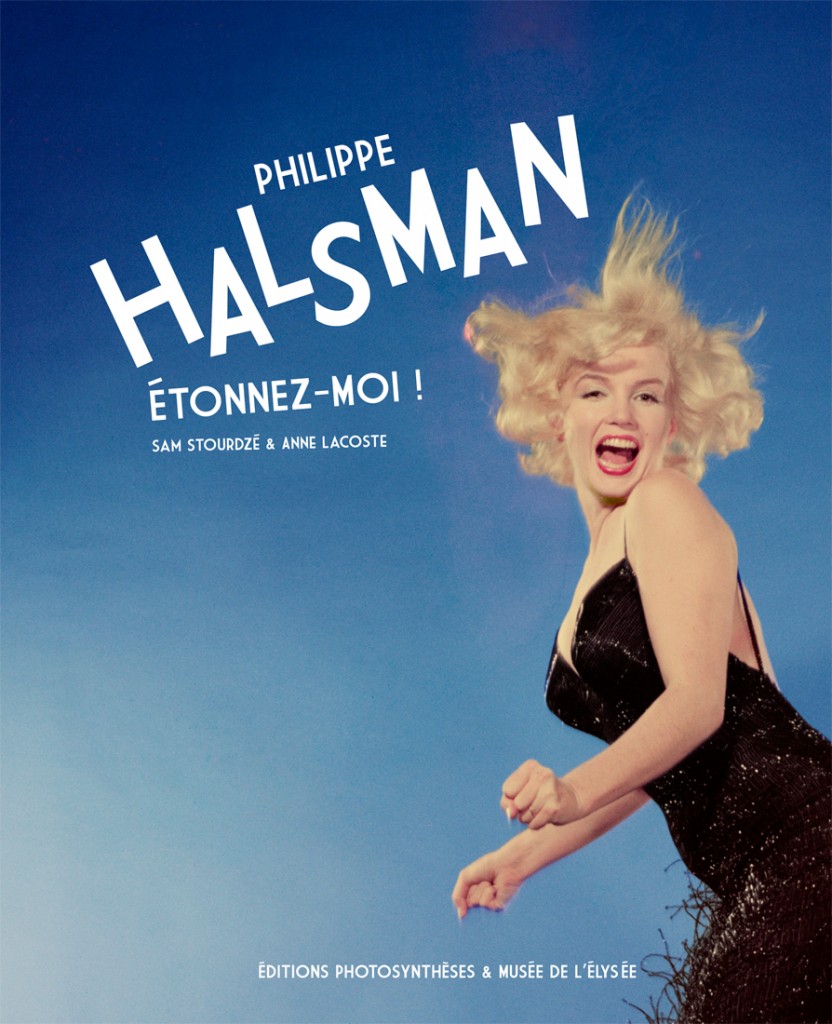
0 commentaires