Goutte d’Or–Barbès, quartier-monde, oxymore urbaine, marge au cœur de Paris. Enclave en mutation, exclusion et gentrification sur le même trottoir. Jamais aussi attractif que depuis qu’il a été déclaré “no-go zone”.
S’il lui est étroitement associé, le quartier n’a pas attendu le hip-hop pour jouer un rôle dans l’histoire de la musique. Sans surprise, plutôt du côté des besogneux que des virtuoses. De même que les Zola et consort situaient leurs romans à la Goutte d’Or sans y vivre, parfois sans y pénétrer, les musiciens y faisaient confectionner leurs instruments. Car, avant de devenir un quartier principalement commerçant, un quartier de revente, la Goutte d’or fut un quartier industriel : on se souvient des usines Cavé et Pauwels, mais se souvient-on que c’est passage Léon que le marquis De Dion déboula un jour de 1882 dans le pauvre atelier que le mécanicien Bouton tenait avec son beau-frère, pour lui proposer de s’associer ? Pour un bal qu’il organisait avec le duc de Morny, le marquis avait acheté des jouets, dont une locomotive à vapeur miniature qu’il trouva si réussie qu’il voulut rencontrer son fabriquant. Le premier fleuron de l’automobile française naissait sur les pentes de la guinguette du père Fauvet !
Pour la musique, il en va de même : la Goutte d’Or fut longtemps un quartier de facteurs d’instruments, sans doute à cause de la proximité des fonderies. C’est d’abord Ignace Pleyel qui fit construire une première manufacture de pianos rue des Portes Blanches, en 1828, avec séchoir à bois et scierie, puis deux autres rue Marcadet et rue Rochechouart, où plus de deux cents ouvriers travaillaient. Rue des Poissonniers, la manufacture de pianos et orgues A. Bord en employait plus de cinq cents en 1888, à la mort de son fondateur, un ancien apprenti, l’aîné de sept enfants, qui balayait les ateliers à treize ans pour 50 centimes par semaine et mit au point un des plus généreux systèmes de redistribution de profits de l’époque (les ouvriers se répartissaient l’entièreté des bénéfices, Antoine Bord ne conservait que les intérêts de son capital d’après un rapport d’enquête extraparlementaire de 1883). Et la maison Corbeel rue de la Goutte d’Or, et les frères Philippi rue Doudeauville (des Corses ayant fait leurs armes chez Pleyel), et d’autres, jusqu’à Adolphe-Édouard Sax, le fils d’Adolphe Sax, qui déménagea la maison Sax de la rue Blanche au 84 rue Myrha en 1905. Adolphe-Édouard dirigeait la fanfare de l’opéra et accueillit rue Myrha une section de l’École de chant choral, une « œuvre de solidarité artistique » fondée l’année précédente pour initier gratuitement au solfège et au chant les ouvriers et employés de Paris (dans la même rue, au 47, les Apaches guinchaient à la même époque au bal Adrien, de fâcheuse réputation). Vendu en 1929 à la maison Selmer qui y fit rajouter des étages encore aujourd’hui ornés des lauriers de la marque, ce bâtiment est le dernier témoignage de cette glorieuse page de l’histoire du quartier (l’atelier de cuivres Selmer a déménagé en 1981).
Ainsi l’histoire de la musique à la Goutte d’Or épouse-t-elle l’histoire ouvrière. Ce que confirment les rares productions musicales qui y sont associées. C’est d’abord l’ode aux blanchisseuses d’Aristide Bruant, ces blanchisseuses de Zola dont le chansonnier fait un symbole de l’évolution du quartier : par le passé filles simples et honnêtes, les lavandières de son temps se sont faites exigeantes et ambitieuses, elles délaissent les braves ouvriers qui n’avaient que leur virilité à offrir, et, à force de racoler le bourgeois, elles y perdent leur honnêteté. Intéressant atavisme de quartier : à toute époque, la Goutte d’Or suscite la nostalgie du temps passé, jamais le même. Unique constante, l’insatisfaction du présent fait s’imaginer à chacun son petit âge d’or personnel, jamais bien lointain. Il n’y a qu’à s’accouder à un comptoir de bar et écouter : les anciens du quartier regrettent le temps d’avant l’immigration, les vieux Magrébins regrettent les temps d’avant les Africains, et tous regrettent les temps d’avant les bobos !
Et puis surtout, il y a Eugène Pottier, qui vécut ses derniers mois en bas de rue de Chartres et mourut à Lariboisière. À en croire les témoignages (notamment celui d’Ernest Museux, son premier biographe, qui vivait d’ailleurs au 78 de la rue Myrha), dix mille personnes se réunirent devant l’immeuble misérable le 8 novembre 1887 (ami personnel de Pottier, Museux exagère probablement ; le reporter du Matin parle de deux mille), pour accompagner le cortège funèbre au Père-Lachaise. Un drapeau qu’on refusa de dérouler devant la police pour en montrer la couleur (il sera déployé au cimetière : rouge) provoqua une émeute, Jules Joffrin fut arrêté, Vaillant roué de coups (coïncidence historique, c’est à cinquante mètres de là, au 20, rue de la Charbonnière, devant le café de la Ville d’Oran, qu’éclateraient en juillet 1955 les fameuses émeutes de la Goutte d’Or, non pas à cause d’un drapeau mais d’une pastèque jetée à la tête du conducteur d’un fourgon de police venu procéder à une interpellation, et qui faucha deux badauds). Périodiquement, on trouve dans les bulletins municipaux des propositions pour rebaptiser la rue de Chartres du nom du poète : elles sont resté lettres mortes, l’immortel Eugène Pottier n’a toujours pas sa rue dans Paris…
La même année, fut publiée L’Internationale, poème que Pottier avait écrit quinze ans plus tôt, à l’en croire (mais certains historiens en ont douté), en juin 1871, déjà à la Goutte d’Or, où il s’était réfugié alors qu’on le croyait fusillé : au 80, rue Myrha, tout près de l’emplacement de la barricade (au 63) où le général Jaroslaw Dombrowski avait trouvé la mort quelques jours plus tôt. Le manuscrit original s’est perdu, il existe plusieurs versions du texte, la dernière compagne de Pottier aurait brouillé les pistes, rien n’est certain : reste l’image de Pottier griffonnant ses vers dans une mansarde obscure tandis qu’on fusille tout autour, sans imaginer qu’il ne les publierait que bien plus tard, l’année de sa mort, qu’il faudrait attendre encore un an pour qu’un membre d’une chorale ouvrière du Nord, Pierre Degeyter, les mette en musique (Pottier aurait plutôt eu l’air de La Marseillaise en tête en composant ses vers, c’est amusant d’y songer a posteriori), dix ans pour qu’ils connaissent la gloire (en 1896, au congrès du Parti Ouvrier à Lille, où on la chante précisément pour couvrir… La Marseillaise), et un siècle et demi pour que des petits rigolos rentrant ivres le samedi soir les chantent à tue-tête en pissant contre le mur de mon immeuble…
Désormais, à la Goutte d’Or, les blanchisseuses ont disparu, remplacées par ces laveries automatiques qu’on trouve à chaque coin de rue, parce que les appartements sont trop petits pour les machines à laver et les habitants trop pauvres pour s’en acheter. Ce qui revient à dire que, à l’inverse des blanchisseuses de Bruant, les damnés de la terre de Pottier, eux, sont bien toujours là…
Sébastien Rutés
(No-)go zone





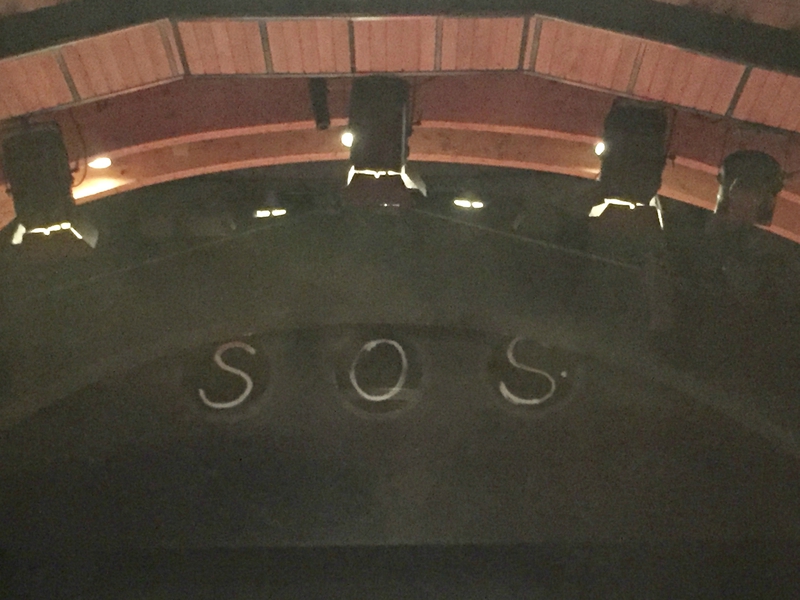
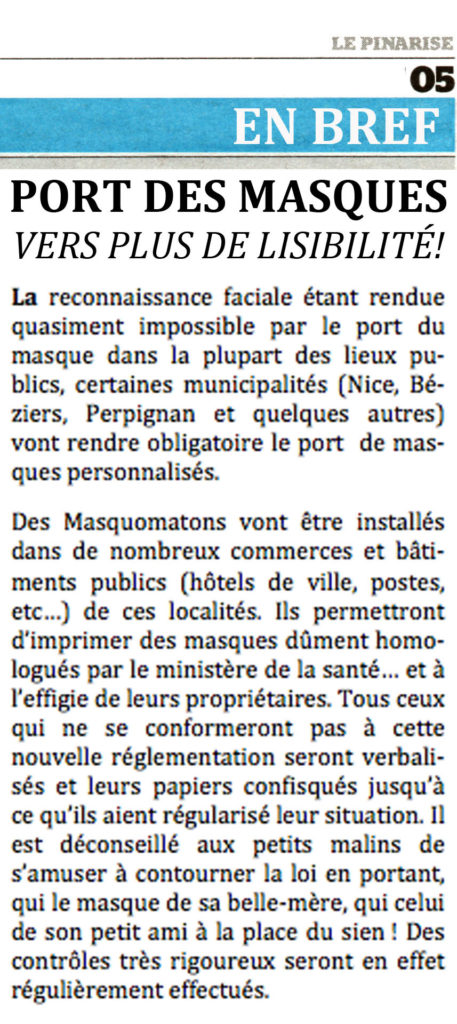



0 commentaires