Quelles leçons tirons-nous de l’histoire ? Cette question, qui a toujours agité les philosophes, de Hegel à Marx, en passant par Leibniz, est aussi au cœur de plusieurs œuvres récentes.
Ça ira (1). Fin de Louis, de Joël Pommerat, y répond d’une façon enthousiasmante, l’auteur et metteur en scène inventant une fiction au présent basée sur le passé, fruit de longs mois de travail sur le plateau avec sa troupe de quatorze comédiens. Entouré d’un conseiller historique et d’une dramaturge, Pommerat ne cherche pas la reconstitution historique de quelques mois décisifs de notre histoire, entre 1788 et 1790, mais réussit un prodige bien plus grand, en nous faisant entendre les débats des comités de quartiers, des États Généraux et de l’Assemblée Nationale de 1789 comme des débats actuels. Car, au fond, rien n’a changé. Les thématiques de la pression fiscale, du patrimoine des élus, de l’actualité qui dicte l’écriture des lois, entre autres, sont toujours le lot de notre quotidien. Mais dans ces mois fiévreux, des hommes et quelques femmes – bien moins nombreuses cependant que dans le spectacle de Pommerat – ont eu aussi à cœur d’œuvrer pour le bien commun, et pour “les enfants des enfants de [leurs] enfants”. On voit ainsi s’ébaucher les premiers articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, dont la version de 1793 inscrira en premier “Le but de la société est le bonheur commun” ! Le metteur en scène se joue de l’espace du théâtre, et utilise le plateau comme les gradins, en plaçant certains de ses comédiens au milieu des spectateurs, ceux-ci se retrouvant du même coup comme siégeant dans l’Assemblée. Idée simple et lumineuse, qui donne à ce spectacle une qualité immersive réelle. Et c’est ainsi que, au sortir du théâtre des Amandiers, quelqu’un a pu me dire que ce spectacle lui donnait envie d’aller voter ! De l’utilité de revenir aux fondements de la démocratie.
Le Russe Alexandre Sokourov continue, avec Francofonia, à discourir sur les grandeurs et la décadence de la civilisation européenne. Avec L’arche russe, un film sorti en 2003, composé d’un seul plan-séquence d’1h30, le cinéaste nous proposait, en même temps qu’une traversée du Musée de l’Hermitage, une traversée de 400 ans d’histoire russe. Cette fois, grâce à une commande initiée par Henry Loyrette, lorsque celui-ci dirigeait encore le Louvre, Sokourov centre son film composite sur la période de l’occupation allemande, et sur la protection du patrimoine artistique. Si certains passages du film sont équivoques, ou au moins discutables, dans la glorification des grandes nations européennes, le cinéaste a au moins le mérite de poser la question vertigineuse : “Que serions-nous sans nos musées ?” Son utilisation de la figure de Napoléon et celle, plus problématique encore, de Marianne, ne peuvent occulter certains aspects de la réflexion à l’œuvre, qui nous interrogent sur la fonction de l’art dans la construction d’une civilisation.
Bande annonce du film Francofonia, d’Alexandre Sokourov
Deux autres événements artistiques majeurs entrent aussi dans la thématique de ce Bentô, deux expositions : Qui a peur des femmes photographes ? et À la recherche de 0,10. En nous montrant 400 photographies prises par 160 femmes, le Musée de l’Orangerie couvrant la période 1839-1919, et le Musée d’Orsay la période 1918-1945, l’exposition Qui a peur des femmes photographes ? nous montre comment des femmes, dès l’invention de la photographie, se sont emparées de ce médium au statut au départ ambigu. Avec ce qui n’a pas été, longtemps, considéré comme un art, des femmes ont pris leur espace, imposé leur savoir-faire, franchi les frontières des pratiques, et sont très vite sorties de l’espace domestique pour aller à la découverte du monde et de ses conflits. Au regard de cette exposition d’une richesse folle, on serait tenté de dire que des femmes se sont constituées comme sujet là où la peinture les maintenait encore dans le statut d’objet. Par des inventions formelles, des sensibilités multiples, un courage hors pair sur le théâtre des opérations militaires, un militantisme dans la vie de cité, des femmes ont été actrices et témoins de leur temps, grâce à la photographie, à une échelle dont on n’avait pas pris la mesure, et c’est aussi une leçon pour aujourd’hui, une alerte pour regarder avec plus de précaution la part prises par les unes, les femmes, et les autres, les hommes.
À cet égard, l’exposition À la recherche de 0,10, présentée à la Fondation Beyeler, à Bâle, est elle aussi à marquer d’une pierre blanche. Le 19 décembre 1915, des artistes de l’avant-garde russe inaugurent une exposition collective de leurs œuvres à Petrograd, actuellement Saint-Pétersbourg, et rencontrent un succès qui semble les étonner. Cette exposition va en effet marquer la fin des courants cubiste et futuriste, alors dominants, et marquer la naissance du suprématisme et du constructivisme. C’est dans cette exposition de 1915 que Malevitch exposa pour la première fois son Carré noir, par exemple. Il publiera le mois suivant, en janvier 1916, son manifeste Du futurisme au suprématisme. Le nouveau réalisme pictural. L’autre grande figure de cette exposition était Vladimir Tatline, qui y montra, là encore pour la première fois, son Contre-relief angulaire. Dans cette exposition, on trouve donc les deux courants majeurs du siècle d’art à venir. Restituer aujourd’hui l’esprit de cette exposition, dans une évocation magistralement accrochée, c’est aussi dire aux contempteurs de l’art contemporain que l’histoire est passée par là, et que cent ans plus tard, les effets de 0,10 se font encore sentir. Fait notable, en écho aux débats contemporains dans le monde de l’art et de la culture : quatorze artistes exposaient dans l’exposition 0,10, 7 hommes, et 7 femmes. La parité était alors révolutionnaire. Elle semble toujours l’être.
Arnaud Laporte
[print_link]



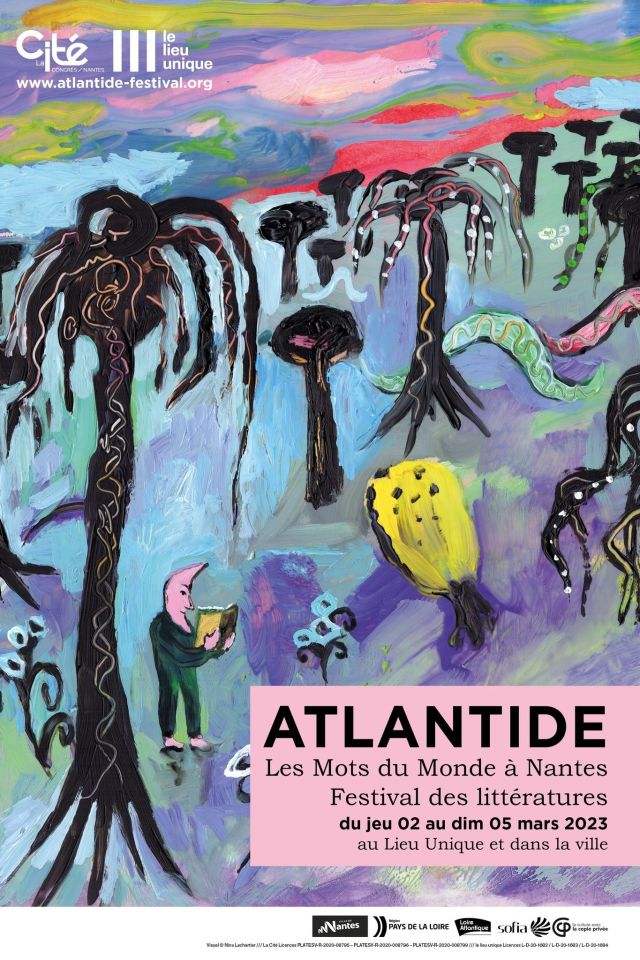


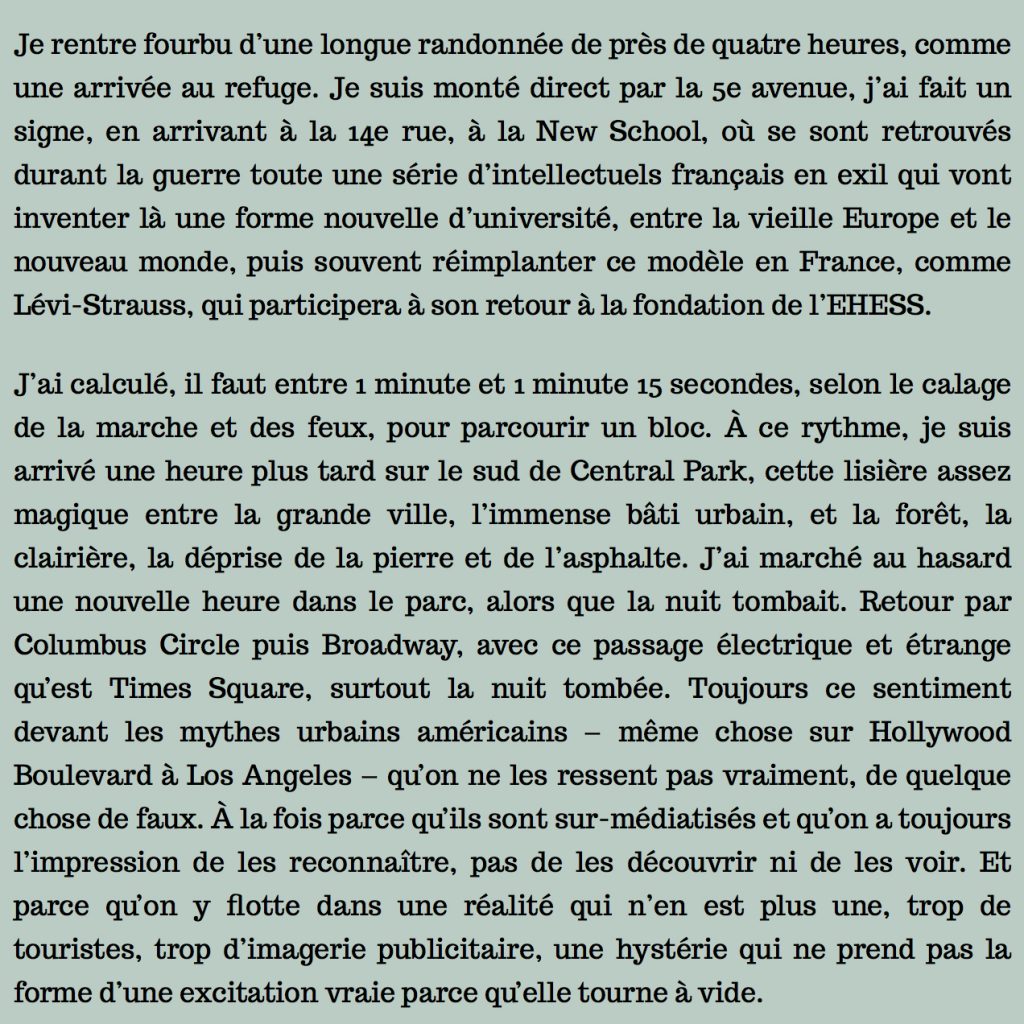
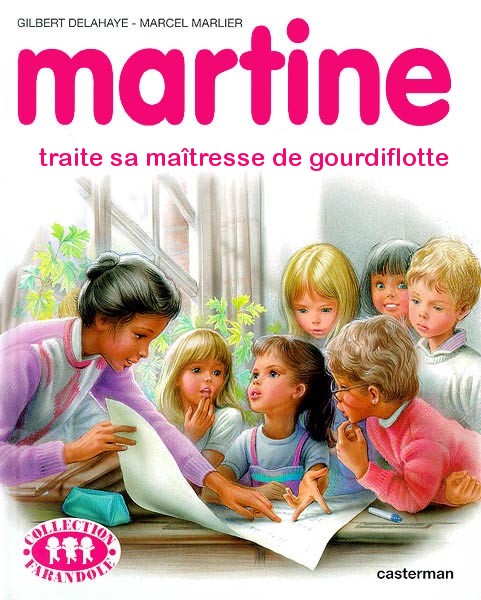
0 commentaires