“Diogène en banlieue” : Heurs et malheurs d’un prof de philo aux confins du système scolaire.

© Gilles Pétel
L’exercice du métier de professeur est plus varié, plus amusant, plus pénible aussi quelquefois que ne l’imagine la plupart des gens. Une anecdote me revient à l’esprit. La rentrée scolaire avait eu lieu depuis une huitaine de jours quand les élèves d’une terminale technique me demandèrent de déplacer mon cours de philosophie du vendredi au mardi. Mal placé en fin de journée, celui-ci alourdissait inutilement leur emploi du temps en contraignant les élèves à m’attendre deux heures en permanence. Je leur répondis favorablement. Je me rendis le jour-même au bureau du proviseur-adjoint où une secrétaire en fin de carrière me pria de coucher ma requête par écrit. Désormais, afin de désengorger les services, les demandes étaient reçues et traitées par courriel : un système de communication moderne, rapide et efficace.
La semaine suivante les élèves revinrent vers moi, certains de la réponse. J’eus le plus grand mal à les persuader que celle-ci tardait encore. Ils refusèrent de me croire. Je les menais en bateau, comme tous les professeurs. Ils commençaient déjà à me juger moins sympathique. Rentré chez moi, je rédigeai un second courriel, plus détaillé, plus insistant aussi. Je renouvelai l’opération moins de trois jours plus tard.
Je n’avais toujours aucune réponse le vendredi suivant. Il me fallut expliquer à mes élèves comment mes demandes réitérées auprès de l’administration étaient restées lettre morte. J’employai sans doute un autre langage. Des cris d’indignation accueillent aussitôt mes propos. Les élèves se montrent scandalisés. On manque de respect à leur professeur de philosophie. Aucune réponse ? insistent- ils, incrédules. Je confirme mon désarroi. Le bouffon ! lance l’un de mes élèves en désignant le proviseur-adjoint. On va lui casser la gueule, renchérit un autre. Tous veulent lui apprendre le respect. L’agitation monte dans la classe. Je comprends qu’il me sera impossible de faire cours tant que cette affaire ne sera pas réglée. Je propose aux élèves de constituer une ambassade : six d’entre eux m’accompagneront chez le proviseur-adjoint où nous demanderons à être reçus en priorité. L’idée leur plaît et nous voilà bientôt en route.
Juliette, la secrétaire du proviseur-adjoint, bondit sur son siège aussitôt qu’elle nous aperçoit. Son visage s’est décomposé. D’ordinaire les élèves se présentent un par un dans le bureau qu’elle occupe, une petite pièce mal éclairée. Et la coutume veut qu’ils attendent sur le pas de la porte avant qu’elle les prie d’entrer. Juliette n’a de toute évidence jamais connu une pareille intrusion. D’un œil inquiet elle remarque derrière moi deux grands blacks d’un bon mètre quatre-vingt qui me talonnent de près. Trois rebeux aussi costauds que déterminés ferment notre ambassade en compagnie d’un jeune Asiatique à qui il ne faut pas la conter.
– M. Pétel ! M. Pétel ! répète Juliette d’une voix blanche.
En quelques mots je lui explique l’objet de notre visite tout en m’efforçant de contenir ma garde rapprochée. Denis, l’élève le plus grand, ne peut s’empêcher de renchérir sur chacune de mes remarques et fait chaque fois sursauter Juliette. Elle incarne une défense vivante et presque héroïque d’une administration qui tarde à se montrer. Après nous avoir demandé de reculer de quelques pas – ne vous appuyez pas sur mon bureau, indique-t-elle à l’adresse de Rachid –, Juliette nous promet de communiquer sans faute notre requête au proviseur-adjoint. Se reprenant déjà, plus sûre d’elle-même, le dos droit, elle nous assure de l’intérêt que l’on ne manquera pas de porter à notre demande. En attendant, elle nous prie de bien vouloir regagner notre cours, m’adressant un sourire peu amène.
Bien qu’elle ne soit plus toute jeune – elle pense parfois à la retraite –, Juliette manque de psychologie. Car comment peut-elle croire éconduire ces six grands gaillards sur la simple promesse d’une réponse aussi lointaine qu’incertaine ? La riposte est immédiate. Rachid pose bien à plat ses deux mains sur son bureau et déclare avec fermeté que nous ne bougerons pas d’ici avant d’avoir rencontré le proviseur-adjoint.
– Oui, ajoute Wong, si la montagne ne vient pas à Mao, Mao ira à la montagne.
Juliette comprend que la situation est hors de son contrôle. Elle ne peut plus, à elle seule, contenir les mécontents. Elle décroche enfin son téléphone et compose le numéro de la ligne directe qui la relie à son supérieur, monsieur Ledoux, qui a été nommé à la rentrée dans cet établissement sur un poste vacant depuis un an déjà. Elle lui explique rapidement la situation en insistant sur la présence des élèves devant elle, oui devant elle, de très nombreux élèves. À l’entendre, le lycée vient de connaître un soulèvement populaire. Presque au même moment s’ouvre la petite porte qui sépare la pièce étroite où travaille Juliette du bureau à peine plus grand de monsieur Ledoux. Celui-ci est un homme de taille moyenne avec une drôle de tête inquiète et bien peignée.
– M. Pétel désire me voir ? demande-t-il d’une voix sucrée en me regardant dans les yeux de façon à ignorer les élèves qui se pressent contre moi.
Il a cependant à peine le temps de terminer sa question que mes six lascars s’avancent vers lui sans que j’aie le temps de les retenir. Lui recule d’un bon pas, blême, bafouillant une seconde question ou une simple prière : sa voix est inaudible. Peut-être intime-t-il aux élèves l’ordre de reculer. À moins qu’il ne prenne des nouvelles de leur famille. Et comment va ton frère ? Il y a longtemps qu’on ne l’a vu à l’école. Il n’a guère le temps de développer ses intentions car les élèves pénètrent d’autorité dans son bureau en m’entraînant à leur suite. Le visage du proviseur-adjoint vire au rouge écarlate. Il semble suffoquer lorsqu’il aperçoit un gamin s’asseoir sur une des deux chaises qui sont presque tout l’ornement de la pièce. L’autre a le sourire aux lèvres et se moque bien de l’ordre du monde.
J’apprends rapidement à mon supérieur de quoi il retourne, je rappelle mes trois ou quatre courriels, j’insiste sur la justesse de la cause. Enfin, je souligne que ce changement d’heure ne prendra que deux secondes pour être effectué.
– Mais cela va sans dire. Quelle question ! Vraiment tout ce tintamarre pour si peu de choses ! Il fallait venir me voir plus tôt. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu dans mon bureau, M. Pétel.
En un clic de la main sur un ordinateur, le nouvel emploi du temps se trouve corrigé, imprimé et bientôt sur la table. L’instant d’après, nous voilà repoussés, mes six élèves et moi, hors du bureau de M. Ledoux qui ne cesse de nous remercier tout en s’évertuant à nous faire reculer d’un pas supplémentaire à chaque mot qu’il prononce. Il transpire à grosses gouttes mais n’a plus dans les yeux cette expression de panique qui l’a fait suffoquer quelques instants plus tôt. Il vient sans même le remarquer de desserrer le nœud de sa cravate.
De retour auprès des autres élèves nous sommes accueillis par des hourras quand nous leur apprenons le résultat de notre ambassade. L’ambiance est à la fête. Je décide pourtant de donner un cours de philosophie sur les rapports du droit et de la force malgré les protestations, les sifflets, le bruit. Denis n’en croit pas ses oreilles. Je rêve, j’extravague, dit-il. Rachid implore ma clémence. Wong cite à nouveau Mao. Mais je n’en démords pas. Je leur parle de Hegel, de Marx et du rôle de la violence dans l’histoire. La sonnerie retentit quand je tente, tant bien que mal, d’expliquer comment la force est parfois le moyen du droit.
Souvent nos élèves ressemblent à des personnages de bandes dessinées. Ils sont leur propre caricature, pour le meilleur comme pour le pire. Je n’ai pas eu besoin de beaucoup forcer le trait pour ressusciter cette scène chez le proviseur-adjoint qui continue de me faire rire.
Gilles Pétel
Diogène en banlieue
[print_link]






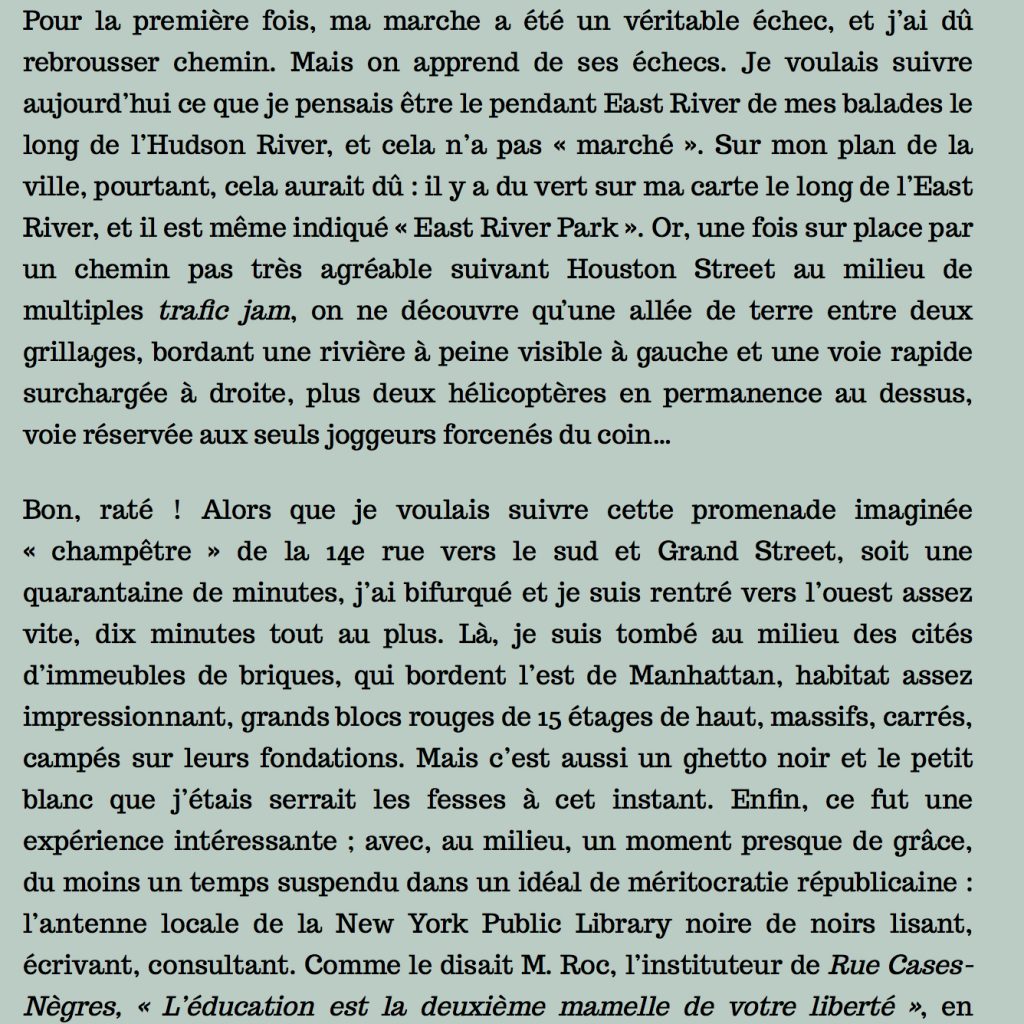


0 commentaires