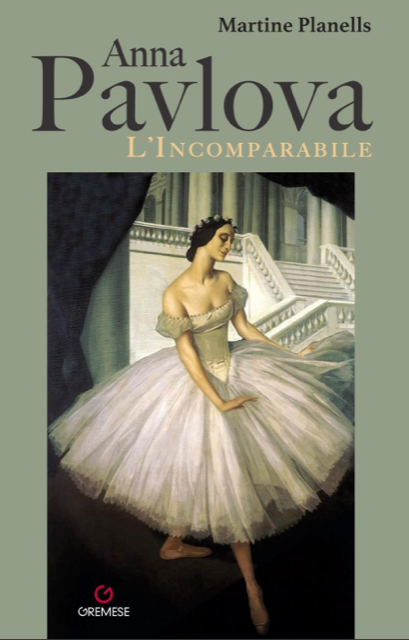 La Pavlova n’est pas seulement un délicieux biscuit meringué, onctueux au cœur, croquant à l’extérieur, orné de crème fouettée et de fruits rouges, créé pour les uns en Australie, pour les autres en Nouvelle-Zélande. Cette pâtisserie est un hommage à la diva du ballet Anna Pavlova (1881-1931), qui triompha aux antipodes en 1926 au cours d’une tournée. Martine Planells retrace la vie de la danseuse-chorégraphe dans un livre intitulé Anna Pavlova. L’Incomparable, publié par l’éditeur italien Gremese.
La Pavlova n’est pas seulement un délicieux biscuit meringué, onctueux au cœur, croquant à l’extérieur, orné de crème fouettée et de fruits rouges, créé pour les uns en Australie, pour les autres en Nouvelle-Zélande. Cette pâtisserie est un hommage à la diva du ballet Anna Pavlova (1881-1931), qui triompha aux antipodes en 1926 au cours d’une tournée. Martine Planells retrace la vie de la danseuse-chorégraphe dans un livre intitulé Anna Pavlova. L’Incomparable, publié par l’éditeur italien Gremese.
La Pavlova : l’article défini devant un patronyme que les Slaves déclinent au féminin, nom d’un père putatif disparu dans la nature et dont on ne sait pas grand-chose, ne dénote aucune familiarité. Au contraire, puisqu’il la distingue non seulement de tous les Pavlov – Ivan compris – mais aussi de toutes ses potentielles rivales des Ballets russes. Et elles étaient légion et de talent à Saint-Pétersbourg au temps des Romanov, qui fut aussi celui du Marseillais Marius Petipa. La Pavlova, à la différence des « dames blanches » l’ayant précédée (Carlotta Grisi, Marie Taglioni, Fanny Elssler) ou des premières à avoir bénéficié du statut de prima ballerina assoluta, est proche des gloires du temps jadis, Eleonora Duse ou Sarah Bernhardt, et contemporaine des divas du septième art. Elle est la première star du ballet. La star des tsars.
Dans un style vivant et agréable à lire, Martine Planells retrace la trajectoire de la danseuse-étoile formée au Mariinsky, sous la protection du « petit père » l’Empereur qui, à partir de 1902 et de son apparition magique dans La Bayadère, ne cessa de danser, de s’entraîner avec Enrico Cecchetti, de magnétiser le public. Planells cite le jeune critique André Levinson :  « Dans la scène où la bayadère danse selon le rite, déjà atteinte par le poison mortel, l’émotion refoulée trépide dans les épaules frémissantes, pénètre à travers les formes hiératiques et figées de la danse sacrée, accélère le tempo, désarticule le rythme et aboutit au grand cri mimique de l’agonie. » Giselle (1903) contribue à sa renommée. Son duo avec Nijinski en 1907 dans Le Pavillon d’Armide, autre opus romantique inspiré de Théophile Gautier, fera la couverture du magazine Le Théâtre pour annoncer, deux ans plus tard, la première Saison des Ballets Russes (avec R majuscule) au Châtelet.
« Dans la scène où la bayadère danse selon le rite, déjà atteinte par le poison mortel, l’émotion refoulée trépide dans les épaules frémissantes, pénètre à travers les formes hiératiques et figées de la danse sacrée, accélère le tempo, désarticule le rythme et aboutit au grand cri mimique de l’agonie. » Giselle (1903) contribue à sa renommée. Son duo avec Nijinski en 1907 dans Le Pavillon d’Armide, autre opus romantique inspiré de Théophile Gautier, fera la couverture du magazine Le Théâtre pour annoncer, deux ans plus tard, la première Saison des Ballets Russes (avec R majuscule) au Châtelet.
 « Anna prenait son rôle de star très au sérieux, chacune de ses apparitions était un spectacle. » Elle savait, alors, se faire attendre, se faire désirer, y compris de Diaghilev, qui est forcé de débuter ses spectacles sans elle, Vera Karalli la remplaçant. Martine Planells rappelle que l’affiche, signée Valentin Serov, représente Pavlova dans Chopiniana, ballet de Mikhaïl Fokine, l’auteur du chef d’œuvre de la ballerine, La Mort du cygne, qui fut filmé en 1925 dans un studio des Artistes associés puis restauré et sonorisé en 1988 par Bambi Ballard.
« Anna prenait son rôle de star très au sérieux, chacune de ses apparitions était un spectacle. » Elle savait, alors, se faire attendre, se faire désirer, y compris de Diaghilev, qui est forcé de débuter ses spectacles sans elle, Vera Karalli la remplaçant. Martine Planells rappelle que l’affiche, signée Valentin Serov, représente Pavlova dans Chopiniana, ballet de Mikhaïl Fokine, l’auteur du chef d’œuvre de la ballerine, La Mort du cygne, qui fut filmé en 1925 dans un studio des Artistes associés puis restauré et sonorisé en 1988 par Bambi Ballard.
Une version antérieure de ce magnifique solo existe, interprété par Vera Karalli dans le long métrage de Yevgeni Bauer, Umirayushchiy lebed (1916). L’interprétation de Vera Karalli, parfaite sur le plan technique, est moins éthérée, moins habitée, moins hallucinée que celle de la créatrice du rôle.  Deux styles contrastent : celui du Bolchoï et celui du Kirov. Deux physiques également : l’un du XIXe, pourtant celui de la cadette Vera, l’autre, celui des temps modernes, des muses et des vamps, des Garbo et des Louise Brooks. Très tôt, Pavlova fait partie des têtes d’affiche du muet, « personnages fabuleux » qui, selon Edgar Morin, « dominent le commun des mortels ». Elle partage l’« essence mythologique supérieure » avec les artistes de l’écran.
Deux styles contrastent : celui du Bolchoï et celui du Kirov. Deux physiques également : l’un du XIXe, pourtant celui de la cadette Vera, l’autre, celui des temps modernes, des muses et des vamps, des Garbo et des Louise Brooks. Très tôt, Pavlova fait partie des têtes d’affiche du muet, « personnages fabuleux » qui, selon Edgar Morin, « dominent le commun des mortels ». Elle partage l’« essence mythologique supérieure » avec les artistes de l’écran.
Quoiqu’on ait pu dire, Anna Pavlova a innové non seulement en matière de danse, en passant du répertoire romantique de Petipa à celui du ballet d’avant-garde représenté par Fokine, Nijinski et sa sœur Nijinska (desquels elle envie l’envolée), voire Isadora (cf. la Danse grecque revue et corrigée par Pavlova), mais aussi de mode de conception, de production et de représentation spectaculaires. Du bel art, on passe à la diffusion de masse ; et de l’artisanat à l’industrie du rêve. Le ballet devient gala dansé, le public s’élargit à la planète entière, la tournée vire au tour du monde. Pavlova passe du mécène royal au protecteur attitré (Victor Dandré, son conjoint et unique héritier), de celui-ci à de multiples agents artistiques, directeurs de théâtres, producteurs de shows et de films : Sol Hurok (qui organise ses tours américains et organisera par la suite ceux de Mary Wigman et de Carmen Amaya), Daniel Mayer (agent londonien), Edouard Frazer (impresario finlandais), Max A. Rabinoff (promoteur de l’orchestre philharmonique de Chicago, directeur de l’Opéra de Boston), Arthur G. Herndorn (manager californien), Charles Dillingham (manager de l’Hippodrome de New York, barnum de près de 6000 places), sans oublier Carl Laemmle (fondateur d’Universal).  Elle tourne pour ce dernier, sous la direction du couple Phillips Smalley-Lois Weber (l’une des premières femmes cinéastes), The Dumb Girl of Portici (1916), film muet, d’après l’opéra de Delavigne-Scribe et Auber. À Hollywood, elle devint amie avec Chaplin qui, probablement, lui présenta ses associés, le couple Pickford-Fairbanks qui l’incita à filmer ses performances, ce qu’elle fit avec sa propre caméra, lors de sa tournée australienne.
Elle tourne pour ce dernier, sous la direction du couple Phillips Smalley-Lois Weber (l’une des premières femmes cinéastes), The Dumb Girl of Portici (1916), film muet, d’après l’opéra de Delavigne-Scribe et Auber. À Hollywood, elle devint amie avec Chaplin qui, probablement, lui présenta ses associés, le couple Pickford-Fairbanks qui l’incita à filmer ses performances, ce qu’elle fit avec sa propre caméra, lors de sa tournée australienne.
Les dessins, les tableaux (l’anamorphose bichrome d’Alexandre Iacovleff en couverture du livre), les photographies (dont Martine Planells livre des échantillons dans un cahier noir et blanc inséré à mi-parcours du livre) et les images en restituent le mouvement et la grâce inégalée, pour ne pas dire incomparable.
Nicolas Villodre
Danse
Martine Planells, Anna Pavlova. L’Incomparable, Gremese Editore







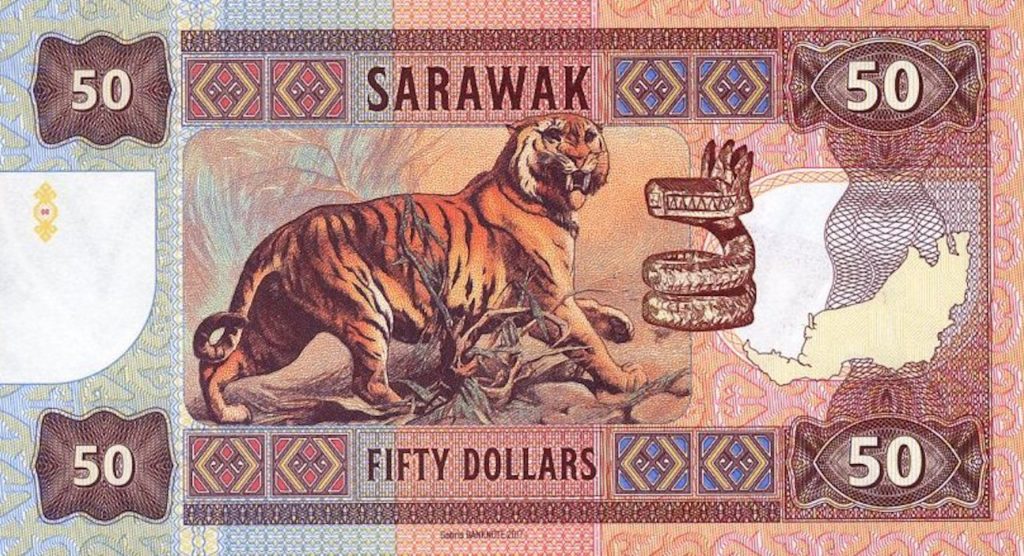


0 commentaires