« Les années 30 nous obsèdent », écrit Daniel Schneidermann dans Berlin, 1933. Entre Babylon Berlin, série à succès qui fait du bruit, et un livre qui dépiaute les silences de la presse internationale dans l’entre-deux guerres : dialogue.
Histoires multiples et éclatées, personnages à triple fond, politiciens retors. Un héros récurrent, Gereon Rath, commissaire et ex-appelé de 14-18, hanté par son passé, soigné à coup de sirop héroïné, qui n’est donc pas toujours au clair. Volker Kutscher affectionne les intrigues labyrinthiques. La république de Weimar est pour lui une mine.
Babylon Berlin, dont Canal+ passe et repasse la saison 1 depuis septembre, série à 40 millions d’euros, soit la plus coûteuse jamais produite en Allemagne, s’inspire du premier roman de l’écrivain allemand, Le Poisson mouillé (Seuil, 2010, traduit par Magali Girault).
La série, à juste titre, fait un tabac. En Allemagne, en Angleterre et aux USA via Netflix. En France, il faudra attendre encore un peu pour la saison 2 que le reste de la planète a déjà vue : les accords entre diffuseurs relèvent du service investigation.
Fil rouge et brun des deux premières saisons, un train, arrivé d’URSS avec à bord un wagon entier d’or en lingots et pas mal de phosgène, le plus redoutable des gaz de combat. L’or est destiné à Trotski alors en exil en Turquie. Le gaz, importé avec la complicité d’industriels, est destiné à la Reichswehr noire, groupe nationaliste qui en dépit du traité de Versailles organise réarmement, entraînement de troupes et complote de son mieux contre la République .
Tout le monde ou presque va s’intéresser à l’or, soit les Trostkistes, une incertaine héritière russe également chanteuse transgenre à succès et agent triple au bas mot, l’URSS, Edgar l’Arménien (Misel Maticevic), roi de la nuit berlinoise, truand puissant et sans pitié sauf lorsqu’il a de mystérieuse empathies.

Liv Lisa Fries (Charlotte Ritter). Des Anglais ont pétitionné pour qu’elle ne disparaisse pas en saison 3. Peu de risques… (Photo: Sky)
Gereon Rath (Volker Bruch), le chef de la police politique August Benda (Matthias Brandt qui, détail amusant pour cette série finalement hautement politique, est le fils cadet du chancelier Willy Brandt) vont s’intéresser au gaz. Ceci est très succinct et ne tient aucun compte de personnages essentiels, tels le Docteur Schmidt, adepte de l’hypnose et légèrement freudien, le commissaire Bruno Walter (Peter Kurth), lui aussi complexe et en cheville avec les groupes nationalistes, et surtout Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries, remarquable), sous-prolétaire dont la fraîcheur, la force vitale, le désir fou de devenir la première enquêtrice de la brigade criminelle même si elle n’est qu’une tâcheronne à la journée et une prostituée occasionnelle la nuit, illumine les épisodes.
Les trois réalisateurs, Tom Tykwer, Achim Von Borries et Hendrik Handloegten ont eu les moyens de se faire plaisir. Des scènes sorties des tableaux d’Otto Dix ou Conrad Felixmüller, des citations cinématographiques en nombre (tels Les Hommes le dimanche de Curt et Robert Siodmak ou un bout d’essai de Marlene Dietrich) : bien plus que les rues reconstituées à grands frais, la couleur et l’énergie de l’époque sont là. Avec en prime une bande-son choisie par Brian Ferry, incollable sur le jazz comme sur Kurt Weill (il fait une apparition en saison 2).

Le Moka Efti café, avec citation visuelle de Joséphine Baker qui avait triomphé à Berlin en 1928. (Photo: Sky)
Peut-être a-t-on un peu négligé la documentation ? Dommage en effet de rebâtir numériquement l’Alexanderplatz de 1929 en y plaçant deux énormes immeubles construits ultérieurement. Ce point, parmi bien d’autres, est soulevé par l’artiste californien Mark Vallen, mordu d’expressionnisme allemand devenu un spécialiste de Weimar. Remarques bienveillantes, il a beaucoup aimé Babylon Berlin et consacré un blog d’une petite cinquantaine de pages au sujet.
Si on ne le savait pas déjà, on apprendra que la Reichswehr noire, ce groupe paramilitaire dont il est question, n’est que la partie émergée de l’iceberg : il y avait en Allemagne, nourris par l’humiliation et la rage nées du traité de Versailles, plus de 103 corps militaires organisés, dans les années 20, et on estime à environ un million et demi le nombre de citoyens qui y participaient. Et l’URSS avait bel et bien autorisé la création d’un camp d’entraînement dirigé par des monarchistes et nationalistes sur son territoire (moyennant des informations techniques). La partie la plus invraisemblable du scénario est rigoureusement exacte… Et, en fin de saison 1, on ne sait pas encore, pour nombre de personnages, de quel côté ils pencheront en 1933.

Les Nyssen de la série, industriels finançant les groupes armés clandestins, copiés-collés des Thyssen bien réels, représentés, avant 1933, comme les manipulateurs du pantin Hitler (affiche d’époque)
Mais Hitler, dans tout ça ?
De lui, il n’est fait mention qu’une fois, en passant. En 1928, il avait pourtant provoqué émeutes et affrontements en tenant meeting à Berlin. Mais pas une référence, pas une chemise brune. Et cette fois, ce n’est pas un oubli, mais bien plutôt l’intelligence de cette série qui restitue l’explosion créative, les confusions politiques, les libertés et les misères, l’aveuglement, sans convoquer immédiatement le nazisme. Rappelons que Babylon Berlin fut tourné avant l’entrée au Bundestag de l’extrême-droite, avant Chemnitz.
Et comment parler à Chemnitz ? En filmant ce qui a fait le lit du fascisme, avec empathie. Ou, comme le dit Hendrik Handloegten, l’un des réalisateurs : « l’un des motifs qui nous a amenés à tourner cette série, c’est que nous souhaitions montrer que les nazis n’étaient pas tombés du ciel. »
Non, et même ils furent scrutés de près. Une centaine de correspondants étrangers se trouvaient à Berlin en 1933 et dans les années qui suivirent, avant la guerre. Mesures anti-juives, nuit des longs couteaux en 1934, ouverture de camps de concentration, dont Dachau, pour les communistes et autres opposants, incendie du Reischtag, nuit de Cristal enfin : pour ne citer que quelques événements connus. De quoi raconter ?
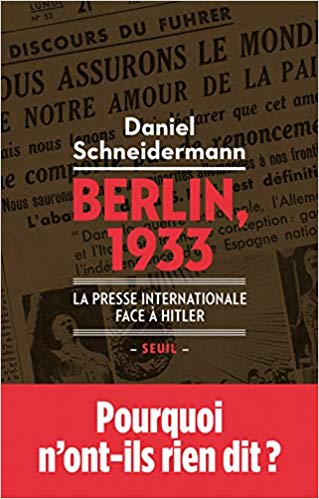 Le bandeau rouge apposé sur la couverture – « Pourquoi n’ont-ils rien dit ? » – ne rend pas justice au livre de Daniel Schneidermann. Car justement l’essentiel de Berlin, 1933 s’attache à ce qui s’est écrit et publié pendant et après 1933. C’est l’avant-Shoah. Souvent germanophiles, repliés tous ensemble dans la Stammtisch où se côtoient journalistes et officiels nazis qui viennent en off, pour quelques-uns imprégnés de l’idéologie fasciste qui progresse en Europe, pour beaucoup baignant dans l’antisémitisme lui aussi européen, répondant à la demande des rédactions (on veut les grand-messes d’Hitler), même si l’auteur évite de son mieux les facilités du jugement a posteriori, disons que la profession n’en sort pas grandie. Indifférence au sort des victimes du régime, et une coupable absence de curiosité.
Le bandeau rouge apposé sur la couverture – « Pourquoi n’ont-ils rien dit ? » – ne rend pas justice au livre de Daniel Schneidermann. Car justement l’essentiel de Berlin, 1933 s’attache à ce qui s’est écrit et publié pendant et après 1933. C’est l’avant-Shoah. Souvent germanophiles, repliés tous ensemble dans la Stammtisch où se côtoient journalistes et officiels nazis qui viennent en off, pour quelques-uns imprégnés de l’idéologie fasciste qui progresse en Europe, pour beaucoup baignant dans l’antisémitisme lui aussi européen, répondant à la demande des rédactions (on veut les grand-messes d’Hitler), même si l’auteur évite de son mieux les facilités du jugement a posteriori, disons que la profession n’en sort pas grandie. Indifférence au sort des victimes du régime, et une coupable absence de curiosité.
À quelques glorieuses exceptions près, Edgar Mowrer, qui récupère clandestinement ses informations avant d’être expulsé, et sa compatriote américaine Dorothy Thompson, auteur d’un portrait au vitriol du Führer, elle aussi expulsée avant de mener campagne aux USA pour l’entrée en guerre, dire le sort des réfugiés juifs.

Carl von Ossieztky, écrivain et journaliste, nobélisé en détention, avait dénoncé le réarmement allemand sous bénédiction soviétique. Interrogé en camp par la presse étrangère sur les lectures qu’il aimerait recevoir, il répondit que le Moyen Âge lui paraissait approprié. Personne ne percuta. Il mourut en 1938.
Quelques noms aussi en France, telle Andrée Viollis, les articles très informés de L’Humanité et de l’agence de presse juive, qui ne rencontrent que peu d’écho : parce qu’ils sont publiés par des communistes, parce qu’ils sont publiés par des juifs. Ou encore l’écrivain Georges Duhamel posant frontalement la question à la une du Figaro : « monsieur Hitler, que voulez-vous faire des juifs ? » Mais quand même, peu de monde et tant de complaisances, comme une visite à Dachau organisée par le régime : ça roule, Dachau. Les réponses à double fond du futur prix Nobel Carl von Ossietzky aux questions des journalistes n’interpellent personne.
En fin de volume, Daniel Schneidermann s’interroge sur l’utilité de son livre, né du choc que fut l’élection de Trump pour la presse américaine.
« Des centaines et des centaines d’articles épluchés, désossés, regroupés en thématiques, mis en fiches. Des engagés, des neutres, des furieux, des pleutres, des colorés, des sérieux, des extravagants, des lucides et des complaisants, des myopes, toute la gamme. Les années 30 nous obsèdent. » Mais ajoute-t-il, « aucune comparaison d’ensemble n’est possible ». Non, mais à ainsi éplucher la presse de l’entre-deux guerres, il met en relief l’importance de quelque chose qui aujourd’hui, sur le net, mais pas seulement, fait davantage pour la confusion des esprits et l’invisibilité de certaines informations : l’absence de hiérarchisation dans l’information. L’un des passages les plus intéressants du livre concerne l’affaire du Saint-Louis, navire rempli de juifs fuyant le nazisme en 1939, et mouillant à Cuba dans l’attente d’une autorisation d’émigrer aux USA, qui ne viendra jamais. Le navire repartira vers l’Europe, où (déjà) on se partagera en râlant les réfugiés entre pays. 260 d’entre eux mourront en camp d’extermination. L’affaire, bien documentée d’après un livre de la journaliste Laurel Leff intitulé Relégué en page 7, c’est tout dire, est passionnante et déchirante. Seuls de brefs paragraphes, noyés dans les pages intérieures, rendent compte des tractations, négociations, demandes de garanties, offre de Cuba d’héberger en camp, puis refus. Quasiment pas une ligne humaine, et le coup dur : le roi George V en visite américaine s’enthousiasme pour le hamburger. Tout le monde titre là-dessus, les 1500 « réfugiés » (on omet de préciser qu’ils sont juifs) n’intéressent plus, s’ils ont jamais intéressé. Un entrefilet et un article indigné, un seul, clôtureront l’affaire du Saint-Louis. Journalistiquement, tout a été précisé, et rien n’a été dit. Quand l’essentiel devient invisible. Babylon Berlin, aujourd’hui, emprunte un chemin inversé : occultant temporairement Hitler pour mieux donner à voir la montée du fascisme.
Berlin, 1933, Daniel Schneidermann, éditions du Seuil.
Babylon Berlin, Canal+ séries en rediffusion, Canal+ à la demande, Netflix USA (deux saisons), Sky.












0 commentaires