Gérard Rabinovitch, philosophe et sociologue, directeur de l’Institut européen Emmanuel Levinas, observe et analyse la vague pandémique au jour le jour.
« Nous vivons avec quelques arpents du passé,
les gais mensonges du présent,
et la cascade furieuse de l’avenir »
René Char
Lundi 16 mars 2020
Ce soir, le président de la République dans un discours qui s’essaie solennel, unificateur et rassembleur, déclare : « Nous sommes en guerre ».
Il y a de justes mots prononcés qui paraissaient encore la veille, désuets ; pire : ringards dans le mainstream des egos de la boboïtude et des élites cooptées : Solidarité, Responsabilité. Des mots d’une sémantique d’adultes. Léon Bourgeois, l’énonciateur, sous la IIIe République, du théologico-politique de l’Esprit républicain serait-il soudain réactualisé ?
Il y a des conseils qui semblent tombés tout droit de l’estrade d’une salle de classe : ainsi de l’invitation à renouer avec la lecture. C’est en effet un manque dans les chaumières investies depuis des lustres par les Loft Story, Koh-Lanta, Star Academy, l’Île de la Tentation, et autres machineries à décerveler…
Ça fait quand même un peu bricole de poser la recommandation ici, alors qu’il y a un tel déficit de politique culturelle de promotion du « livre » et de soutien à toute la chaîne de création bibliophile, depuis les auteurs jusqu’aux libraires de quartiers. Et ce depuis plusieurs mandatures présidentielles. Bref…
Donc : « Nous sommes en guerre », répété six fois. C’est quatre fois de trop.
Il y a quatre jours, le 12 mars, tout était « sous contrôle ». Aujourd’hui, ça sent déjà la ligne Maginot. Une ligne Maginot communicationnelle pour commencer. On connaît ce qu’il advint de l’efficacité de la précédente…
Ces quatre fois de trop, ça sonne le prompteur ; ça résonne l’« élément de langage » ; ça dessine le graphe de la pensée de « com », et fleure l’odeur métallique de l’artifice instrumental. On ne tient pas le Front avec ça.
Il faut que ça soit habité par un sujet humain, vibrant dans les inflexions de la voix.
Il faut du Père. Pas celui de la Horde primitive, versus Hitler, Mussolini, Staline, Péron ; mais celui érigé en Gardien éclaireur. Il faut du Moïse, du Spartacus, du Garibaldi, du Churchill, du de Gaulle, du Ben Gourion, du Martin Luther King, du Václav Havel. À ceux-là, deux fois auraient suffi pour être entendu. En annonce d’ouverture et en conclusion mobilisatrice.

Mardi 17 mars
Eh bien nous y allons, ou peut-être nous y sommes : « Cataclysme » et « Révélation ». Les deux signifiants de l’Apocalypse.
Apocalypse est emprunté comme nom propre vers 1160 (cf. Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française) au mot latin ecclésiastique désignant le texte de saint Jean, placé en clôture des textes du Canon chrétien. Et d’après le grec tardif apokalupsis, « révélation », du verbe apokaluptien, « découvrir », « révéler ».
Le genre prend sa source première dans la littérature hébraïque. Chez le prophète Daniel, déjà. Puis dans une littérature de crise prolixe à la période de l’occupation romaine. Elle interroge le triomphe apparent du Mal, et la persécution subie ; et s’essaie à déchiffrer les mystères de la Providence. Il s’agit, par le récit de visions et l’expression de songes, de raffermir la confiance en celle-ci contre le doute devant les réalités observées. Elle ne spécule pas sur la « Fin du monde » mais sur la suite des jours Ah’arit Hayamim, ceux du monde à venir. Jours moraux, espérance dans l’avenir d’une humanité qui ne se vouerait pas à la Destruction.
En office de genre littéraire, le style « apocalyptique » s’éteindra dans la littérature hébraïque vers le IIe siècle de l’Ère chrétienne.
Avec son hellénisation, le christianisme accolera au texte de Jean l’aspect d’oracles et de présages propres aux techniques de divination grecques. Et l’infléchira en lecture dans cette direction. Il en appuiera les visions terrifiantes de châtiments, les cortèges de fléaux, tonnerres de punition divine, qui inspireront les représentations artistiques à partir du Moyen Âge ; en oracle alors de la Fin des Temps. Voir par exemple les xylographies de Dürer, Apocalypsis cum Figuris.
Apocalypse, par effet de timbre et par agrégat de signification, s’associera avec l’évocation de cataclysmes (du latin cataclysmus, « déluge », lui-même du grec kataklusmos, « inondation »). Cataclysme désignant un grand bouleversement causé par un phénomène naturel destructeur, et par extension depuis le XIXe siècle l’idée d’un « profond bouleversement social, économique, psychologique »).
Dans la bifide signification d’Apocalypse, chrétienne et juive, en double héritage monothéiste : une épreuve terrifiante (Cataclysme) et une déchirure des illusions (Révélation). Un saisissement d’effroi que la mort existe et guette (Cataclysme), et un Dévoilement : effondrements des impostures, démasquage des mascarades, lisibilité des incompétences (Révélation). Dans l’épouvante de la fin des Temps, la Convocation à plus de maturité pour l’avenir. En face de la débandade des méchants, c’est la créativité des vivants qui est convoquée.
On peut ainsi en passant apprendre que les religions sont des ressources de métaphores poético-éthiques qui font sens, et que c’est un bien précieux, quoiqu’il puisse en être de leur déficit de raison, et de déficiences scientifiques. Et retenir que les mots ont un sens patrimonial qui s’est établi tôt chez les Anciens quand ceux-ci étaient plus près des réalités humaines que nous le sommes ; et valent davantage en héritage que les jactances frivoles et le bruit de la doxa publique.
Mercredi 18 mars
Avec son art ineffable de raconter, son intuition poético-politique profonde, Paul Virilio avait attrapé tous les grands mouvements profonds de la modernité. Ses dévoiements globalistes ; l’outrecuidant surplomb des technosciences qui cachent avec constance leur négativité ; l’impéritie cuistre des technocraties.
Lui qui avait immédiatement compris en 1993, dans une première tentative, ce qui s’y préfigurait déjà du nine/eleven, de la destruction en 2001 des tours du World Trade Center à venir, et prédit son inéluctable seconde tentative.
Lui qui avait annoncé : l’inertie domiciliaire, la téléaction et téléprésence corrélée au confinement domestique, la terreur écologique, et annoncé la synchronisation de l’émotion, la mondialisation des affects.
Lui qui avait énoncé les formules narratives de l’accident intégral, du grand accident, et qui appelait de ses vœux à ce que se lève, irrigante, une « intelligence du Désastre ».
De là où il pourrait être maintenant, ce doit être une douleur pour Paul Virilio de voir se réaliser ces jours-ci ce qu’il n’a eu de cesse de pointer dans ses essais.
Sûrement que — comme Churchill — il aurait préféré s’être trompé, et que la sentence surgissante de la réalité n’advienne que pour le démentir.
Jeudi 19 mars

Une déferlante de reconnaissance de dette. Médecins, personnels hospitaliers, livreurs, postiers, caissières…
Née de la spontanéité des peuples aux fenêtres et aux balcons, en rendez-vous journaliers. Et maintenant reprise des gouvernances, en communiqués quémandeurs, et lettre ouverte ministérielle flatteuse.
Tiens ! On se souvient soudain des soutiers. C’est un peu tard… Mais peut-être n’est-il jamais trop tard. Nous verrons.
Déjà la mandature précédente les avait oubliés alors qu’il lui revenait plus qu’à quiconque de ne pas les négliger. Mais « Terra Nova » était passé par là : Fi du prolétariat ! Plutôt l’interactionnisme — ou l’intersectionnisme pour les « rebelles » de pacotille – des narcissiques revendications des égotismes catégoriels ; et du « victimisme » en drapeau.
Un boulevard qui fut ouvert et dégagé pour tous les démagogues.
Ils avaient négligé, lâché, méprisé, l’évidence que Marx avait élu séculièrement le prolétariat en corps souffrant christique et rédempteur. Ils n’avaient qu’indifférence au substrat chrétien de la population française, qui sans y penser, espère néanmoins implicitement que, par délégation aux officiants politiques, l’on ne se détourne pas des laissé-pour-compte. C’est à cela qu’est dévolue légitimement la « Gauche ». Celle-ci a cessé de l’être, le jour où elle a pris pour mentor Terra Nova. Grand mal lui fasse !…
L’écrivain britannique Mary Anne Evans, plus connue sous le nom de George Eliot, de constatait déjà au cœur du XIXe siècle, dans son chef d’œuvre Middlemarch, « que les choses ne soient pas si mauvaises pour vous et moi qu’elles auraient pu l’être, est dû pour moitié à tous ceux qui ont mené une vie cachée et reposent dans des tombes que personnes ne visite ». Il n’y a pas de Solidarité sans pressentiment de Dette réelle ou symbolique.
C’est le fond éthique, cognitif, psychique du Solidarisme républicain de Léon Bourgeois. « L’homme nait débiteur de l’association humaine », il est l’obligé de ses contemporains, mais aussi de ses ascendants et de sa descendance. De quoi faire frémir libéraux économiques et marxistes qui se donnèrent la main – comme il leur arrive pour d’autres occasions – pour le disqualifier.
Peut-être si – il y a quelques décades – les « élites » avaient su saluer avec solennité et prononcer leur dette aux pères venu du bled ou des brousses, entassés dans les foyers de la Sonacotra, les fils et petit-fils ne mettraient pas à feu et à sang les « zones sensibles »…
SI cette éthique solidariste républicaine pouvait devenir l’axe de référence fécond de la vie publique et des gouvernances d’après, en post confinement…
Ne rêvons pas.
Vendredi 20 mars
Romain Gary dans la Promesse de l’aube, définissait l’humour comme « une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l’homme sur ce qu’il lui arrive ».
Plus spontané, et plus créatif que les laborieux et poussifs stand up sur les planches du Montreux Comedy Festival, il y a quelque chose de réjouissant dans ce qui actuellement circule sous forme de clips comiques, détournements d’images, sentences parodiques, en réactif à la situation de confinement auquel nous sommes tous convoqués et astreints.
Ça vibrionne et court, en partage jubilatoire sur les réseaux, inventifs ou recyclés, trouvailles du moment ou télescopages d’époques différentes. Invariants de la vie quotidienne passée au crible de la lucidité. Et nouveautés d’une situation inédite.
Une phénoménologie rieuse de l’ordinaire humain pris dans ses contingences. Cette fois-ci : coronavirées.
Il en est, de cette efflorescence, qui s’assortit plutôt au ton de l’Almanach Vermot, d’autres qui sont des inventions inédites sublimes ; mais ce qui est la bonne nouvelle du moment c’est que, dans leur plus grande part, l’ensemble se situe dans la sphère de l’humour vrai.
Celui que définissait Shaftesbury comme la meilleure arme contre le fanatisme. Non pas un rire cruel, fielleux, se moquant d’autrui, mais une autodérision ou une dérision partagée. Position d’être, qui signe l’humour authentique. S’y trace, non pas la jouissance mauvaise du ricanement et du sarcasme, « ce bourreau tout prêt » au milieu de la foule, comme le nommait bien Victor Hugo, mais le plaisir d’énoncer en partage souriant ou hilarant – avec un certain tact qui n’exclut pas la crudité – quelques vérités humaines prises dans la contingence du moment.
Ces productions amusantes et charmantes se situent non pas du côté des rires de mise à mort, mais de celui des réchappés. Non pas du côté d’un rire d’emprise, mais de celui de la déprise. Déprise de soi sur autrui et affirmation d’une déprise du monde sur soi.
Accrochons, ici, à ce joyeux train, cette histoire venue du profond de l’autodérision de l’humour juif :
Après le « test », Moshe, confiné, reçoit par téléconsultation avec son toubib Yankel, le compte rendu du résultat :
— J’ai deux nouvelles : une bonne, une mauvaise. Je commence par quoi ? lui propose Yankel.
— La bonne, la bonne…, le prie Moshe.
— La bonne, c’est que, en fait, tu n’es pas hypocondriaque.
Samedi 21 mars
Une amie russe m’envoie ce poème de Joseph Brodsky, prix Nobel de Littérature en 1987, traduit par André Markowicz.
Sa rédaction date de 1970. Brodsky vivait encore en URSS, avec ses parents, entassés dans un appartement « communautaire », comme la majorité des Soviétiques démunis de tout. Il aimait les moralistes français du XVIIe siècle, La Rochefoucauld, La Bruyère, et rêvait de France.
Ne sors pas de ta chambre, ne fais pas cette connerie.
Que t’importe le Soleil quand tu fumes du gris ?
Dehors, tout est absurde, tout, surtout les cris de joie.
Sors aux toilettes, bon, mais rentre tout de suite chez toi.
Oh, ne sors pas de ta chambre, n’appelle pas de chauffeur
parce que l’espace est essentiellement composé d’un compteur
situé au bout d’un couloir, et si, sans se faire prier,
une belle te rend visite, vire-la sans la déshabiller.
Ne sors pas de ta chambre ; compte que tu as la crève.
Regarde la chaise et le mur, c’est ça, le véritable rêve.
À quoi bon sortir, vouloir, par exemple, aller bosser
là d’où tu reviendras pareil, — juste, peut-être, plus cabossé ?
Oh, ne sors pas de ta chambre. Danse, tiens, la bossanova
de la radio, nu sous ton imper. La bosse de la danse va
s’épanouir loin de l’odeur de chou et de la graisse à skis
du couloir. N’écris rien de nouveau. Reste sur ton acquis.
Ne sors pas de ta chambre. Laisse-la, oh, laisse-la plutôt
seule à te voir en vrai. Comme une espèce d’incognito
ergo sum, — ce qu’a dit, rageuse, à la forme l’essence.
Ne sors pas de ta chambre ! Dehors, c’est si loin de la France.
Ne fais pas le con ! Ne joue pas au tribun des peuples.
Ne sors pas de ta chambre. Id est : laisse parler les meubles.
Fonds-toi aux papiers peints, garde tes propres puces,
Cache-toi de chronos, du cosmos, de l’éros, de la race, du virus.
Dimanche 22 mars

L’ayatollah Ali Khamenei, « guide suprême » iranien, annonce refuser l’aide américaine pour lutter contre le coronavirus, dans un discours diffusé en direct dans tout le pays pour marquer le Norouz, le Nouvel An iranien. « Il est possible que votre médicament offert soit le moyen de propager davantage le virus » ; et encore : « On soupçonne que les États-Unis soient responsables du virus, et les médicaments soient leur moyen de le propager encore plus » (dixit).
Le gouvernement iranien reconnaît ce dimanche 1 685 décès pour 20 600 contaminés. Le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI, de l’opposition en exil) évoque lui – ce jour – 8 800 décédés.
« Il apparaît clairement que [les responsables iraniens] sous-estiment en tout cas publiquement la gravité de la crise », affirme Seth Jones, du Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS) de Washington.
Le régime iranien avait tenté de nier en janvier quelques responsabilités dans le crash de l’avion de la compagnie Ukraine International Airlines abattu par un missile sol-air ; comme il avait étouffé le nombre de victimes tuées, blessées, emprisonnées, disparues, de la répression des manifestations de novembre précédent. Sûrement à cette aune, il ne peut que mentir sans vergogne sur son programme nucléaire.
Si la dissimulation est un exercice ordinaire de tout pouvoir, il s’agit encore ici d’autre chose. Le mensonge, le déni de réalité, la projection paranoïsante sur un ennemi extérieur constituent, dans leur nouage, une constante des régimes totalitaires. Ça leur est paradigmatique : rien ne saurait entamer la Perfection revendiquée. Ils ne sauraient y renoncer, car leur mode de penser (si on peut employer ce mot…) est similaire au mode de verrouillage de la société : blindé, carapacé, rivé.
Ils s’inventeront « victime » de ce qu’ils savent eux faire : des complots. Ils inventeront des ennemis occultes, des causes extérieures. Pas seulement en excuse, comme un enfant pris la main dans le pot de confiture, mais faute de pouvoir eux-mêmes envisager auto introspections, auto interrogations. L’entame est leur angoisse.
Évidemment la conséquence première pour les peuples c’est qu’ils persévèrent dans leur indigence et incompétence.
L’Ayatollah Khamenei reprend à son compte, dans une version localement adaptée, une accusation proférée par certains dirigeants chinois. En ellipse, la question s’en déduit par logique de structure : combien de décédés réellement en Chine du fait du coronavirus ? Dix fois plus, cent fois plus ?
Lundi 23 mars
Dans le bras de fer public Didier Raoult et Establishment administrativo-médical, se fait allégorie le conflit entre l’action clinicienne et la pensée d’administration. Cette dernière fût-elle nimbée de culture méthodologiste, en éclat de supériorité.
Clinique, du latin Clinicus, lui-même du grec Klinikos, « qui concerne le lit », substantivé au masculin pour nommer le médecin qui examine le malade au lit, et au féminin Kliniké pour nommer la « médecine exercée au chevet du malade ».
Le mot-clé, le signifiant éthico-pratique, c’est : Au chevet.
On le retrouvera par exemple implicite dans la distinction entre la philosophie politique et toutes les idéophilies ordinaires de la philosophie classique et les tentatives de cette dernière, moquées par Heine de tenter de boucher « en robe de chambre en guenilles » les « trous de l’édifice du monde ».
Léo Strauss soulignait que la philosophie politique était la branche de la philosophie la plus proche de la vie politique, de la vie non philosophique, de la vie humaine. La philosophie politique campe auprès du vécu humain. Elle est « clinique » en ce qu’elle bâtit ses linéaments au chevet de la condition humaine, de ses possibles, de ses impasses, de ses égarements, et de ses capacités d’élévation.
Eh bien, ce qui se dévoile, dans ce qui oppose Didier Raoult et les conseillers bien introduits qui ergotent plein de suffisance sur les « protocoles de validation » et n’arrivent pas à dissimuler leur mépris veule, qui toisent de toute leur sadienne froideur les audacieux qui ne marchent pas au pas, ressort d’un même pattern.
Au chevet de la vie, où dans l’éther de sa propre contemplation. Au chevet de la vie ou dans la sauvegarde d’une oligarchie d’administrateurs. Ceux-là qui substituent la responsabilité technique à la responsabilité morale. Ceux pour qui seul « importe de savoir si la tâche a été exécutée selon la meilleure méthode technologique disponible et si elle est rentable quant à ses buts », bien décrits par John Lachs dans son essai Intermediate Man. Ceux chez lesquels « la conscience a cédé à l’esprit consciencieux ».
Didier Raoult est-il un Mozart de la virologie (ça se dit en filigrane des compliments internationaux sur ses travaux) en but à un agrégat informel de Salieri et de petits marquis poudrés, mais aux narines seulement… ?
Difficile d’en juger cliniquement quand on n’a pas les requis de connaissance pour formuler un avis pertinent. Mais éthiquement il n’y pas de doute, l’éthique du clinicien vaudra toujours mieux que la morale frelatée du « faux self » de tâcherons d’administration.
Mardi 24 mars
Uchronie est un mot forgé au XIXe siècle, les Anglais emploient l’expression d’alternative history, ou alternative world. HBO, relayé en France par OCS, a commencé la diffusion de la série construite par David Simon (le scénariste de The Wire, de Treme), The Plot against America. D’après le roman éponyme de Philip Roth. Ce soir OCS diffuse, en décalage de 24h, le second épisode.
P.K. Dick avec The Man in the High Castle, « Le Maître du Haut Château », Norman Spinrad avec Iron Dream « Rêve de fer », Robert Harris avec Fatherland, Michael Chabon avec The Yiddish Policemen’s Union, entre autres, avaient redonné vie au genre. Une autre histoire, un autre possible, qui se déroule dans un monde en tout point semblable au notre, jusqu’à ce qu’un événement le fasse différer de tout ce que nous connaissons. Tel un monde alternatif familier et étranger issu d’une bifurcation, produite par un « point de divergence » dans le vocabulaire des commentateurs du genre.
Depuis une semaine, la bifurcation uchronique s’affiche devant nos yeux.
Au carrefour, les feux de signalisation continuent de réguler une circulation automobile qui n’a plus lieu. En spots télévisuels et en courriers électroniques la Publicité continue d’exhiber ses messages uchroniques, signaux d’un monde dont nous venons de quitter l’autoroute. Celui de l’étêtement consommateur, du « manque à jouir » colmaté sans fin par des produits inaccessibles ou dérisoires. Et la gouvernance d’État croit qu’elle détient toujours, en routine, les paradigmes mentaux (savoirs techniques et valeurs morales structurantes) appropriés et requis pour maitriser quelque chose d’une réalité qui les déborde.
Mercredi 25 mars

La pensée de communication est réifiante, servile et asservissante, en quête permanente de production de signaux plutôt que de sens, et d’« éléments de langage » ce syntagme managérial flottant entre office de propagande, agence de publicité, et potion anesthésiante.
Chose peu nouvelle certes, concomitante à l’exercice de la domestication, et déjà identifiée dans les cabinets du pouvoir par Jean-Paul Marat (in « Les Chaînes de l’esclavage »), avant même la Révolution française. Dont le seul changement moderne notable réside dans l’acquisition par les agents de service d’un nom de fonction : « communicants ».
La « pensée de com » c’est l’installation en retournement d’épouvante de la formule saint-simonienne « Remplacer le gouvernement des hommes par l’administration des choses ». Quand les hommes ne sont plus traités que comme des choses administrables.
La « Pensée de com » est à la manœuvre dans cette gouvernance, sans lui être exclusive. Nulle autre qu’elle n’a pu faire coopter, selon une logique publicitaire aussi branchouille que décalée, et choisie suivant les critères d’une quête de signaux à la façon Benetton, l’actuelle porte-parole du gouvernement.
Mauvaise donne, sui generis aux impasses de ce type de pensée. L’exemple même dans ce cas de l’« accident industriel » — pardon communicationnel — de l’office de « com ».
Pas seulement parce que ça fait désordre, ainsi que la « porte-parole » vient de le faire à la sortie du Conseil des ministres, en parlant de « l’enseignant qui aujourd’hui ne travaille pas, compte tenu de la fermeture des écoles ». Une « boulette » tirée, comme un tir parti accidentellement, droit au cœur du ministre de l’Éducation…
Mais en ce que trop souvent ses prises de parole « à l’Ouest », en fonction de porte-parole – une expression qui a son poids – se retournent contre la gouvernance dont elle porte la parole. Ça ne fait plus désordre, ça mute en contre signal. Censé présentifier la cohérence gouvernementale c’est le signal délétère de l’amateurisme et de la superficialité qui devient le message. Là où il y aurait urgence pour celui de la solidité de compétences.
Jeudi 26 mars
Ce matin, la Frankfürter Allgemeine Zeitung fait état d’un rapport alarmant sur Strasbourg émanant d’une équipe de médecins allemands de l’Institut DIKFM. « Toute personne de plus de 75 ans n’est plus intubé », titre-t-elle. Le Tagesspiegel rapporte de son côté que « les personnes de plus de 80 ans ne sont plus ventilées ». Au lieu de cela, elles seraient placées en soins palliatifs et des somnifères leur sont fournis. L’information est confirmée par la présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin : « les patients de plus de 80 ans, de plus de 75 ans, certains jours même de plus de 70 ans ne peuvent plus être intubés car nous manquons tout simplement de respirateurs ». En Italie, relate un médecin en mission de secours à Parme sur la Chaine 12 de la télévision israélienne, l’ordre leur a été donné d’« interdire l’accès aux appareils respiratoires aux plus de 60 ans ».
En 1943, le führer des médecins nazis, Gerhard Wagner, pérorait : « Nous refusons fermement de considérer comme idéale une situation où nous aurions des myriades de camarades de race (sic !) âgés, malades et invalides, dans nos provinces allemandes, pour la simple raison qu’il est devenu scientifiquement possible de prolonger artificiellement la vie ».
Ce qui était sociographique dans la Weltanschauung, la vision du monde S.S. devient passage à l’acte dans la contingence des négligences et des impréparations qui se font jour.
Theodor Adorno, dans une conférence au Hessischer Rundfunk en 1966, avertissait : « il faudrait faire la lumière sur un éventuel déplacement de ce qui a éclaté à Auschwitz. Demain ce peut être le tour d’un groupe autre que les Juifs, par exemple les Vieux »…
Tel est l’enjeu symbolique et civilisationnel aussi de la catastrophique Crise actuelle.
Céder aux calculs de la raison instrumentale et se compromettre au tri, ou bien, afin de ne pas y sombrer, essayer toutes autres solutions qui nous permettent de ne pas plonger dans cette ignominie. Comme par exemple donner instruction aux directions médicales des hôpitaux de se préparer à l’emploi de médications pour combattre le coronavirus qui n’ont pas encore été approuvées comme traitement contre la maladie.
Puisque la scénographie proposée en mobilisation collective est la « guerre ». Eh bien la médecine de guerre n’est pas spécifiquement le tri des blessés sur les champs de bataille, comme quelques complaisances morbides le déclament, mais le recours à tout ce qui peut se présenter pour sauver des vies.
Toute autre option n’est que travail souterrain de la jouissance de destruction et signe l’ascendance de Thanatos sur Eros dans la civilisation.
Vendredi 27 mars
Elias Canetti, discours à l’occasion du 50e anniversaire d’Hermann Broch, Vienne, novembre 1936 :
« Il n’y a rien à quoi l’être humain soit aussi ouvert qu’à l’air. Là-dedans, il se meut encore comme Adam au paradis, pur et innocent et ne soupçonnant aucun animal dangereux. L’air est la dernière aumône. Tout le monde y a communément droit. Il n’est pas réparti d’avance, le plus pauvre même peut se servir. Et si quelqu’un mourrait de faim, il aura du moins, ce qui est certes peu, respiré jusqu’au bout. Et cette chose, qui nous était commune à tous, va tous nous empoisonner en commun. Nous le savons ; mais nous ne le sentons pas encore, car notre art n’est pas de respirer. L’œuvre de Hermann Broch se dresse entre une guerre et une autre guerre ; guerre des gaz et guerre des gaz. Il se pourrait qu’il sente encore maintenant, quelque part, la particule toxique de la dernière guerre. Ce qui est certain toutefois, c’est que lui, qui s’y entend mieux que nous à respirer, il suffoque aujourd’hui déjà du gaz qui, un jour indéterminé encore, nous coupera le souffle. »
C’était après Ypres 1915, et avant les gazwagen, les camions à gaz du programme T4, des exterminations à Chelmno, et les chambres à gaz d’Auschwitz-Birkenau.
L’agence spatiale européenne vient de diffuser les premières cartes montrant la chute impressionnante de la pollution au dioxyde d’azote au-dessus des grandes métropoles européennes, à partir des données satellitaires du réseau Copernicus. Avec celles transmises de la NASA, révélant le même phénomène en Chine en février suite au confinement du Hubei, les relevés cartographiques sont sans appel. Une indifférence et négligence qui sentent la pulsion de mort collective nous « empoisonnent en commun » depuis de décennies. Il aura donc fallu que ce soit un virus s’attaquant aux poumons, et agent de détresses respiratoires mortifères, pour que cette évidence ne puisse plus être esquivée.
Ne serait-ce pas le moindre des engagements – par dette envers ceux qui sont et vont être emportés par cette déferlante – que de refuser de revenir à l’atmosphère irrespirable d’avant ? Sans métaphore.
Samedi 28 mars

Il y avait quelque chose de pathétique lors de la conférence de presse de cette fin d’après-midi. Les politiques, en état de sidération, se défaussent sur les médecins, les médecins sont asservis aux formes narratives et règles d’esquives des politiques, pris la main dans l’étau de ne pouvoir tout dire. Le Premier ministre, dépossédé de toute parole crédible, en est réduit au rôle de distributeur de la parole aux intervenants. Dont une infectiologue réputée très hostile au virologue marseillais.
« Derrière chaque décision il y a une blouse blanche », disait le 9 mars Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, citant Olivier Véran, le Ministre de la Santé.
Un paysage se dessine, la soutane rouge et la mozette de cardinal du conseiller d’Ancien Régime cèderaient-elles la place à la blouse blanche du médecin, en nouvelle soutane ?
Il serait bon de faire lire — découvrir ? — aux décideurs un classique de la sociologie lorsqu’elle n’avait pas encore sombré dans la science d’administration : Le Savant et le Politique, de Max Weber. On ne mélange pas les deux.
Dimanche 29 mars
Le progrès et la catastrophe sont l’avers et le revers d’une même médaille (Hannah Arendt).
Gérard Rabinovitch
Les temps qui courent





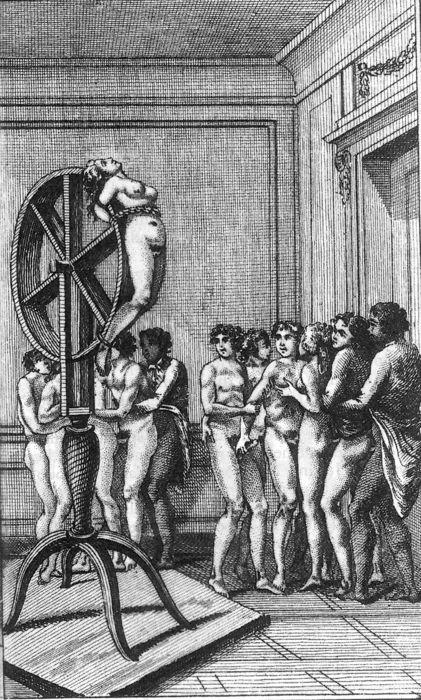

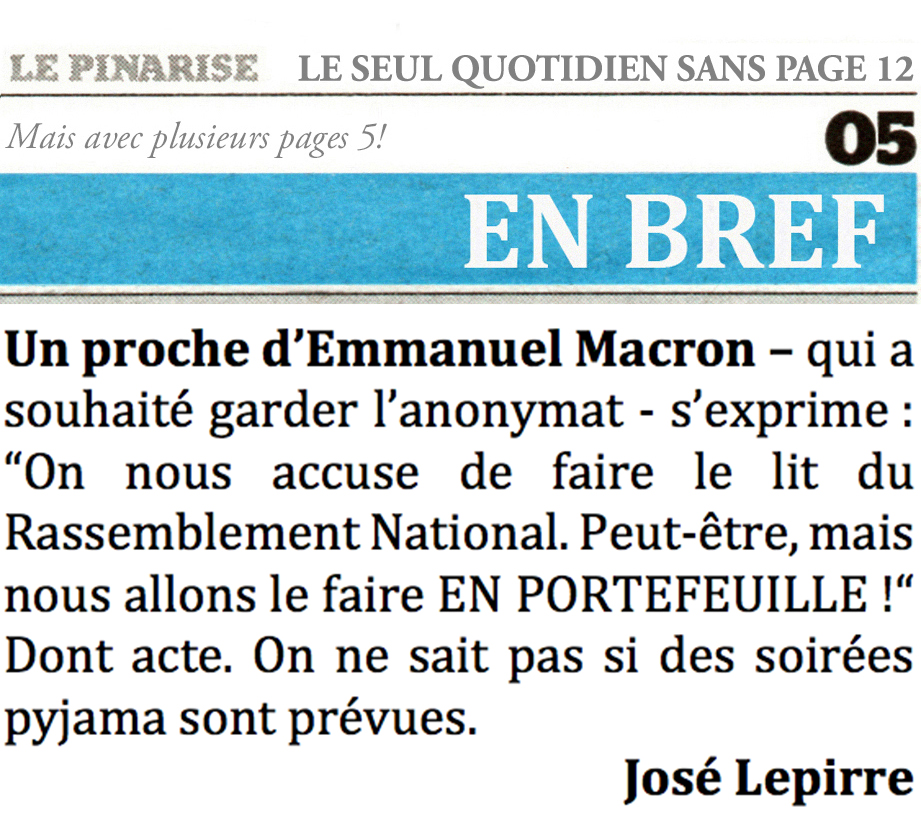

0 commentaires