Ça y est, ils se sont remis à brûler des pneus sur la plage, et aussi du plastique. C’est tous les jours la même chose ; l’air transporte la fumée empoisonnée. On ne peut pas respirer. Ça n’a pas l’air de gêner grand monde à part Ahmel et moi. Surtout moi, ça m’empêche de me concentrer.
Il y a un an, nous étions allés nous plaindre auprès de l’hôpital, mais il est compliqué de retrouver le responsable. C’est comme ça, quand tout est à tout le monde et à persone. Quand le pouvoir du peuple repose sur la parole. Une parole qui, comme les déchets toxiques, se laisse emporter par le vent.
431 cas, 550, 650… Presque 800… Et ce n’est rien, paraît-il, comparé à…
Hier, Ahmel a terminé une sorte d’entretien pour Hypermedia Magazine, quelque chose à propos de la pandémie et ses effets sur la création littéraire. J’avais déjà été invitée, avec d’autres artistes visuels, à m’exprimer sur le même sujet. J’avais alors écrit un texte à bâtons rompus. Je n’arrive pas à me défaire de cette sensation de vie entrecoupée. De vie qui avance par bribes.
Il n’existe pas une idée, une pensée, une mesure globale capable de stopper net l’avancée du virus. Les gouvernements et les gens attendent un vaccin : les uns enflent par-ci, par-là d’autres se délitent. Les chiffres avancés par les spadassins de Midas pour lever des armées ne servent à rien pour empêcher cette course.
Ici, nous allons tous mourir d’un rhume. La rue est sur le point d’exploser.
Chaque jour, je parcours presque six kilomètres à pied, je vais et je viens dans Cojímar et la Villa Panamericana jusqu’à la jonction avec la route Monumental, et je ne la vois pas, cette majorité dont le gouvernement prétend qu’elle est de son côté. « Prenez vos machettes, en face ils sont peu nombreux »… c’est ce qu’ils ont dit.

El adiós, Cirenaica Moreira, 2020
Moi, ce que je vois, c’est une armée en haillons qui cherche de quoi manger. Des gens laids dans un pays pire encore ; des gens qui se remettront d’aplomb, comme par magie, dès qu’ils auront l’occasion de quitter le pays. Même s’ils seront toujours les mêmes, avec les mêmes aptitudes, les mêmes qualités intellectuelles, professionnelles et humaines.
Pas un seul visage heureux, pas une seule remarque heureuse le long de mes six kilomètres de marche quotidienne. Chercher à manger, c’est la spécialité nationale. Ça l’a toujours été, en dehors de quelques trêves, et encore. Ce besoin jamais satisfait.
Je pense aux visages des miséreux de Buñuel. À un cadrage de Gabriel Figueroa ou de José Fernández Aguayo : Terre sans pain, Viridiana, Los Olvidados.
Sur laquelle de ses échelles de la faim la FAO placera-t-elle Cuba ?
L’y placera-t-elle ?
À chaque nouvelle phrase de ce gouvernement, je perçois un relent de ségrégation, comme si nous les dégoûtions. Comme si, tendus au-dessus de leurs épaules et de leur bedaine ankylosée dans leur guayabera, au-dessus de leur perles fausses – et authentiques aussi, car on trouve de tout là-bas en haut –, leurs cous raides voulaient nous écraser. Mais alors il ne resterait plus personne pour travailler à leur service.
Un système comme un autre, qui naît et grandit sur les cendres du symbole qui le précède et qu’il a assassiné ; il outrage ses ossements pour qu’il n’en reste plus aucune trace, et comme le dernier des pauvres se précipite pour vider les caisses et s’installer le palais.
Qui ? Quel genre de personne brandirait un drapeau, rouge bien sûr, pour rejoindre ainsi les rangs d’un parti, unique bien sûr ?
La gauche mondiale adore ériger Cuba en exemple.
Personne ne vient s’installer ici une bonne fois pour toutes.
Je veux dire, comme nous.
Si nous assassinions les enfants de Castro, ses acolytes et ses serviteurs, à Cuba, à Miami ou à n’importe quel endroit de la planète, aurions-nous le pardon et l’assentiment d’un système ?
Probablement.
Quand tu as cinquante, cinquante et un ans, la première chose qui saute aux yeux, c’est la perversion qui se cache derrière les choses. J’avoue que, quand j’avais sept ou dix ans, je la voyais aussi, cette perversion — je ne saurais dire si c’était un bien – chaque fois que je pensais à cette arnaque qu’est le système électoral cubain, par exemple, ou à la salle de bain commune du fameux « immeuble des intellectuels », comme on l’appelait, l’endroit où – certains le savent – je suis née.
La lumière de la perversion pour jeter une ombre sur ses semblables, quel que soit leur domaine ; pour jeter une ombre sur la confiance dans un système qui, en 1917 déjà, en ouvrant la porte du siècle, ouvrait la porte à l’échec de l’utopie ; le système qui en 1959 et en 2021, d’un siècle à l’autre, nous est encore présenté comme magnanime.
Cette magnanimité que l’auteur d’un article – je ne me souviendrai évidemment jamais de son nom –, appelait récemment « l’État Papa », une image éculée, certes, mais qui continue à me sembler servile et malsaine : l’immémorial portrait croisé du pédophile et de sa victime abusée. Pouah !
La lumière noire derrière les choses, dirait Ahmel. Cette sorte d’aura inversée qui vous laisse toute seule, à sept comme à cinquante ans.
Après que le gouvernement cubain a confirmé la présence de trois citoyens italiens atteints de Covid-19 sur le territoire national, j’ai mis huit mois à réagir. Je suis sortie pour la première fois le 27N.
Ce jour-là, je me suis réunie. J’ai serré dans mes bras. J’ai mis le feu.
Le 27 novembre 2020, quand à midi tu as vu assez d’images des tes collègues plantés devant les portes du ministère de la Culture, quand tu as eu honte de mettre un J’aime ou un J’adore sur leur murs sur Facebook, quand tu commences à manquer d’air, pas à cause de ton masque, ni des déchets toxiques sur la plage, quand tu décides que cette honte est plus grande que ta peur, et que tu vas prendre une douche histoire d’être propre pour sortir dans la rue et te planter à leurs côtés… c’est la rébellion du regard.
À la question « Pourquoi des pays comme la Hongrie ou la Pologne développent-ils des penchants autoritaires plus caractéristiques de leur propre passé que de l’avenir qui pourrait être le leur ? », Anne Applebaum répond : « Se montrer pessimiste vis à vis de l’idée d’Europe est quelque chose d’irresponsable. On ne peut esquisser un avenir à ce point déprimant pour la jeunesse ».
Mónica et Anamely sont parties, il paraît qu’elles avaient posté des messages d’adieu sur Facebook. Omara aussi. Moi, je me connecte à peine. Une ou deux fois après le 27N, pour envoyer des documents à ma fille, partager quelque chose sur mon mur – il est irresponsable de s’éloigner de tout dans des moments pareils – ou pour répondre à un ami à Miami.
Lui, il me dit : de quoi tu as besoin ? Demande-moi n’importe quoi. « N’importe quoi », il dit. Une fois. Deux fois. Miami ne tient pas dans une valise – le monde encore moins – je me dis, mais qu’est-ce que je ne donnerais pas pour des feuilletés à la goyave et au fromage, pour des croquettes au jambon et un sandwich cubain de La Carreta ou du Versailles, pour un Toblerone, pour une bière brune…
Il y a trente ans de ça, à l’époque où j’étudiais à l’Institut Supérieur d’Art, j’avais l’habitude garder des friandises et des chocolats pour une sœur que je n’ai plus…
Je n’ai toujours pas présenté mes condoléances à Rosa.
Je n’ai même pas répondu à son message, six mois avant la tragédie.
« Quel coup, quel bruit est assez fort pour en finir avec une vie ? »
J’ai écrit cela il y a quelques jours – un mois déjà ? – sur une ébauche de je ne sais plus quoi. Je crois que c’était au moment où j’ai vu comment ils portaient son corps de la plage à l’ambulance, enveloppé dans une couverture. Je me disais: « Elle doit avoir froid, là-dedans », « Sa cigarette au bout des doigts, elle doit lui manquer ». Je l’ai imaginée mouillée, en train de frissonner, la bouche crispée comme quand elle se rongeait les ongles, comme si elle avait de toutes petites dents. Et pendant ce temps, la présentatrice du journal télévisé de Miami annonçait: « C’est au petit matin que l’on a retrouvé le corps sans vie… ».
Ce sont les hommes qui nous ont séparées. Nous les avons laissés faire ça. De là à imaginer une mort à contretemps… À croire que n’importe quel temps est bon pour mourir.
J’ai en tête une image d’elle, qui se répète. Une image d’elle en train d’entrer dans le hall de la maison, les jours de fête. Elle porte toujours la même longue chemise beige, les mêmes sandales à talons hauts carrés – parfois celles avec une fleur sur les orteils – et le collier africain que je lui avais offert, celui avec les perles en métal (mes cheveux s’y accrochaient dans la nuque, alors qu’elle, elle portait les cheveux courts depuis longtemps). Un collier énorme, genre Joséphine Baker, qui lui faisait deux fois le tour. Derrière, Jorge, avec son béret, le pull noué autour du cou, une bouteille et des cadeaux. Tous les deux ont toujours aimé faire des cadeaux, faire plaisir.
Rosa, j’ai toujours sur ma table de chevet la petite boîte d’allumettes en bois qu’elle m’avait ramenée quand elle était allée te voir à Los Angeles. Une petite boîte ornée de traits fins, rouges et dorés. Avec une adresse – un souvenir – de Bukowski – elle savait que j’aimais Bukowski, que j’étais en train de le lire, ce n’était pas n’importe quel cadeau – et aussi une phrase, je crois, mais je l’ai effacée sans faire exprès en passant dessus un chiffon humide pour enlever la poussière.
De même que j’ai effacé, l’autre jour, une photo de ma fille sur un cœur en céramique, sur la même table, à côté de petites boîtes en papier et en bois, d’étuis métalliques et de pierres que j’ai ramenées de El Cobre, de la lagune El Venado à Topes de Collantes, de Versailles et de Teotihuacán ; des livres que je lis et que je ne remets jamais en place dans la bibliothèque, dont deux de Marcelo Morales, deux de Sigfredo Ariel, et une édition de Fuera del juego incluant les déclarations de l’Union nationale des écrivains et artistes de Cuba (UNEAC) et l’auto-critique de Heberto Padilla ; des coquillages et encore des pierre – cadeaux de Jamila et Soleida – et l’exemplaire de Días de entrenamiento qu’Ahmel m’avait offert pour que je tombe amoureuse de lui, quand lui était déjà tombé amoureux de moi.
Tous les jours, je passe la main sur cette petite table, comme la grand-mère psychotique de Demonios en el jardín.
Je passe mon doigt sur la tranche des livres empilés dans le salon, pleins de poussière sur le banc en bois. J’essaie sans entrain de faire ce qui ressemble à du ménage.
Cette maison a été ma plus grande « œuvre ».
Je n’aime pas le mot « œuvre » pour faire référence à mon travail. Je ne l’utilise jamais, mais là, je ne trouve rien de mieux. Et puis on n’a plus le temps de s’arrêter là-dessus. Quand je dis « grande », je veux parler de la taille, bien sûr.
Je flâne, je reviens sur mes pas, j’ouvre les livres un par un, en fonction de la couverture, de l’auteur. Surtout la couverture, comme quand on ouvre un magazine par la fin, par la planche de BD : « Voici l’enfant. Il est pâle et maigre, sa chemise de toile est mince et en lambeaux. Il tisonne le feu près de la souillarde », « Ils allaient, ils allaient toujours, et lorsque cessait le chant funèbre on croyait entendre, continuant sur leur lancée, chanter les jambes », ou « Tout commença le jour où monsieur Mustarde reçut un colis de l’étranger ».
Parfois une dédicace – parfumée – dans une édition de Méridien de sang de Cormac McCarthy offerte à Ahmel: « Pendant que je cherchais mon trésor, tous les jours ont été lumineux parce que je savais que chaque heure faisait partie du rêve de le trouver, Paulo Coelho, L’Alchimiste.«
… Deux cents ans de poésie cubaine
Lorenzo García Vega, Lo que voy siendo
Noam Chomsky dans La Jornada
Néstor Díaz de Villegas, Sabbat Gigante, libro segundo
Alexandr Yakovlev, Le sens de ma vie
Vie supérieure des insectes…

Carta de despedida para llegar a ninguna parte (Lettre d’adieu pour aller nulle part), Cirenaica Moreira, 2020
J’aimerais savoir quelle est la formule que le gouvernement me réserve pour ne pas me « délaisser » ; pour ne pas délaisser ceux qui, comme moi, n’ont ni salaire ni retraite, pourtant nous ne sommes pas des « fainéants », comme ils adoreraient sûrement nous appeler, comme ils nous ont déjà appelés (et comme ils nous appellent, sans motif, parce qu’ils ne peuvent contrôler cette pulsion qui leur vient des années soixante, soixante-dix, quatre-vingt). Presque un an après l’inauguration de la pandémie à Cuba, un mois avant la mise en place de la Tarea Ordenamiento (Objectif Redressement, ou réforme monétaire), ce n’est pas clair dans ma tête.
Ce n’est pas clair non plus pour mes amis et ma famille, pour les créateurs indépendants, les travailleurs à leur compte ou les entrepreneurs, pour nous – sans entrer dans les détails – dont les sources de revenus sont principalement liées au tourisme, nous qui survivons aujourd’hui en faisant fondre nos économies et en nous endettant. Comme n’importe quel citoyen du monde qui a perdu son travail et à qui le gouvernement n’annonce pas fièrement qu’il fait tout ça pour le mettre à l’abri, non, il le met à l’abri, point, ou bien il le met à la rue.
Aujourd’hui, je l’ai vue passer à côté de moi sans s’arrêter, elle était au bras d’un homme chauve, ce n’était pas Jorge. Un peu plus maigre, mais je suis sûre que c’était elle.
La NASA confirme confirme qu’il y a bien eu de la vie sur Mars ; que là où il y a un cratère, il y a eu un fleuve, un lac, un océan…
À moins que ce soit un reportage bidon ?
Cirenaica Moreira
La Havane, 27 janvier 2021
 Après des études de théâtre à l’Institut supérieur d’art de La Havane, Cirenaica Moreira (La Havane, 1969) s’est orientée vers la création visuelle. Son œuvre se situe à la croisée de différents champs, principalement la photographie, l’installation et la performance. Elle vit et travaille à La Havane.
Après des études de théâtre à l’Institut supérieur d’art de La Havane, Cirenaica Moreira (La Havane, 1969) s’est orientée vers la création visuelle. Son œuvre se situe à la croisée de différents champs, principalement la photographie, l’installation et la performance. Elle vit et travaille à La Havane.
La version originale en espagnol de ce texte a été publiée dans la revue Hypermedia magazine le 27 janvier 2021.





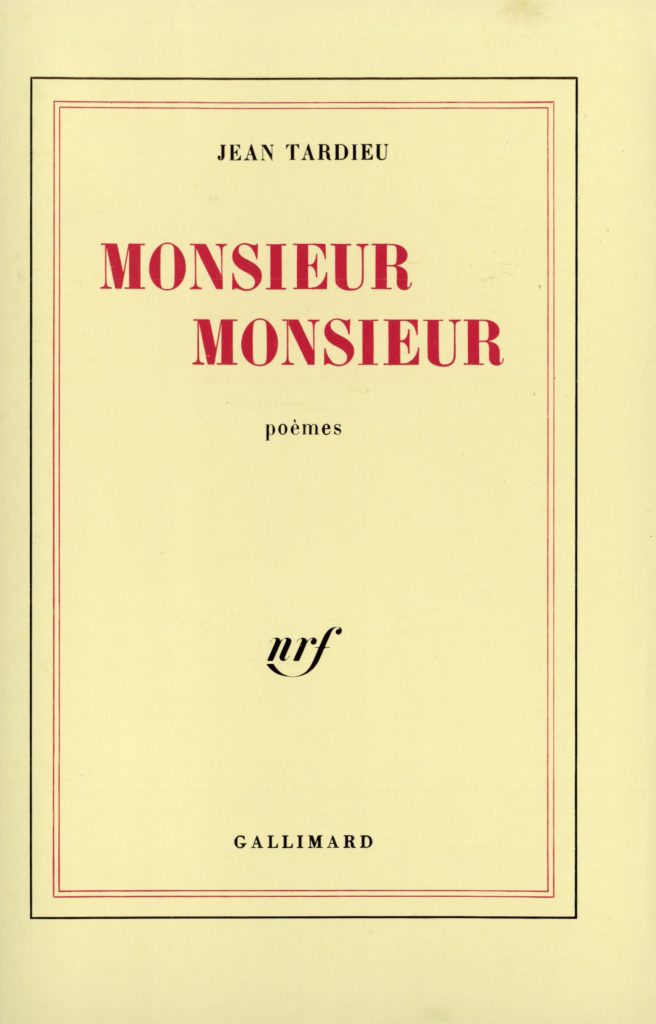

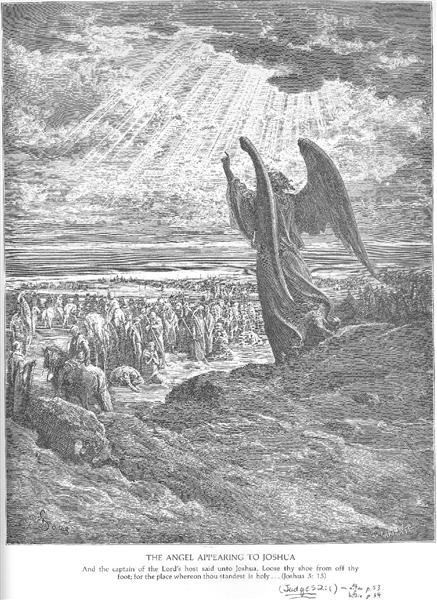


0 commentaires