 Dans le catalogue de l’exposition Sergueï Eisenstein, L’œil extatique, qui a fermé ses portes fin février au Centre Pompidou de Metz, la commissaire Ada Ackerman nous livre quantité d’informations sur la vie et l’œuvre de Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein (1898-1948) ainsi qu’un passionnant entretien avec Naoum Kleïman, l’ancien directeur de la cinémathèque de Moscou, spécialiste du cinéaste.
Dans le catalogue de l’exposition Sergueï Eisenstein, L’œil extatique, qui a fermé ses portes fin février au Centre Pompidou de Metz, la commissaire Ada Ackerman nous livre quantité d’informations sur la vie et l’œuvre de Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein (1898-1948) ainsi qu’un passionnant entretien avec Naoum Kleïman, l’ancien directeur de la cinémathèque de Moscou, spécialiste du cinéaste.
Kleïman, qui a fait ses études à l’Institut d’État de la cinématographie à la fin des années cinquante, avait au départ « pour héros » Dziga Vertov, dont il admirait le Kino-Glaz. Il dit n’avoir saisi l’importance d’Eisenstein que lorsqu’il découvrit la deuxième partie d’Ivan le Terrible, qui ne fut autorisée en Russie qu’en 1958 : « Je n’arrivais pas à croire qu’il fût possible de créer un tel film dans l’Union soviétique de Staline. »
Grâce aux contributions de François Albera et Antonio Somaini, on apprend qu’Eisenstein ne s’entendait pas vraiment avec Dziga Vertov, l’autre géant d’un cinéma soviétique ne manquant pas de créateurs. Le film de jeunesse d’Eisenstein, Le Journal de Gloumov (1923), court métrage devant être projeté en prélude à la pièce de théâtre Le Sage, d’Alexandre Ostrovski, mise en scène par Eisenstein, fut supervisé par Vertov qui quitta le tournage sans qu’on sache trop pourquoi.
Fut-il contrarié par l’insouciance de la jeune troupe de disciples indisciplinés de Vsevolod Meyerhold qui ne respectaient ni le cadre solennel de l’académie militaire où le film fut tourné, ni la religion ou les bonnes mœurs, toutes deux moquées dans des noces de travestis ? Fut-il courroucé par le côté potache de l’argument ? Ou tout simplement appelé ailleurs par des tâches importantes ou urgentes ? Eisenstein ouvre l’opus en saluant en gros plan les spectateurs. Son futur assistant, Grigori Alexandrov, tient le rôle de Goloutvine, un monte-en-l’air en tenue de Fantomas. Eisenstein qualifia le film d’« attraction », le mot conservant son sens théâtral de divertissement ou de complément de spectacle avant de devenir un concept-clé de sa théorie du montage cinématographique. Cette pantomime filmée était censée traduire le « monologue intérieur » du héros de la pièce, ce qui ne paraît pas du tout évident pour le spectateur d’aujourd’hui. Toujours est-il que la brève « attraction » d’Eisenstein ouvrit le champ du « multimédia » et de ce qu’on appela dans les années 1970 l’« expanded cinema », anticipant même sur l’Entr’acte de Francis Picabia et René Clair qui servit d’intermède au ballet Relâche (1924).
Les rapports entre Vertov et Eisenstein s’envenimèrent surtout après le succès du long métrage de ce dernier, La Grève (1924). Le premier accusa son cadet (de deux ans seulement) de l’avoir plagié en mixant réel et fiction dans un « ciné-vodka » nuisible pour le prolétariat ! Eisenstein lui répondit qu’il ne pratiquait pas un « ciné-œil » à l’« impressionnisme primitif » mais un « ciné-poing » capable de « fendre les crânes »…
Ces querelles débordent le cadre esthétique de deux réalisateurs marqués, l’un, par le futurisme, l’autre, par le constructivisme. Elles montrent leur détermination sinon leur ambition. Il est de fait que, pour vivre, ou pour survivre, Eisenstein suivit la « ligne générale » du parti, laquelle, avec le « réalisme socialiste », tourna le dos au « formalisme ». Ackerman minimise, en le qualifiant d’idéologique, le jugement porté par Alexandre Soljénitsyne sur le cinéaste complice du stalinisme dans Une journée d’Ivan Dénissovitch (1962) : « Ne me parlez pas de génie. Dites que cet homme est un valet, qu’il a accepté une besogne dégradante, mais ne le traitez pas de génie : un génie n’accommode pas ses œuvres au goût des tyrans. »
Grâce à son amitié avec Pera Atacheva, la veuve d’Eisenstein, Kleïman put avoir accès à ses documents de travail, aux dessins concernant le film Que Viva Mexico !, aux esquisses d’Ivan le terrible ainsi qu’aux archives que lui avait confiées Meyerhold. Une photo dédicacée par ce dernier en 1936 à son disciple porte la mention suivante : « Je suis fier de l’élève qui est devenu un maître. J’aime le maître qui a créé une école. À cet élève, à ce maître, Sergueï Eisenstein, mon admiration. » Le cinéaste écrivit de son côté : « Je n’ai jamais autant aimé personne, autant adoré, autant vénéré personne que mon maître… Je ne suis pas digne de dénouer les courroies de ses sandales, bien qu’il portât des bottes de feutre dans les ateliers de mise en scène non chauffés du boulevard Novinski. » Selon Kleïman, Eisenstein n’avait pas ce caractère « didactique » qui lui colla longtemps à la peau. Même s’il fut mandaté par Staline pour aller étudier avec Alexandrov et Tissé les techniques du cinéma sonore en Europe puis aux États-Unis, espérant sonoriser son film La Ligne générale suivant les principes a-synchroniques et contrapuntiques du manifeste sur le Contrepoint orchestral qu’il rédigea en 1928 avec Alexandrov et Poudovkine. Ses voyages en Occident n’ont rien de touristique et visent à une mise à niveau technique du cinéma soviétique – on pourrait parler d’espionnage industriel – tout en gagnant à la cause du peuple russe artistes et intellectuels d’autres pays.
Rappelons en passant que l’historienne de l’art Oliva Maria Rubio a récemment révélé dans son livre sur El Lisstzky que le peintre suprématiste collabora avec la Tchéka qui lui facilita ses déplacements entre Moscou, Berlin, Leyde et Zurich. Le tour européen puis américain d’Eisenstein ne fut pas seulement « autorisé » par les autorités soviétiques : il fut commandé ou commandité par Staline.
En 1929, invité avec Grigori Alexandrov et Alexandre Tissé au Premier congrès international du cinéma indépendant, à La Sarraz, en Suisse, par la mécène Hélène de Mandrot, il fut reçu comme le prophète par les participants – Béla Balázs, Alberto Cavalcanti, Léon Moussinac, Jean-Georges Auriol, Hans Richter, Walter Ruttmann, etc. L’année suivante, à Paris, le préfet réactionnaire Jean Chiappe interdit la projection de La Ligne générale (1929) mais Eisenstein put réaliser son premier film sonore, une « étude cinématographique » intitulée Romance sentimentale (1930), au studio Éclair d’Épinay, avec le procédé allemand Tobis-Klangfilm, tirant profit d’effets bruitistes, à la manière du Ruttmann de Wochenende (1930), cinq ans avant les cinéphonies que produisit Émile Vuillermoz avec le procédé sonore Western Electric des studios Paramount de Saint-Maurice.
La major américaine lui signa un contrat à durée limitée et l’invita à Hollywood. Si aucune réalisation n’aboutit avec la Paramount, Eisenstein obtint d’Upton Sinclair, écrivain de gauche, de financer un projet de « documentaire » sur le Mexique. Le film resta inachevé, le tournage de plus d’un an ayant explosé le budget, et Amkino, organisme soviétique établi aux États-Unis, ayant cessé de soutenir le projet. Staline rappela le trio Alexandrov-Tissé-Eisenstein qui cherchait à faire durer le plaisir en pays aztèque ; il mit un terme à l’aventure, traitant même le cinéaste de « déserteur » dans un télégramme au camarade Sinclair. Exhumé et monté dans les années 1970, Que Viva Mexico ! reste l’une l’une des œuvres les plus fascinantes du cinéaste pour qui ce tournage représenta « l’époque la plus extatique de [sa] création. »
Nicolas Villodre
Cinéma



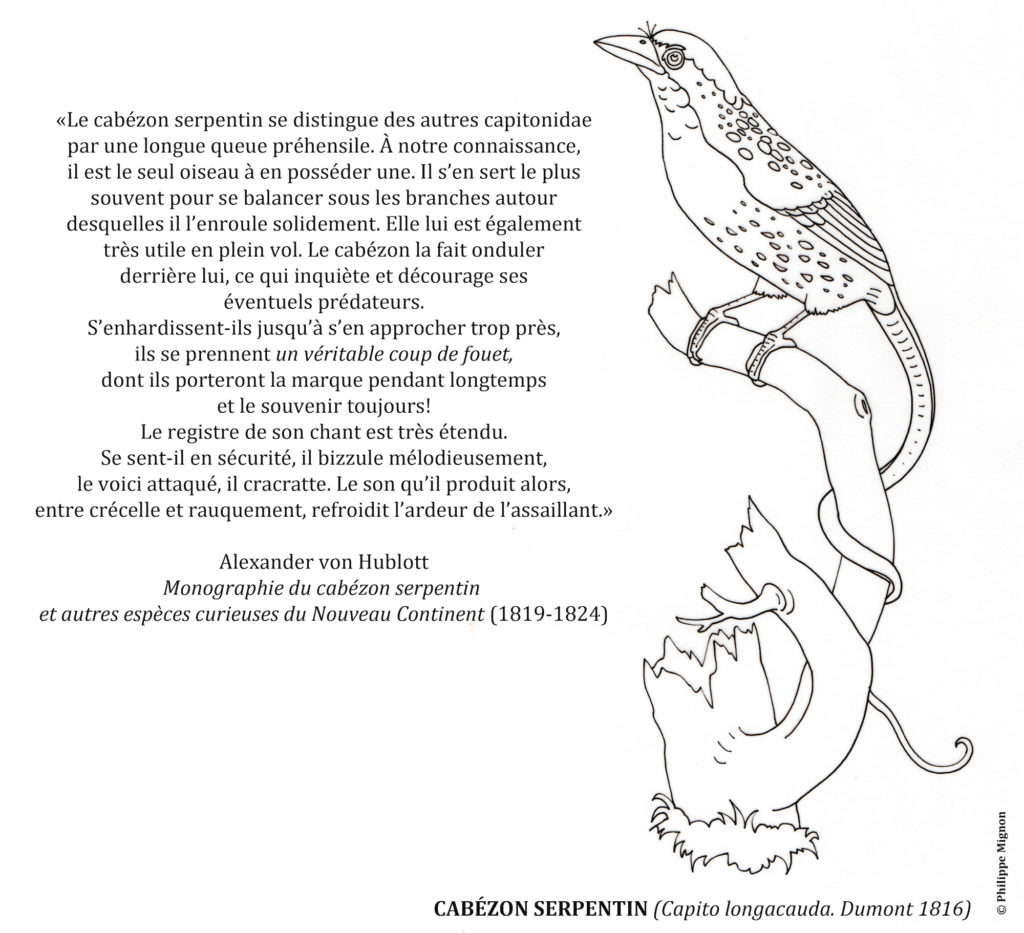






0 commentaires