Et encore un marathon organisé par Julien Gosselin. Même lieu : la FabricA au Festival d’Avignon. Même noyau d’acteurs (les fidèles de la compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur). Deux ans après l’adaptation de 2666, le roman fleuve de Roberto Bolaño (et cinq ans après sa traversée des Particules élémentaires de Michel Houellebecq), le metteur en scène lillois replonge en littérature. Difficile de lui reprocher ses goûts en la matière : l’Américain Don DeLillo est l’un des grands romanciers de la fin du XXe siècle. « Les histoires qu’il raconte, explique-t-il, les hommes et les femmes qu’il décrit, semblent emportés par le mouvement global de de l’Histoire politique mais aussi et surtout par des phénomènes inexplicables. La peur, le doute, l’ennui, l’impossibilité de l’amour : DeLillo rend à ces phénomènes vécus par tous leur part de mystère, les relie à l’Histoire, aux guerres, aux archaïsmes les plus violents et les plus purs. »
Gosselin ne fait pas dans la demi-mesure : il s’attaque à trois des romans majeurs de l’écrivain (sans compter une nouvelle, donnée en interlude, et une séquence rejouée de La Chinoise de Godard), soit en tout une bonne dizaine d’heures. On retrouve sa marque de fabrique et ses défauts, notamment une propension à trop monter le son – comme si ses acteurs confondaient véhémence et conviction – et à saturer les basses – comme si le bourdonnement aux oreilles était un marqueur d’émotion. Les qualités sont là aussi, et d’abord la capacité à transformer des romans en récits – il y a du conteur chez Gosselin – et à embarquer son monde sans l’ennuyer. On retrouve également une utilisation intensive de la vidéo – avec une qualité des images en nette amélioration par rapport à 2666.
Mais le metteur en scène ne se contente pas de reprendre les mêmes recettes que pour le roman de Bolaño. Gros succès public, l’adaptation de 2666 avait pour principal défaut de lisser les choses. Sa lecture du roman était à la fois réductrice et redondante, soucieuse de ne jamais lâcher le fil des événements, comme s’il ne fallait surtout pas se perdre dans le labyrinthe. Cette fois, Gosselin semble avoir accepté l’idée que l’écriture de DeLillo résiste à l’élucidation. Moins maîtrisé, inégal, son spectacle est aussi plus intéressant, même s’il n’est pas sûr qu’il plaise autant. C’est aussi que les fils narratifs sont moins faciles à suivre, non seulement entre les trois romans que rien ne relie a priori (même si la question du terrorisme y est centrale), mais aussi à l’intérieur de chacun, tant le style de DeLillo, riche en ellipses et surtout en silences suppose des lecteurs qui acceptent de s’égarer en chemin.
Dans Joueurs, l’auteur imagine un attentat au World Trade Center de New York dans les années 1970, Mao II évoque le destin d’un poète retenu en otage au Liban, Les Noms suit la piste d’une secte criminelle au Moyen-Orient. Inutile pour autant d’exagérer la dimension prémonitoire ou oraculaire de l’auteur. Le monde dont parle DeLillo n’est plus celui d’aujourd’hui et Gosselin ne cherche pas à l’actualiser. Il essaie plutôt d’organiser la circulation entre l’intérieur (des personnages, des romans) et l’extérieur (le monde, les spectateurs). La scénographie d’Hubert Colas s’attache à représenter ce dehors et ce dedans. C’est une boîte fermée – un grand livre – qui ne s’ouvre que parcimonieusement, presque un bunker, même quand il finit par se transformer en grande cage vitrée. Et les acteurs sont moins face au public qu’à eux-mêmes. On ne comprend pas tout – voire presque rien parfois – et c’est aussi bien. Mais on se retrouve au cœur du livre. Il y a une heure formidable dans Mao II : le récit de la visite d’une photographe chez un écrivain qui vit reclus quelque part au fond des bois et refuse tout contact avec l’extérieur. L’écrivain parano s’appelle Bill Gray et est un double de J.D. Salinger. C’est Frédéric Leidgens qui l’interprète et toute la séquence est un régal d’humour, de mélancolie, de cruauté, de complexité.
René Solis
Théâtre
Joueurs, Mao II, Les noms. Texte : Don DeLillo, traduit par Marianne Véron et Adelaïde Pralon, adaptation et mise en scène Julien Gosselin, scénographie Hubert Colas, avec Rémi Alexandre, Guillaume Bachele, Adama Diop, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron, Alexandre Lecroc Lecerf, Frédéric Leidgens, Caroline Mounier, Victoria Quesnel, Maxence Vandevelde. La FabricA, du 7 au 13 juillet 2018. Le spectacle est notamment repris à l’Odéon à Paris du 17 novembre au 22 décembre, dans le cadre du Festival d’Automne.
Photos © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon




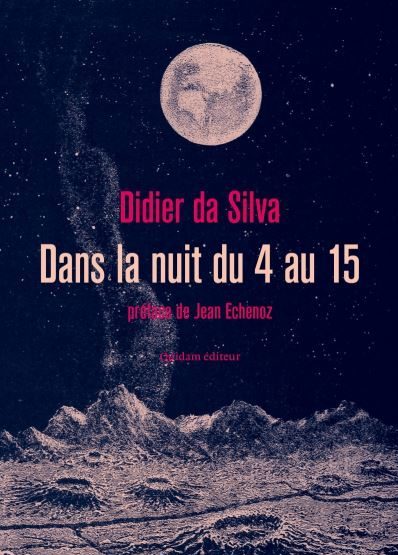
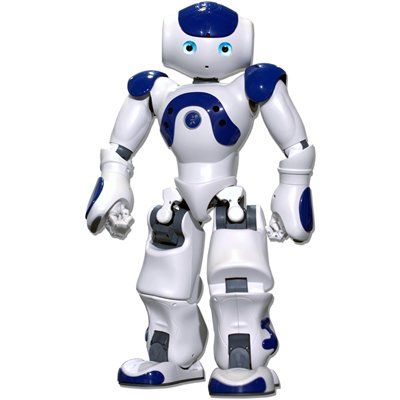





0 commentaires