 Tiens, ce sont peut-être les cerisiers de la cerisaie, ces arbres en tubulure d’inox, d’où pendent des grappes de lustres. À moins qu’ils ne soient figurés par ce dédale de chaises qui avancent en pointe jusqu’au bord de la scène (rappel de la création de la pièce à Avignon en juillet dernier où 150 des anciens sièges occupaient le plateau de la Cour d’honneur). Absente en tout cas la cerisaie comme l’imaginait Tchékhov et comme l’évoquent les personnages de la pièce – cerisiers en fleur au mois de mai, sansonnets qui chantent, gelée blanche. Absente comme dans la récente mise en scène de Clément Hervieu-Léger, à la Comédie-Française. Il faudra faire avec, ou plutôt sans.
Tiens, ce sont peut-être les cerisiers de la cerisaie, ces arbres en tubulure d’inox, d’où pendent des grappes de lustres. À moins qu’ils ne soient figurés par ce dédale de chaises qui avancent en pointe jusqu’au bord de la scène (rappel de la création de la pièce à Avignon en juillet dernier où 150 des anciens sièges occupaient le plateau de la Cour d’honneur). Absente en tout cas la cerisaie comme l’imaginait Tchékhov et comme l’évoquent les personnages de la pièce – cerisiers en fleur au mois de mai, sansonnets qui chantent, gelée blanche. Absente comme dans la récente mise en scène de Clément Hervieu-Léger, à la Comédie-Française. Il faudra faire avec, ou plutôt sans.
Pas le temps de mélancoliser, voici déjà que débarque le vieux monde, la « complexe, extravagante et lunaire » aristocrate Lioubov, Gaïev, son cinglé de frère, sa fille Ania. Lioubov, on le sait, revient dans son domaine après cinq années d’absence, elle vient retrouver sa Cerisaie, sa « chère aïeule », lieu idyllique et maudit – son fils de sept ans s’y est jadis noyé. Les affaires ne vont pas fort, la propriété sera vendue, à moins que Lioubov n’accepte de la transformer en lotissements et d’y construire des datchas pour la nouvelle génération d’estivants. Lopakhine, le fils de moujik devenu un riche marchand, lui met le marché en main. Lioubov, qui trouve l’idée « vulgaire », occupera trois actes à éluder, divaguer, procrastiner. On sait tout cela, Jean-Louis Barrault avait en son temps pitché l’affaire, on n’a pas fait mieux depuis : « Premier acte, la Cerisaie risque d’être vendue ; deuxième acte, la Cerisaie va être vendue ; troisième acte, la Cerisaie est vendue ; quatrième acte, la Cerisaie a été vendue. »
Quel parti Tiago Rodrigues prend-il ? Celui d’abattre le quatrième mur (pas de lever de rideau, et Lopakhine, d’emblée, à l’avant-scène, au public : « la première phrase de cette pièce, c’est… ») ; de sortir de son sac à malices un duo de musiciens (Manuela Azevedo et Helder Gonçalves) qui glissent sur une plateforme et composent un chœur rock qui commente l’action (« finalement arrivés ici pour toujours / oh de retour pour toujours ») ; de s’emparer de tout ce qui se trouve effectivement dans la pièce de Tchékhov, mais en relatif retrait – musique, danse, magie – et de le porter au premier plan. Le metteur en scène portugais a bien vu ce qu’il y a d’élisabéthain dans La Cerisaie, la plus heurtée, la plus frénétique, la plus épileptique des pièces de l’auteur russe. Les références à Hamlet y sont nombreuses. « Ophélie, entre au couvent », lance Lopakhine à Varia. Epikhodov rumine : « Je n’arrive pas à saisir la direction de mes pensées ? Qu’est-ce que je veux au juste : vivre, ou me faire sauter la cervelle ? » On songe à Lautrémont : « Chaque fois que j’ai lu Shakespeare, il m’a semblé que je déchiquète la cervelle d’un jaguar. » Tom Adjibi, dreadlocks au vent et guitare-mandoline en main, compose un Epikhodov bouffon à souhait, qui n’hésite pas à remonter ostensiblement une braguette débraguettée, c’est farce, presque du stand-up.
Le cap baroque étant fixé, grand déploiement de scénographie, à rebours du naturalisme du théâtre stanislavskien comme du classicisme d’un Françon, qui monta La Cerisaie en 2008. Le plateau s’étage en profondeur sur trois niveaux, striés par des rails de travelling par où arrivent musiciens et décors. Les personnages s’y échelonnent aussi, sur ces trois niveaux, s’approchant et reculant, selon leur place dans l’action.
Dans ce très grand cadre, les acteurs composent, selon le vœu de Tiago Rodrigues, « une choralité subtile, constituée de solos ». Ils existent collectivement, parfois chorégraphiquement : à mi-parcours, ils dansent tous, sur un air mélancolique, une danse minimale, lente, latérale, d’un pied sur l’autre. Qu’est-ce que cela veut dire ? « La vie passe sans faire attention à nous » (Lopakhine) ? Peut-être.
 En solo, Isabelle Huppert, pour qui Tiago Rodrigues a monté la pièce, survole la distribution. Tantôt assise, au centre et au premier plan, comme absente (« Est-ce vraiment moi qui suis ici ? »). Tantôt voletant, pilant net, repartant, secouée de rires secs, sauterelle hystérique, ou plutôt : araignée d’eau aux dribbles courts et virages imprévisibles. Elle est parfaite dans ce rôle de Lioubov, le plus dostoïevskien des personnages de Tchékhov.
En solo, Isabelle Huppert, pour qui Tiago Rodrigues a monté la pièce, survole la distribution. Tantôt assise, au centre et au premier plan, comme absente (« Est-ce vraiment moi qui suis ici ? »). Tantôt voletant, pilant net, repartant, secouée de rires secs, sauterelle hystérique, ou plutôt : araignée d’eau aux dribbles courts et virages imprévisibles. Elle est parfaite dans ce rôle de Lioubov, le plus dostoïevskien des personnages de Tchékhov.
Adama Diop, en costard trois-pièces mauve et cravate verte, campe un fier et digne Lopakhine, convaincant dans ses rageurs accès de triomphe (« Seigneur, mon Dieu, elle est à moi La Cerisaie ! ») Riche idée d’avoir choisi un comédien noir pour incarner un personnage qui finit par acheter une propriété où son père et son grand-père « n’étaient que des esclaves ». L’idée aurait été plus forte s’il avait été le seul acteur noir, me souffle mon contradicteur ; les filles et le frère de Lioubov, a priori slaves et pâles, sont aussi incarnés par des comédiens noirs. « C’est une convention théâtrale, on l’accepte très bien. – Un metteur en scène qui confierait aujourd’hui à un comédien blanc le rôle d’Othello, est-ce qu’il ne recevrait pas une volée de bois vert ? – Je trouve ça bien que le théâtre fasse ce que le cinéma peut plus difficilement faire. C’est une réparation historique, politique. – Le théâtre est un art de l’incarnation, donc aussi de la carnation. Il me paraît plus judicieux d’avoir choisi, pour la gouvernante Charlotta, une comédienne, Isabel Abreu, qui parle avec un accent portugais. – Pourquoi ? – Parce que Charlotta est une orpheline qui n’a connu ni son père ni sa mère, elle ne sait pas d’où elle vient et qui elle est. C’est dans le texte. – Littéraliste borné ! – Wokiste binaire ! » Je congédie mon contradicteur. Parfois, il m’épuise.
C’est qu’il n’a pas tout à fait tort : la distribution United Colors, à quoi s’ajoute l’absence de la Cerisaie, personnage central, rend la mise en scène un peu abstraite, hors-sol. Barrault encore : « Cette pièce n’appartient ni au naturalisme, ni même au réalisme, elle appartient à la vérité. C’est, si l’on veut, du réalisme poétique, comme dans Shakespeare ». Ici, l’attache réaliste est ténue, la psychologie évacuée. Huppert-Lioubov pleure son fils noyé, mais casse aussitôt l’émotion par une extravagance. Le tremblement, les larmes sous les rires, la confidence, on n’a pas tout cela (certes, il faut porter fort la voix sur l’immense plateau de l’Odéon, pour ses 800 spectateurs).
Ces réserves faites, la proposition de de Tiago Rodrigues est forte, claire et cohérente. Audacieuse aussi, et l’on se souvient que la première pièce qu’il a jouée, il y a plus de vingt ans, c’était Platonov, avec l’impertinent collectif Tg Stan. Le soir de la première, les applaudissements sont nourris. Pour la performance d’ensemble, bien sûr, mais en particulier pour Isabelle Huppert. Quand elle dit adieu à la Cerisaie, elle nous regarde et on tressaille. Un adieu, vraiment ?





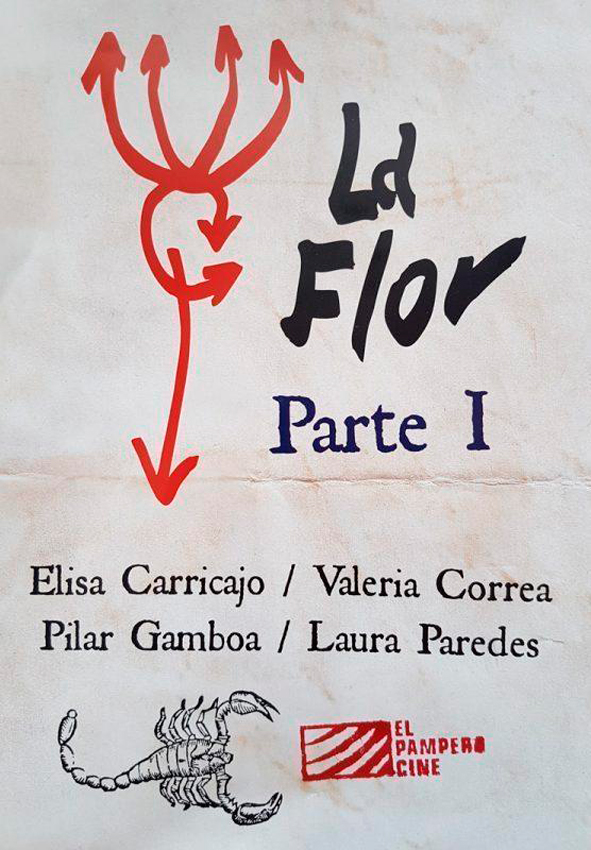





0 commentaires