Lu sur Twitter : “Dans 10 ans, si on vous demande au Trivial Pursuit de donner la date de décès d’un artiste, essayez 2016 !” Il est vrai que ce début d’année est particulièrement endeuillé, ce qui, eu égard aux statistiques et au baby-boom de l’après-guerre, s’explique aisément. L’hécatombe devrait donc se poursuivre. Pour autant, ces décès en cascade nous permettent d’étudier d’un peu plus près le traitement médiatique des morts d’artistes.
Prenons tout d’abord les cas de Pierre Boulez et de David Bowie, disparus à cinq jours d’intervalle, respectivement les 5 et 10 janvier derniers. Cela nous permet de mesurer la différence entre celui que personne n’a écouté vs celui que tout le monde a écouté. J’exagère à dessein, pour les besoins de la démonstration, mais à peine, à vrai dire. Confrontée à la perte d’un acteur majeur de la musique savante du XXe siècle, la presse française s’est sentie obligée de lui accorder une place très importante, mais la teneur générale des articles semblait surtout une justification de cette place, les journalistes expliquant à leurs lecteurs qui était Pierre Boulez, et quelle trace indélébile il laisserait dans l’histoire de son art. Si l’intention était louable, la comparaison avec les articles anglo-saxons montraient combien la presse française restait respectueuse mais distante, là où les Allemands et les Nord-Américains manifestaient une forme d’affect envers le compositeur et chef d’orchestre, ce qui a pu paraître étrange, vu de l’Hexagone. À l’inverse, c’est bien l’affect qui a dominé tous les articles consacrés à la disparition de David Bowie, comme si chaque critique, chaque journaliste, chaque personne avait perdu un proche, ce qu’était au fond le musicien anglais, qui a accompagné la vie de millions d’individus à travers le monde pendant près de cinquante ans.
Côté cinéma, j’avoue avoir été surpris que Jacques Rivette fasse la Une de Libération, car même si le service cinéma du quotidien compte encore de véritables cinéphiles, la politique éditoriale du journal semble s’être terriblement éloignée du monde des arts et de la culture dans ses aspects les plus auteuristes. La disparition de Rivette, signalée sur nombre d’antennes télévisuelles, se limitait côté illustration à quelques plans d’Emmanuelle Béart entièrement nue dans La Belle noiseuse. Je me risquerai ici à dire que, faute de ces plans, issus d’un film à maints égards passionnant, la mort du cinéaste n’aurait peut-être même pas été annoncée à la télévision. Autre bizarrerie, la mort d’Ettore Scola, qui fut pourtant un cinéaste ayant réussi l’alchimie entre le populaire et l’exigence, fut beaucoup moins bien traitée que celle d’Andrzej Zulawski. Je crains là encore que les années que Sophie Marceau partagea avec le réalisateur polonais ne soient pas étrangères à ce traitement de faveur.
Dans le domaine des arts plastiques, la place médiatique est généralement infime. La mort très récente d’Ellsworth Kelly, le dernier géant américain des arts plastiques du XXe siècle, aura occupé peu de colonnes, et celle de Gottfried Honegger a fait l’objet, au mieux, de brèves. La jeune artiste franco-marocaine Leila Alaoui, morte à 33 ans dans l’attentat de Ouagadougou, a suscité un véritable émoi, bien légitime, et de nombreux articles, mais fort peu de gens s’étaient intéressé à son travail, exposé encore tout récemment à Paris. Le destin tragique l’a emporté sur le talent bien réel de la plasticienne.
Populaire et exigeant, écrivais-je à propos de Scola, et cela convient bien également à Umberto Eco, certes popularisé par l’adaptation cinématographique du Nom de la Rose. Au moins ce film aura-t-il permis à un très vaste public de s’intéresser à ce véritable érudit qui savait communiquer ses nombreuses passions. Il est peut-être l’exception qui confirme la règle d’un traitement médiatique qui, on l’aura vu, tient plus souvent de la loterie que d’une reconnaissance proportionnelle au talent ou à l’empreinte laissée par ces artistes.
Arnaud Laporte
[print_link]






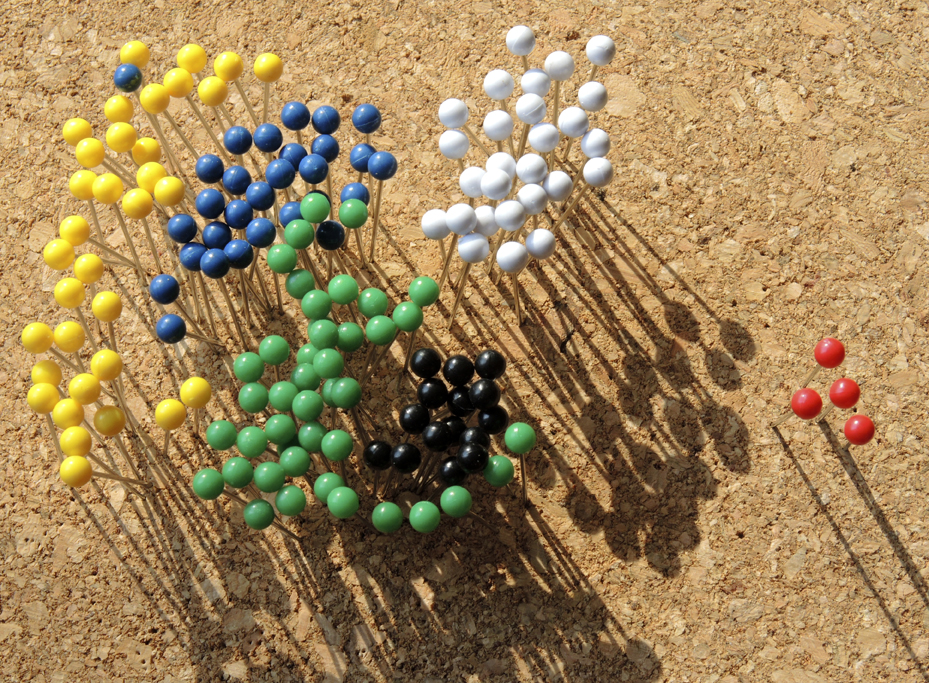

0 commentaires