Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
Victoire des droites dures en Europe, guerres sans fin au Moyen-Orient, résurgence du protectionnisme aux États-Unis, corruption des élites politiques un peu partout dans le monde : le tableau de notre époque n’est guère reluisant. Peut-on donc encore croire au progrès ?
L’idée de progrès, au sens où nous l’entendons aujourd’hui, c’est-à-dire débarrassée de ses oripeaux religieux (la croyance en la divine providence), n’est pas une idée très ancienne. Elle apparaît, comme l’idée d’opinion publique, au XVIIIe siècle dans le cadre de la philosophie des Lumières, avec Kant en Allemagne et Condorcet en France. Elle est contemporaine d’une réflexion sur l’histoire universelle de l’humanité.
Kant estime ainsi que l’humanité est en marche. Il en veut pour exemple la Révolution française en laquelle il voit un signe, non une preuve cependant, de la réalité du progrès. Mais où allons-nous ? vers quel but nous dirigeons-nous ? Dans l’idéal des Lumières, ce but ne peut être que l’émancipation des peuples de la double tutelle de la tyrannie et de la religion. Le progrès de l’humanité réside dans sa sortie de la « minorité ». Les hommes sont appelés à se servir de leur propre entendement afin de vivre sous l’autorité des lois plutôt que sous la tutelle d’un maître. Le progrès essentiel est donc pour Kant un progrès du droit. L’idée de progrès possède un sens libéral qu’on retrouve dans les institutions des démocraties européennes.
Ce progrès n’est pourtant qu’une Idée de la raison. Il ne possède, chez Kant, aucune réalité objective. Il est en effet impossible de vérifier « scientifiquement » le progrès puisqu’il faudrait occuper la place d’un observateur extérieur au cours de l’histoire, capable de connaître la totalité du développement de l’humanité, pour attester de sa réalité. Il faudrait posséder le don de prédiction pour affirmer avec certitude que nos institutions s’améliorent. On ne peut donc qu’espérer progresser ou encore comme le note Cournot « croire » au progrès.
De là à penser que celui-ci n’est qu’une illusion ou qu’une nouvelle forme de religion, il n’y a qu’un pas qu’un philosophe comme Schopenhauer franchit allégrement. L’histoire ne serait que la répétition sans fin de conflits et de guerres : « il n’y a rien de neuf sous le soleil », affirmait déjà l’Ecclésiaste.
De fait notre époque semble donner raison sur bien des plans au pessimisme de Schopenhauer. Nos droits, parfois chèrement conquis par les peuples, n’empêchent nullement une partie de la population de nos démocraties de vivre misérablement, sans parler des autres États. À la question avons-nous progressé ? vivons-nous mieux hier qu’aujourd’hui ? la réponse commune est souvent négative. Beaucoup ont même le sentiment d’une régression générale que ce soit dans le domaine des droits sociaux remis en cause par des politiques de plus en plus libérales, dans le domaine de la liberté de la presse menacée par la concentration entre les mains de quelques groupes ou actionnaires puissants des principaux journaux, dans le mécanisme de nos institutions mis à mal par exemple par le recours quasi systématique de l’actuel gouvernement à la pratique des ordonnances ou encore par des interventions militaires menées parfois sans l’aval du parlement. Et la liste n’est pas close.
Où allons-nous ? Dans Le Conflit des facultés, Kant distingue trois façons d’envisager le cours de l’histoire : le progrès, la répétition, la régression. S’il nous est impossible de savoir laquelle de ces hypothèses est la bonne, il nous est en revanche permis d’affirmer avec certitude que l’état du monde, et celui de notre société plus particulièrement, ne fera que s’aggraver si nous n’agissons pas. Il existe, semble-t-il, une sorte d’ironie de l’histoire qui est bien différente de celle à laquelle songeait Hegel lorsqu’il parlait de la « ruse de la raison » : l’état des sociétés aurait une tendance naturelle à empirer. Les passions, loin d’être au service du perfectionnement de l’humanité, ne serviraient que les intérêts les plus réactionnaires. Le retour, un peu partout, du conservatisme moral ou religieux semble bien un signe, pour emprunter au langage de Kant, de cette tendance. Pour le dire plus simplement, les droits ne sont jamais définitivement acquis. La remise en cause du droit à l’avortement dans de nombreux pays « évolués » illustre bien cette fragilité de la liberté. Il y a donc bien une ironie de l’histoire qui se moque de nous en nous laissant croire que nous avons gagné la guerre alors que nous n’avons emporté que quelques batailles. Il est donc impossible de savoir où nous allons, et Kant a raison sur ce point bien qu’il l’entende dans un sens très différent du mien. Il est en revanche facile d’imaginer où nous pourrions revenir. S’il nous est difficile de nous représenter ce que serait « le meilleur des mondes possibles », il est aisé de connaître quel est le pire pour la simple raison qu’il s’est déjà produit et qu’il continue de se produire sous nos yeux avec par exemple les massacres de la Ghouta en Syrie.
En ce sens le pessimisme présent dans nos démocraties, pessimisme qui s’accompagne d’un sentiment d’impuissance, paraît extrêmement dangereux parce qu’il laisse la porte ouverte à un retour de la tyrannie. Ne commettons pas l’erreur de croire que celle-ci soit un mal qui appartienne à une époque définitivement révolue pour « nous autres, bons européens » (Nietzsche). Mais comment résister ? C’est sans doute la question essentielle qui se pose aujourd’hui à nous. Je me garderai bien d’esquisser une réponse dans le cadre d’une chronique. Je me contenterai de rappeler que la liberté, qui reste tout de même l’idéal le moins sot que nous puissions poursuivre, s’exprime d’abord sous la forme de la résistance. Résistance aux idées conservatrices, moralisantes, religieuses, fascisantes, résistance aussi à l’accaparement par quelques-uns des richesses de tous.
Gilles Pétel
La branloire pérenne






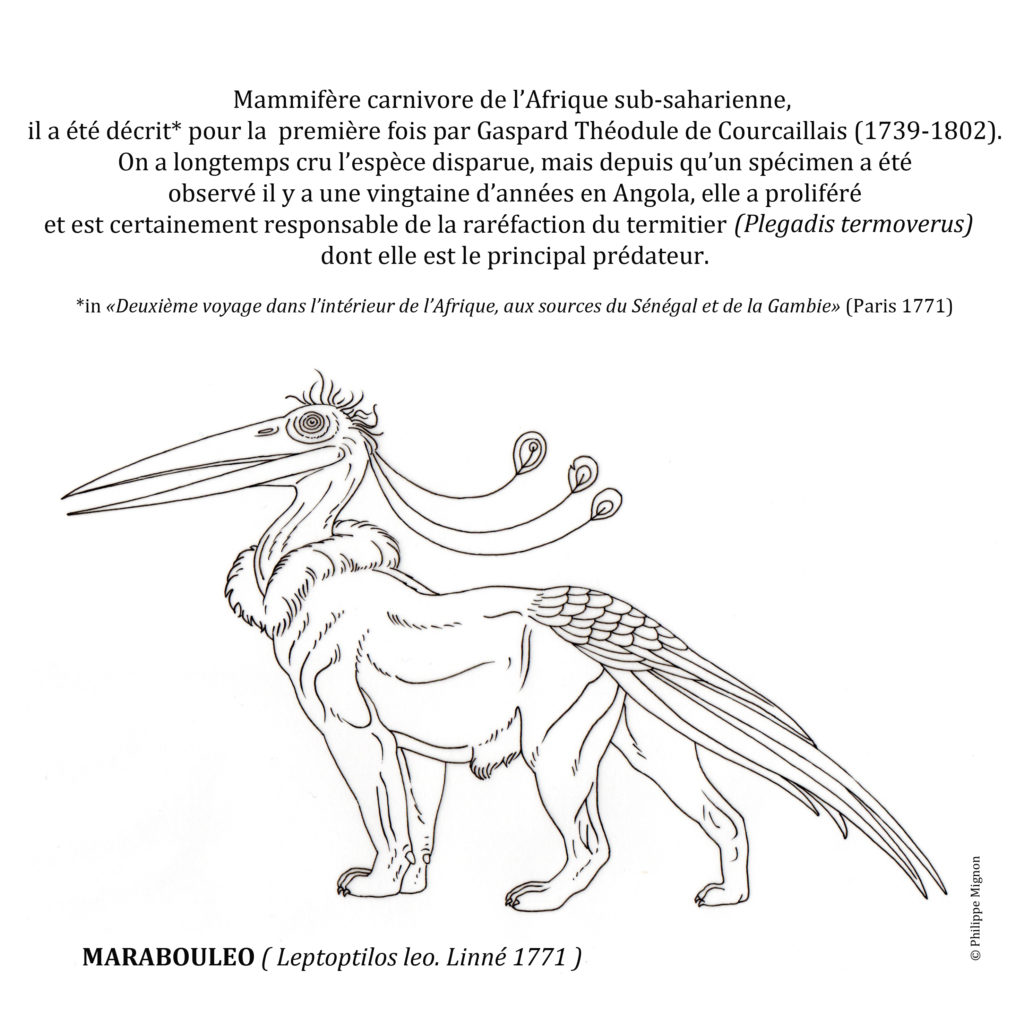



0 commentaires