Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
Vendredi 26 janvier, le parlement polonais a voté une loi qui condamne quiconque mettrait en cause la responsabilité des Polonais dans les crimes commis par l’Allemagne nazie, rapporte Mediapart dans son édition du 30 janvier.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a aussitôt réagi et déclaré : « Nous ne tolérerons sous aucune circonstance aucune tentative de réécriture de l’histoire ».
Dans la foulée, le Conseil de l’Europe critiquait à son tour l’initiative du parlement polonais. La loi doit encore passer devant le sénat avant d’être, éventuellement, promulguée par le président de la Pologne.
Ironie de l’histoire, la chaîne Arte diffusait au même moment le documentaire de Claude Lanzmann Quatre sœurs où le rôle actif joué par certains Polonais dans la politique d’extermination des Juifs menée par les nazis est souligné à plusieurs reprises.
L’histoire est plus sale que la légende que tente de promouvoir le parlement polonais.
Mais n’en va-t-il pas de même pour tous les États ? L’histoire officielle n’est-elle pas le spectre qui hante tout État désireux de conforter sa légitimité ?
Dans 1984, Orwell décrit un État au pouvoir absolu qui réécrit chaque jour l’histoire en fonction de ses intérêts du moment. Ce roman, considéré à juste titre comme visionnaire, fait de l’histoire officielle une des caractéristiques de ce que nous appelons l’État totalitaire, totalitaire parce qu’il « totalise » précisément tous les domaines de l’existence, qu’elle soit publique ou privée, présente ou passé, affective ou cognitive, spirituelle ou matérielle. Rien en somme n’échappe au contrôle de cet État monstrueux.
Imposer au peuple un récit officiel ou encore national permet de justifier le pouvoir en place mais aussi d’étourdir les sujets de ce pouvoir : il y a dans toute histoire officielle un effet anesthésiant. L’admiration que suscite le rappel des grands faits de la nation, son courage, son héroïsme, ses tragédies, ses victoires enfin, interdit la réflexion. L’histoire officielle n’est pas seulement une histoire manipulée, c’est aussi une histoire passionnelle. Et c’est malheureusement par ce côté qu’elle s’immisce le plus facilement dans les esprits. Les gens aiment le sublime de l’histoire, moins son côté sordide et sale.
Orwell pensait à l’URSS de Staline lorsqu’il écrivait 1984. Nous savons que Staline avait fait retoucher les photos qui le montraient à côté des maréchaux exécutés lors des procès de Moscou de façon à faire disparaître du cadre les amis d’hier devenus les traitres d’aujourd’hui.
Nous aimerions croire ainsi que l’histoire officielle ne concerne que les États totalitaires ou tyranniques. Mais ce désir d’écrire l’histoire n’est-il pas le vice de tout État, même le plus démocratique ?
Deux exemples récents dans notre histoire semblent confirmer cette hypothèse.
Lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir, il avait demandé aux professeurs du secondaire d’enseigner les bienfaits de la colonisation, provoquant aussitôt un tollé général. Dans la réforme du lycée que veut mettre en place l’actuel gouvernement, les disciplines critiques que sont l’économie, l’histoire et la philosophie vont voir leur horaire sensiblement diminué alors que les sciences, et principalement les mathématiques, sont confortées dans leur position dominante. L’instruction est aussi un des leviers du pouvoir. Pour le moment peu nombreux sont ceux qui s’émeuvent de cette réforme. La manifestation de jeudi dernier n’a rassemblé à Paris, aux dires de la Préfecture de police, qu’un peu moins de 3000 personnes. Il est vrai que les grands médias du pays n’ont guère relayé l’information.
Mon second exemple concerne les lois mémorielles et me ramène à l’affaire polonaise. Benjamin Netanyahou a raison sur le fond. Le vote du parlement polonais est scandaleux. Mais il passe un peu vite sur la forme. C’est en effet le principe même des lois mémorielles qui pose problème. Revient-il au Parlement d’établir la vérité historique ?
Dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paul Ricœur montre comment il faut distinguer la mémoire, qui est d’ordre affectif, de l’histoire en tant que connaissance rationnelle du passé. La mémoire, individuelle ou collective, semble spontanée : nous nous rappelons sans effort les événements qui nous ont marqués ou qui ont ébranlé l’histoire de notre pays, comme la Révolution française ou les grandes guerres. Ce rappel, aussi bien pour les individus que pour les peuples, passe cependant par des médiations dont ni les uns ni les autres n’ont nécessairement conscience. Dans le cas des individus, leur mémoire passe par celle de leurs proches, c’est-à-dire par les récits que tous ont entendu au cours de leur existence. Pour les peuples, les commémorations organisées par les pouvoirs publics portent une mémoire qui serait défaillante sans ces fêtes et ces célébrations. La mémoire, comme l’histoire officielle, n’est jamais neutre. L’historiographie au contraire s’appuie sur une tout autre démarche. On peut rapidement la ramener à trois grandes étapes, montre Ricœur : l’établissement des faits, par un travail sur les archives, l’explication des faits et leur interprétation. Enfin l’histoire, même rationnelle, est toujours une question qu’une époque pose aux générations qui l’ont précédées. Son but est à la fois de connaître le passé mais aussi de comprendre le présent. En ce sens nous n’avons jamais fini d’écrire et de réécrire notre histoire.
C’est pourquoi toute loi mémorielle est, pour dire le moins, problématique. D’abord parce qu’elle fige notre connaissance du passé dans un texte de loi, ensuite parce qu’elle substitue le pouvoir de l’État au travail de l’historien, enfin parce qu’elle méconnaît le sens de la loi.
Le but des lois est en effet de définir le juste et l’injuste, non le vrai et le faux. Plus précisément les lois sanctionnent ce qui est dangereux ou nuisible aussi bien du point de vue de l’intérêt général que du point de vue des particuliers. Les lois promeuvent aussi de nouveaux droits, c’est-à-dire de nouvelles libertés. En aucun cas par conséquent le législateur n’a à se préoccuper du domaine de la connaissance, quelque soit son objet. Si notre assemblée devait sanctionner les opinions fausses, elle aurait devant elle une tâche quasi infinie. Faudrait-il par exemple condamner l’astrologie qui est une « connaissance » non seulement fausse mais encore absurde ? Et n’en va-t-il pas de même pour de nombreuses croyances qui hantent l’esprit de nos contemporains ? La loi remettrait alors en cause la liberté de conscience, pourtant considérée comme un droit fondamental.
Certains objecteront qu’il existe des opinions dangereuses. La loi interdit justement le racisme qu’elle considère comme un délit. De même il peut sembler légitime d’interdire les thèses révisionnistes non tant parce qu’elles sont fausses mais parce qu’elles sont menaçantes. Il me semble pourtant, et c’est aussi ce que pensent plusieurs historiens, que, malgré le caractère nauséeux des thèses révisionnistes ou négationnistes, il n’est pas bon de les interdire pour plusieurs raisons. D’abord, comme je l’ai rappelé plus haut, parce que telle n’est pas la mission des lois, ensuite parce que cette interdiction se montre contre-productive. Ces thèses circulent « sous le manteau » comme on dit et jouissent ainsi du bénéfice que procure toujours la clandestinité : la vérité est cachée, pensent souvent les gens. De plus l’interdiction de ces thèses ne fait qu’apporter de l’eau au moulin des théories du complot. Enfin parce qu’il revient aux historiens eux-mêmes de détruire pièce par pièce ces théories imbéciles.
L’État de droit est davantage un idéal qu’un fait acquis. Son sens est complexe. Il renvoie bien sûr à l’égalité de tous devant la loi mais aussi à la promotion et à la conservation d’un certain nombre de libertés fondamentales, comme la liberté d’expression. Celle-ci inclut des libertés fort différentes : la liberté de pratiquer un culte en public et la liberté de mener des recherches rationnelles sans être entravé par une quelconque limite. Ni la morale ni le droit ne peuvent être des arguments contre la connaissance. Nous n’avons pas à légiférer sur ce que les gens doivent penser. Or il me semble que nous assistons depuis quelque temps déjà à ce que Pascal appelait, dans un autre domaine, la confusion des ordres : nous mélangeons le législatif, le spéculatif (ce qui est du ressort de la connaissance) et le moral. Et de même que Pascal condamnait comme source d’injustice la confusion de celui qui veut être aimé parce qu’il est puissant ou savant, de même nous pouvons craindre que la confusion de l’ordre de la loi et de celui du savoir ne constitue une dérive tyrannique de la démocratie.
Ce qu’a voté le parlement polonais constitue donc sans le moindre doute une grave entorse à l’État de droit. La communauté internationale a raison de s’indigner d’une telle loi. Elle devrait aussi si elle était conséquente s’indigner de toutes les pratiques et lois qui mettent en péril la liberté de savoir. La démocratie, comme régime de la liberté, est un bien fragile.
Gilles Pétel
La branloire pérenne


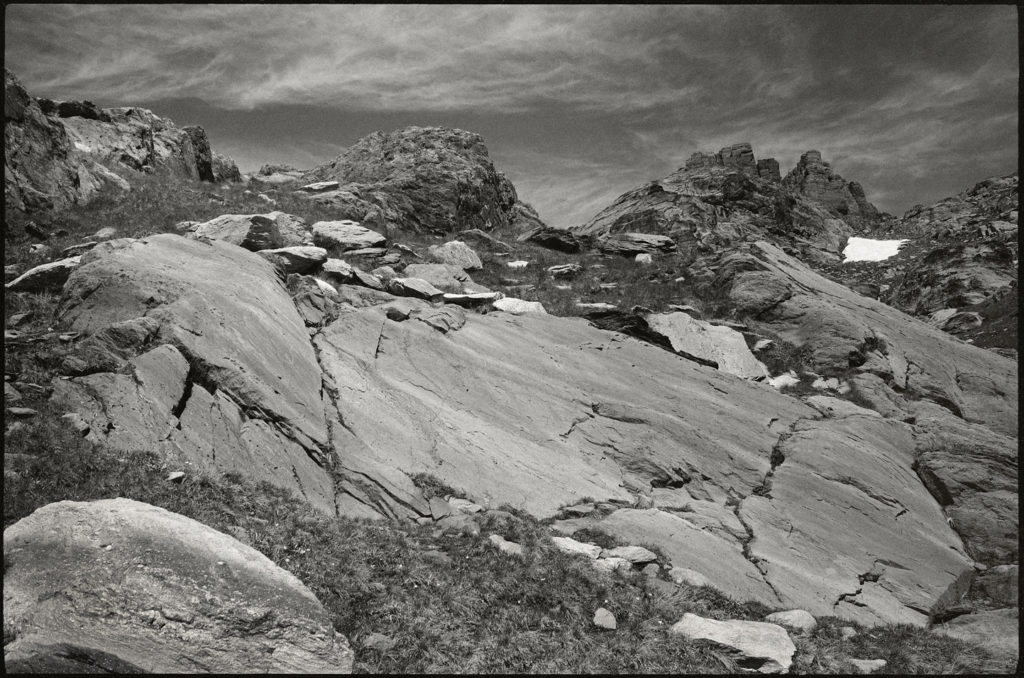






0 commentaires