Le coin des traîtres : pièges, surprises, vertiges, plaisirs et mystères de la traduction…
J’ai commencé à pratiquer le surtitrage il n’y a pas si longtemps, quelques années quand même, et à un moment le rythme s’est accéléré, j’en ai enchaîné quelques-uns.
Sans jamais cesser de traduire pour la scène, mais tout de même, l’objet surtitre m’occupait de plus en plus, ses contraintes, ses défis…
Et puis un jour, travaillant sur une pièce d’une autrice que je connais et pratique depuis de nombreuses années, une amie, une âme sœur, dont l’écriture est un bonheur à traduire, présente de beaux défis, de ceux qu’on aime, qui vous réveillent les méninges, je m’aperçois que non, je n’y arrive pas, je n’y arrive plus, tout résiste, tout est un problème, tout est laborieux – certes, c’est une pièce difficile, mais tout de même, il y a un hic. Serait-ce un nouvel épisode d’overdose de mots ? J’en ai déjà connu, comme, j’imagine, bon nombre de traducteurs. Dans ces cas-là, même s’il faut un certain temps pour poser le diagnostic, une fois le mal reconnu, le remède est simple : trois jours sans mots, trois jours de peinture, d’expositions, de broderie, de promenades en forêt ou ailleurs, de vélo le long du canal, trois jours sans lectures, bref, une pause sans mots et rapidement tout rentre dans l’ordre.
Mais non. Ce n’est pas ça. D’abord je ne suis pas accrochée à mon clavier à toutes les heures, je ne m’y mets qu’avec parcimonie – parce que ça résiste –. Il faut se rendre à l’évidence, il n’y a pas d’autre explication : je ne sais plus traduire.
Mais il faut bien, la Maison Antoine Vitez attend, l’autrice attend, les amoureux de son théâtre attendent… Et voilà que lors d’une Boîte à Outils (ici une parenthèse explicative s’impose : le comité anglais de la Maison Antoine Vitez organise mensuellement ce que nous appelons une Boîte à Outils : nous nous réunissons à trois, quatre ou cinq autour d’une table avec thé, café et friandises et des os à ronger pour les collègues : chacun·e apporte les problèmes que sa traduction en cours lui pose, et tout le monde planche – c’est joyeux et très efficace) lors d’une BAO, donc, je préviens mes camarades : j’ai une liste de questions longue comme le bras, je ne sais plus traduire, rien n’y fait, rien ne marche, il va falloir changer de métier. Je pose ma première question, et en l’exposant, en expliquant où le bât blesse, brusquement, la révélation : mon interrupteur cérébral est resté bloqué en position Surtitrage. Voilà pourquoi je n’y arrive plus. Et, comme par magie, une bonne moitié des problèmes se résout d’elle-même.
C’est que, en restant coincée en mode surtitrage, je m’impose inconsciemment toute une série de contraintes liées à la discipline. Vous me rétorquerez que ce n’est pas une raison pour ne plus savoir traduire, puisque justement, le surtitrage, j’aime ça, ce sont des contraintes en plus, et qui peut le plus peut le moins. Sauf que je m’impose bien des contraintes mais pas toutes, car je n’ai pas de spectacle à traduire mais bien une pièce. Je suis de mon mieux les impératifs du genre, mais je n’en ai pas les libertés.
Je m’impose de respecter autant que possible la syntaxe du texte source, de rester le plus près non seulement de l’esprit du texte mais aussi de la lettre, d’importer au maximum les mots qui se ressemblent dans les deux langues, d’être le plus concise possible et d’éviter toute traduction un tant soit peu explicative (bon, ça de toute façon, c’est ma marotte), etc. Mais ce que je ne peux pas m’imposer, ce sont les contraintes liées au surtitrage, dont je m’aperçois en y réfléchissant qu’elles sont libératoires : je ne peux pas ne pas tout traduire, je ne peux pas condenser, je ne peux pas me caler sur le souffle du spectacle, ni faire confiance à ce qui se joue par la mise en scène et l’interprétation des acteurs ; je me cale sur le souffle du texte, et celui-ci demande à être traduit de manière, justement, à laisser sa part d’interprétation à l’acteur, au metteur en scène, à créer du possible, à ouvrir des champs au lieu de coller à une intention déjà choisie ; il faut donc faire des choix dictés par une compréhension intime de la pièce, traduire comme on joue, en quelque sorte, être le premier metteur en scène du texte traduit (pour citer approximativement Antoine Vitez), et non le premier spectateur du texte monté.
Les deux exercices – traduire une pièce pour en faire un texte à jouer, ou rédiger les surtitres pour en faire un spectacle à lire – sont éminemment complémentaires et différents, en aucun cas substituables, et c’est tant mieux. Merveilleux gymnaste qu’est notre cerveau, pour peu qu’on n’oublie pas de lui allumer la bonne lumière. Ouf !
Dominique Hollier
Le coin des traîtres
Dominique Hollier est née au Québec et a passé son enfance à Londres. Elle est d’abord comédienne, notamment avec la compagnie Laurent Terzieff pour qui elle traduira sa première pièce en 1993. Elle s’attache à faire découvrir les nouvelles voix du théâtre anglophone, participant aux travaux du comité anglais de la Maison Antoine Vitez (centre international de la traduction théâtrale) qu’elle coordonne de 2006 à 2012. Elle a traduit plus de 90 pièces, dont celles de Naomi Wallace, Ronald Harwood, Don DeLillo, David Greig, David Hare, Zinnie Harris ou Simon Stephens, tout en continuant sa carrière de comédienne. Elle réalise également des surtitrages pour le spectacle vivant, vers le français et vers l’anglais. Elle a été nommée aux Molières en 1993, 2000, 2010 et 2011






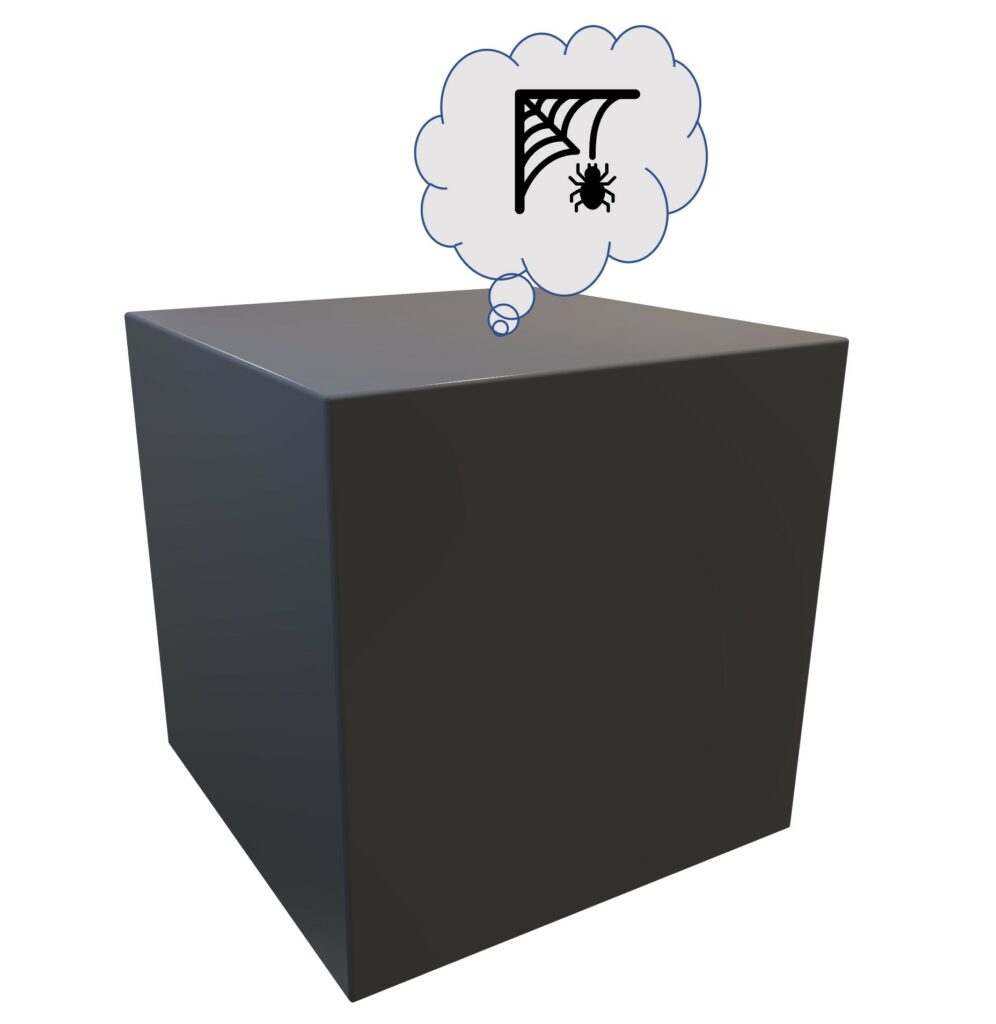


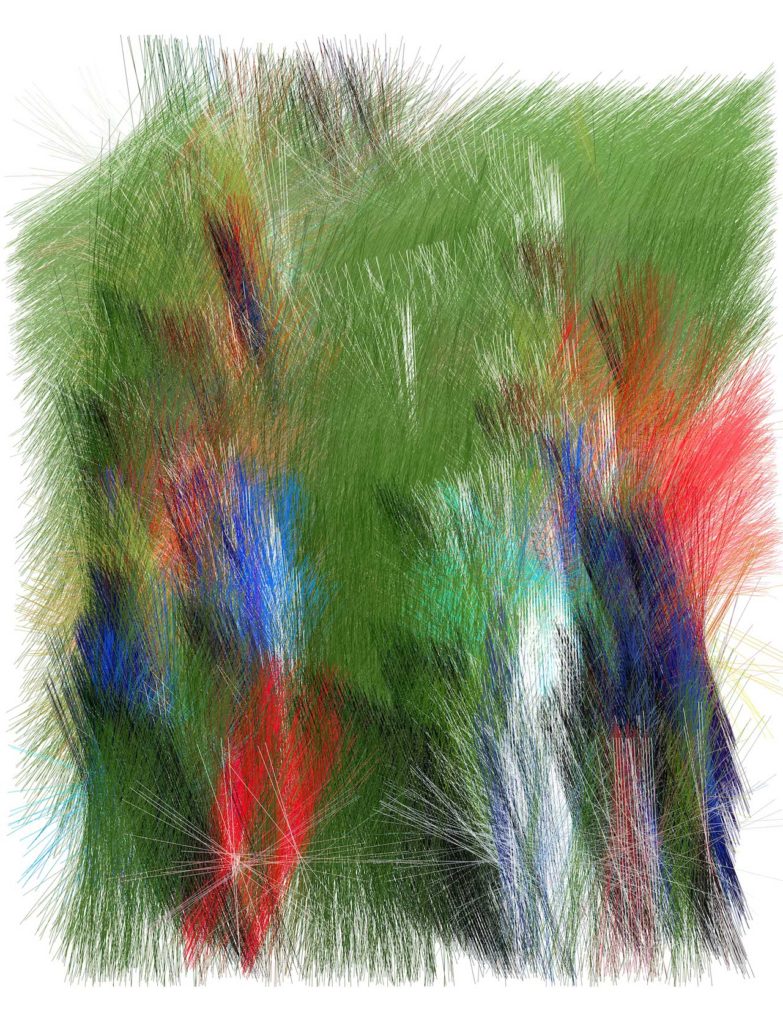
0 commentaires