 « Passé inaperçu à la sortie du premier tome », indique Béatrice Duval, son éditrice chez Denoël : les romans de l’écrivain norvégien Karl Ove Knausgaard n’ont pas rencontré, en France, le public enthousiaste, voire fanatique, de ses lecteurs allemands ou anglo-saxons qui l’ont propulsé au rang de star des romanciers. Visage buriné par la vie, cheveux mi-longs, regard intense, barbe grisonnante et cigarette perpétuellement au doigt, Knausgaard ressemble à une rock star et nous rappelle que la littérature peut aussi être cool. 500 000 livres vendus en Norvège. La Mort d’un père, sorti en 2012 en France, premier tome des six romans de l’autobiographie, n’a atteint que 4 000 exemplaires. Il est cantonné dans la catégorie malencontreuse des écrivains pour écrivains, ce petit club de happy few qui caractérise quelques auteurs rares, singuliers et nécessaires. Emmanuel Carrère, Jonathan Lethem en parlent avec respect. En Grande Bretagne, Zadie Smith a évoqué l’effet narcotique de la lecture de l’auto-fiction. En Norvège, la sortie des premiers tomes de Mon Combat – Min Kemp en norvégien – ont défrayé la chronique. Le titre, d’abord, volontairement provocateur, mais surtout l’étalage de sa vie privée passée au crible d’une écriture sans fioritures. Sa première femme, la journaliste Tonje Aursland, qu’il a délaissée pour la romancière suédoise Linda Boström, a contre-attaqué lors d’un programme radio pour donner sa version des faits. Sa famille paternelle s’est opposée à la publication du roman La Mort d’un père, dans lequel il raconte la déchéance et la mort sordide. Égoïste, brutal, égocentrique, forcément. C’est peut être cette perpétuelle outrecuidance à parler de soi qui a le plus choqué. Le Proust norvégien, comme on le désigne souvent, écrit au plus près de l’émotion et de la vie disséquée dans ses aspects les plus simples, les plus banals. Dans cette entreprise de dépouillement radical des sentiments, c’est cette sincérité qui est choquante. Comment peut-on s’autoriser à tant parler de soi, à vouloir tout dire ? Évidemment, les amis d’enfance, les parents, les amantes y passent, avec détails et fracas. La fragilité frontale avec laquelle la masculinité est auscultée, soupesée, déstabilise. Lucide et abîmé, amusé aussi, il déclare : « Écrire est ma manière de me débarrasser de la honte ». Sa traductrice française, Marie-Pierre Fiquet, a traduit les trois romans qui sont sortis en France, elle finalise le quatrième tome, qui sortira comme les précédents chez Denöel lors de la prochaine rentrée littéraire, et dont le titre n’est toujours pas arrêté. Des milliers de pages déjà traduites, des milliers à venir. Questionnée sur sa co-habitation avec un auteur de l’intimité et de la banalité, elle évoque la transposition d’un style bref, dépouillé, volontairement pauvre, qui doit trouver son rythme et sa respiration en français.
« Passé inaperçu à la sortie du premier tome », indique Béatrice Duval, son éditrice chez Denoël : les romans de l’écrivain norvégien Karl Ove Knausgaard n’ont pas rencontré, en France, le public enthousiaste, voire fanatique, de ses lecteurs allemands ou anglo-saxons qui l’ont propulsé au rang de star des romanciers. Visage buriné par la vie, cheveux mi-longs, regard intense, barbe grisonnante et cigarette perpétuellement au doigt, Knausgaard ressemble à une rock star et nous rappelle que la littérature peut aussi être cool. 500 000 livres vendus en Norvège. La Mort d’un père, sorti en 2012 en France, premier tome des six romans de l’autobiographie, n’a atteint que 4 000 exemplaires. Il est cantonné dans la catégorie malencontreuse des écrivains pour écrivains, ce petit club de happy few qui caractérise quelques auteurs rares, singuliers et nécessaires. Emmanuel Carrère, Jonathan Lethem en parlent avec respect. En Grande Bretagne, Zadie Smith a évoqué l’effet narcotique de la lecture de l’auto-fiction. En Norvège, la sortie des premiers tomes de Mon Combat – Min Kemp en norvégien – ont défrayé la chronique. Le titre, d’abord, volontairement provocateur, mais surtout l’étalage de sa vie privée passée au crible d’une écriture sans fioritures. Sa première femme, la journaliste Tonje Aursland, qu’il a délaissée pour la romancière suédoise Linda Boström, a contre-attaqué lors d’un programme radio pour donner sa version des faits. Sa famille paternelle s’est opposée à la publication du roman La Mort d’un père, dans lequel il raconte la déchéance et la mort sordide. Égoïste, brutal, égocentrique, forcément. C’est peut être cette perpétuelle outrecuidance à parler de soi qui a le plus choqué. Le Proust norvégien, comme on le désigne souvent, écrit au plus près de l’émotion et de la vie disséquée dans ses aspects les plus simples, les plus banals. Dans cette entreprise de dépouillement radical des sentiments, c’est cette sincérité qui est choquante. Comment peut-on s’autoriser à tant parler de soi, à vouloir tout dire ? Évidemment, les amis d’enfance, les parents, les amantes y passent, avec détails et fracas. La fragilité frontale avec laquelle la masculinité est auscultée, soupesée, déstabilise. Lucide et abîmé, amusé aussi, il déclare : « Écrire est ma manière de me débarrasser de la honte ». Sa traductrice française, Marie-Pierre Fiquet, a traduit les trois romans qui sont sortis en France, elle finalise le quatrième tome, qui sortira comme les précédents chez Denöel lors de la prochaine rentrée littéraire, et dont le titre n’est toujours pas arrêté. Des milliers de pages déjà traduites, des milliers à venir. Questionnée sur sa co-habitation avec un auteur de l’intimité et de la banalité, elle évoque la transposition d’un style bref, dépouillé, volontairement pauvre, qui doit trouver son rythme et sa respiration en français.
Agnès Villette.– Comment les romans de Karl Ove Knausgaard sont-ils arrivés sur votre bureau ?
Marie-Pierre Fiquet.– C’est une longue histoire. La première fois que j’ai entendu parler de Knausgaard, c’était en Norvège, dans les médias, au moment de la parution de ses livres. La polémique fut importante. J’avoue que je ne me suis pas précipitée sur ses romans, et vu leur épaisseur… C’est par un concours de circonstances que les éditions Denoël m’ont demandé de participer à un essai de traduction. Ce que j’ai fait, ils m’ont ensuite demandé de traduire le tome 1, puis le tome 2, le tome 3, le tome 4…
Vous vous souvenez de la première ligne que vous avez traduite ?
Oh oui ! C’est d’ailleurs un passage intéressant parce qu’il est très littéraire, contrairement au reste. L’incipit de La Mort d’un père a une qualité littéraire qui n’est pas toujours aussi marquée ailleurs. Je me rappelle y avoir passé beaucoup de temps. La première ligne évoque le battement du cœur et l’arrivée de la mort.
Vous avez su rapidement que ce serait un auteur que vous alliez aimer traduire ?
Oui, absolument. C’était une condition sine qua non. Je l’ai lu et j’ai été fascinée.
Denoël va publier tout Mon Combat comme une somme. Il vous reste plusieurs années de collaboration, de vie en commun. C’est un peu comme vivre avec lui j’imagine ?
Je ne vous le fais pas dire. Savez-vous comment j’ai réalisé à quel point c’est vrai ? Lorsque j’ai appris qu’il allait divorcer d’avec Linda, la mère de ses quatre enfants… mon monde s’est écroulé.
Quand vous lisez un livre, j’imagine que vous lisez comme une traductrice.
Cela varie. Je peux lire comme une traductrice et finir par me laisser entraîner par le contenu, c’est à dire que je me plonge dans ce qu’on me donne à lire, comme n’importe quel autre lecteur. Lors de la première lecture, je ne savais pas forcément que j’allais le traduire. Ce qui m’a d’emblée convaincue ou emportée, c’est la langue. En norvégien, son style est extrêmement fluide, plutôt agréable à lire, ça coule, du moins la plupart du temps. Le style est très concis, mais après avoir traduit quatre romans, j’ai constaté que cela varie d’un roman à un autre. Il a un talent évident de conteur. Il utilise des techniques relativement simples pour maintenir cette tension. En norvégien, je repère ses moyens, par exemple, quand il va annoncer quelque chose de manière indirecte. Dans le livre que je viens de traduire – Dancing in the dark dans la version en anglais, mais nous n’avons pas arrêté de titre en français – il y a tout le temps des gens qui sonnent à sa porte. Dans Un homme amoureux, sorti en 2014, il rencontre à Stockholm un certain Geir, avec qui il a des conversations à bâtons rompus sur la littérature. Geir essaye d’écrire un livre depuis des années, il piétine. À un moment, Geir lui dit : de toute façon tu peux écrire vingt pages sur quelqu’un qui va aux toilettes et le rendre intéressant.
À le lire, on saisit très vite qu’il fait tout pour amener son lecteur à un endroit très précis. Dans une interview au Guardian, il parle de créer une pièce à fiction d’où il peut écrire. À propos de Tourgueniev, il dit que le lire c’est parvenir à ce lieu qui est plus intense, plus riche en émotion que la vie réelle. Je pense que les lecteurs de Knausgaard comprennent ce qu’il tente de construire.
Oui, absolument, il nous emmène où il veut, il nous mène par le bout du nez, c’est son bâton de magicien en tant que conteur. Je n’ai pas la sensation physique d’être dans une pièce, j’ai plutôt la sensation intellectuelle d’être dans un univers. Dans un univers qui me manque au bout d’un certain temps. C’est un univers que je retrouve avec toujours beaucoup d’intérêt, comme si j’étais un peu chez moi, et pourtant ce ne sont pas du tout les même vies. Mais il y a quelque chose de profondément humain et universel dans ce qu’il raconte, je suis portée à croire que la plupart des lecteurs s’y retrouvent. Malgré toutes ces différences, ce qu’il évoque est tout à fait universel. là réside son intérêt.
Il y a un engouement énorme pour sa littérature. Zadie Smith parle d’effet narcotique. J’imagine qu’en le traduisant c’est un peu la même chose.
Il m’arrive de faire des pauses entre chaque livre. Mais après un certain temps, j’ai envie d’y retourner, ça me manque vraiment.
En même temps, comme il ne parle que de lui, c’est quand même vampirique, il y a un appel d’air total, le monde est là, avec lui. Tout vire aussi à cette détestation de soi.
Il en parle assez bien lui-même, il oscille de manière permanente entre cette fiction qui n’en finit jamais, et cette envie de ne plus parler de soi. Ne plus accorder d’interviews. Ne plus s’exposer au public. Et puis en même temps, il avoue que pour lui aussi c’est une drogue et qu’il n’arrive pas à s’en passer. C’est un homme ambivalent, tiraillé, en contradiction permanente. Il y a d’une part la détestation de soi. – N’est-ce pas plutôt une lucidité ? – Et d’autre part la certitude d’être un écrivain, d’avoir quelque chose de singulier à dire, il insiste beaucoup là-dessus. Des tas de gens qui le lisent en France me disent que ses livres sont d’une noirceur, d’une tristesse… Pour moi, il est juste lucide. Mais pas noir.
Le traduire, c’est être constamment dans le détail de cette banalité qu’il approche dans sa plus franche expression. Je me demandais, de manière amusée, combien de cigarettes allumées, de cafés bus, d’interrupteurs allumés ? Il y a quelque chose que l’on confronte dans ce parti pris de la banalité.
Effectivement, c’est un parti pris. Personnellement, je ne ressens absolument pas d’ennui. Je peux trouver que c’est long, volumineux, mais je ne m’ennuie jamais.
Dans les interviews, il parle beaucoup de cette volonté de s’approcher au plus près des choses. Jusqu’à les dépouiller, une sorte de proximité, presque d’épuisement des mots. Comment cela fonctionne-t-il en norvégien, car son vocabulaire est assez pauvre parfois ? La langue française a du mal à être dépouillée, à être simple.
Il y a deux dimensions : le dépouillement et ces phrases longues qui vont à l’encontre d’une tradition d’écriture sobre. Il n’hésite pas à le dire : c’est la lecture de Proust qui l’a libéré, qui lui a permis d’écrire ces phrases longues. Cette impression qu’il va jusqu’à l’épuisement des mots, je ne l’ai pas. En norvégien, la répétition n’est absolument pas sanctionnée, on considère que ce n’est pas faire acte de mauvaise littérature que d’employer plusieurs fois le même mot. Pour adapter en français, j’ai effectivement dû varier les termes, passer par des synonymes. Figurez-vous que j’ai toujours à côté de moi les traductions anglaise et allemande. Je trouve cela passionnant. Comme ils ont un ou deux livres d’avance par rapport à la France, si j’ai un doute ou si je cherche une solution à un casse-tête de traduction, je vais par curiosité voir ce que cela donne en anglais et en allemand. Et ce n’est pas du tout pareil. Il y a une difficulté à transposer le norvégien en français, alors que si je regarde la version anglaise, elle est presque décalquée.
Est-ce que certains auteurs peuvent être des intermédiaires dans le travail de traduction. Des sortes de relais ?
Il y a quelques auteurs que je relie à Knausgaard, mais pas forcément dans l’écriture elle-même. Plutôt dans son désir d’être au plus près de sa réalité, de la réalité, de ce qui se passe, de ce qu’il a vécu. Je peux le rapprocher d’Annie Ernaux. Et aussi d’Édouard Louis. Dans leur volonté de relater les faits tels qu’ils les ont vécus, dans cette négation de la fiction, très forte chez Knausgaard. À plusieurs reprises, il a souligné que jamais il ne pourrait écrire de la fiction. Il dit que l’écriture est plus importante, qu’elle passe en premier, d’où le fait de jeter en pâture la vie de ses proches. Après coup, il a déclaré à plusieurs reprises que si c’était à refaire, il ne le referait pas.
Vous croyez vraiment qu’il ne le referait pas ?
C’est une bonne question. Non, je crois qu’il le ferait d’une autre façon.
Dans un pays protestant, dans une culture scandinave où le groupe prime sur l’individu, l’auto-fiction prend une dimension différente qu’en France où de nombreux prédécesseurs ont largement ouvert la voie : Musset, Chateaubriand, Proust, Starobinksi…
C’est une des raisons du débat qui a suivi la publication de ses romans. Cela a beaucoup choqué, cette manière de parler à la première personne, de s’étaler au grand jour, d’exposer sa vie familiale. Cela a fait scandale. J’ai rencontré des gens qui, lorsqu’ils apprenaient que je traduisais Knausgaard, me disaient que jamais ils ne le liraient. Ils blâmaient son attitude envers les siens. Je pense qu’il a effectivement voulu briser ce tabou.
Donc, au cœur du projet, il y a une dimension morale ?
Tout à fait, il y a une manière personnelle et provocante de s’attaquer à cette dimension. Le titre, déjà, Mon combat, qui renvoie au Mein Kampf d’Hitler.
Son écriture est à rebours de la modernité, de la brutalité des réseaux sociaux, de la circulation des informations, la digestion des informations. Il y a une lenteur qui s’inscrit contre l’époque.
J’ai relu une interview parue dans le Financial Times, où il parle de la modernité et de ses influences. Il déclarait, je cite : « le romantisme philosophique et esthétique tient une place centrale dans mon combat. » Ses livres sont, entre autres, une longue méditation sur la tradition littéraire et artistique au sein de laquelle il donne régulièrement la parole à son profond mal-être face à la modernité qu’il rumine ; il y a là une sensibilité sous-jacente qui remet en cause les valeurs des Lumières, qui célèbre le sublime mais cherche à recréer l’émerveillement devant la nature. Son succès en Grande-Bretagne s’explique peut-être par cela, c’est une attitude qui prête moins à controverse chez les Britanniques et les Américains élevés avec Byron et Shelley. Dans le contexte de l’Europe continentale, le romantisme est infiniment plus associé à la droite politique. Je me demande si Knausgaard voit son combat comme un acte de récupération.
La réception dans les pays anglo-saxons et germaniques est monumentale. En France, son succès est confidentiel. Bien sûr, plusieurs écrivains le citent régulièrement, Emmanuel Carrère, Jonathan Lethem, entre autres. Je me demandais s’il n’était pas tombé dans la malédiction d’être appréhendé comme un écrivain pour écrivains.
Je reviens à Édouard Louis. C’est aussi un fan de Knausgaard. J’ai l’impression que les critiques en France à son égard sont un peu d’arrière-garde. La langue est mise sur un piédestal. Pendant l’émission Le Masque et la Plume, un critique parlait de Knausgaard en disant que des pages entières étaient consacrées à la façon de nettoyer une maison, que ce n’était pas de la grande littérature. Tout cela est très français : la culture doit de préférence être inaccessible, ne pas parler de choses banales, concrètes, comme la façon de s’y prendre pour changer les couches d’un bébé. Des critiques un peu patriarcales, vieille France.
Est-ce que vous êtes en contact avec lui pour la traduction ?
Pas du tout. Je n’en ai jamais éprouvé le besoin, je le trouve tellement transparent. Dans une conférence, il parlait d’une auteure suédoise qu’il traduisait en norvégien. L’auteure suédoise était là, il disait qu’elle était très exigeante, qu’elle était tout le temps derrière lui, à lui expliquer que non, qu’il ne fallait pas traduire comme ceci mais comme cela. Lui, il disait qu’il laissait les traducteurs faire leur travail. Il a ajouté qu’à chaque fois qu’un traducteur s’adressait à lui pour lui poser une question, il pointait un manque, une incohérence. Ce qui le plongeait dans l’embarras. Si un point n’est pas clair, je préfère ne pas le clarifier. Je ne suis pas là pour améliorer son texte.
Marie-Pierre Fiquet
Propos recueillis par Agnès Villette
Le coin des traîtres
Karl Ove Knausgaard, Mon combat, traduit du norvégien par Marie-Pierre Fiquet, Denoël (les trois premiers tomes parus en 2012, 2014 et 2016, les suivants à paraître).


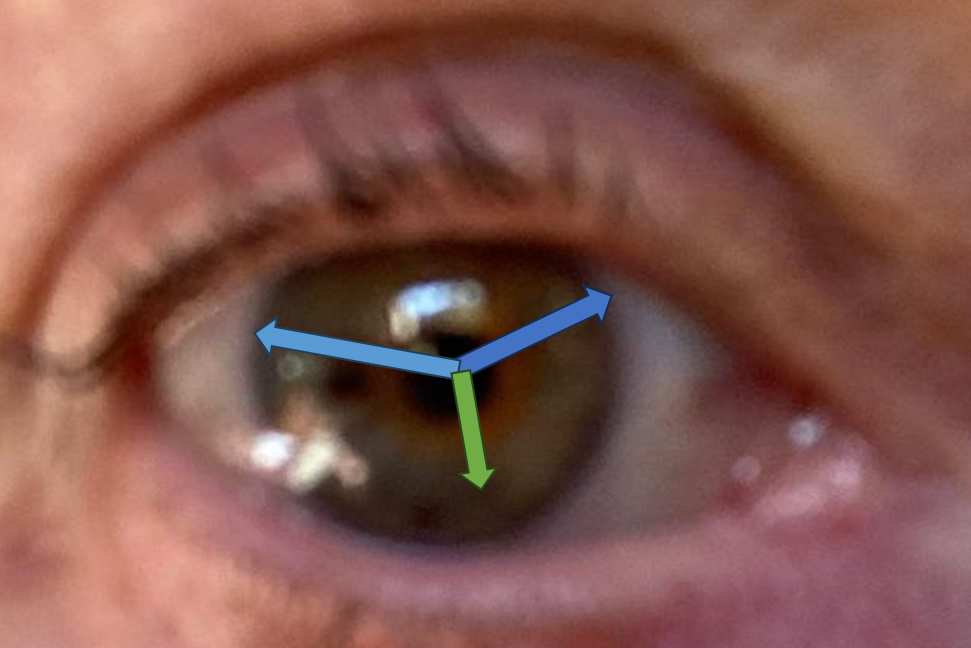


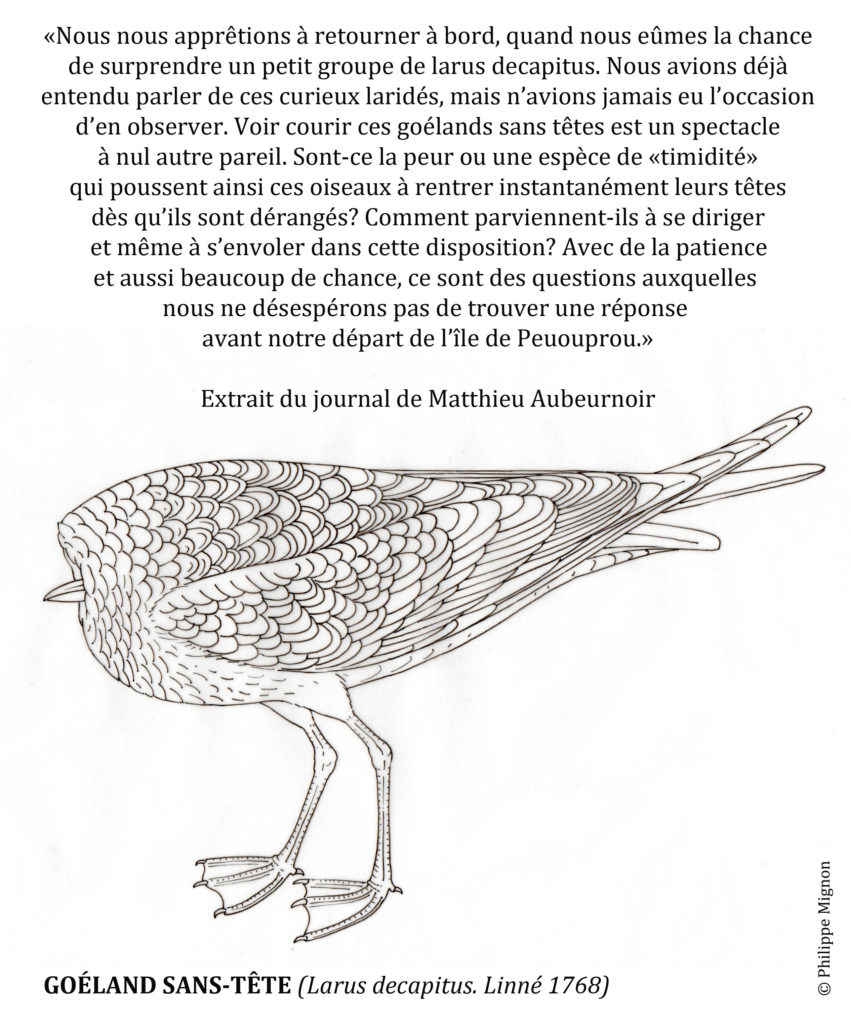

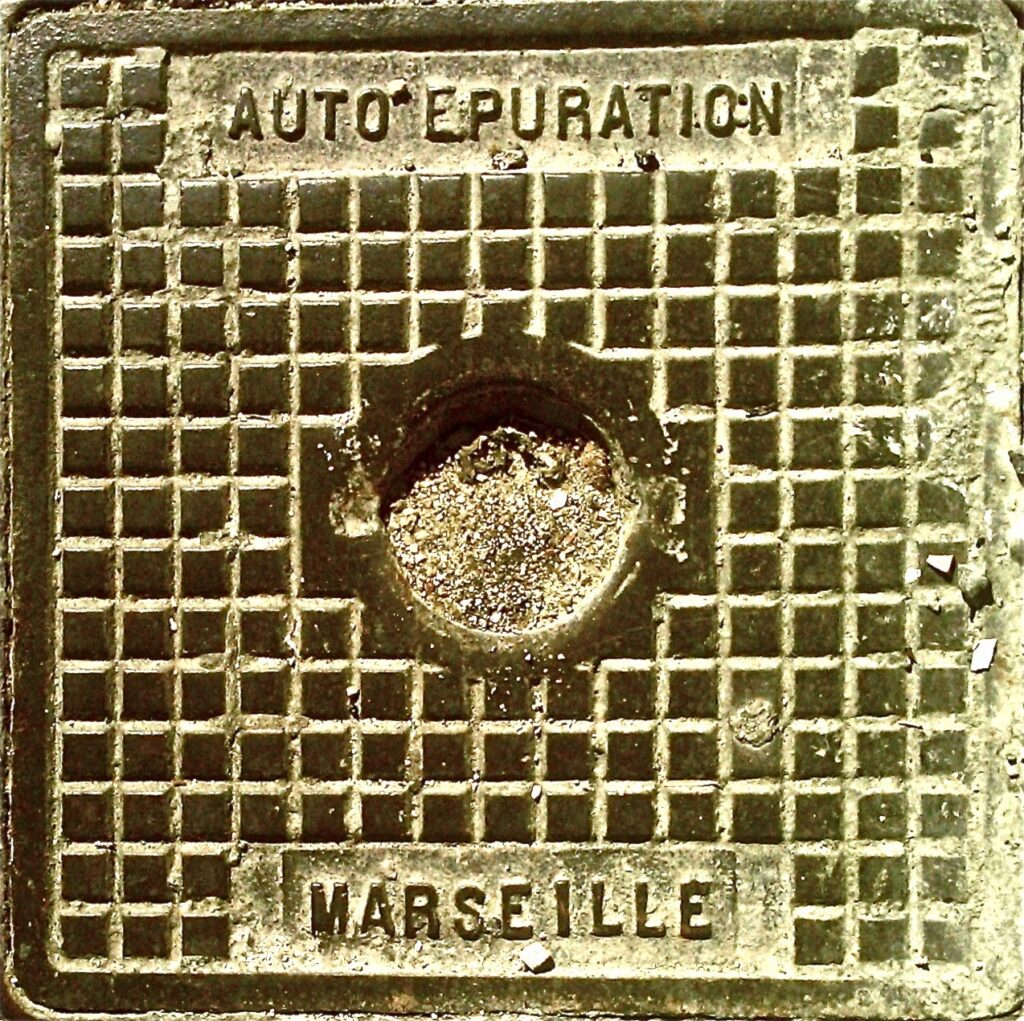

0 commentaires